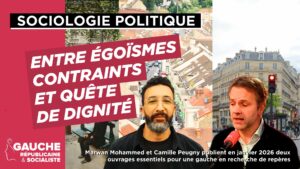Tenir bon sur le climat, en actualisant les objectifs et les argumentaires : C’était le propos du Sommet Climate Chance Europe Afrique 2025 qui s’est tenu à Marseille les 31 mars et 1er avril 2025.
Depuis le Sommet de Rio de 1992 et la première COP à Berlin en 1995, il y en a eu des engagements ! Trente ans plus tard, des avancées existent mais l’heure est au rééquilibrage atténuation/adaptation. Le titre du Sommet était clair : « Adaptation : Passer à l’action ! »
En effet, l’ampleur et la succession rapide des catastrophes climatiques, la montée des réactions autoritaires, de l’obscurantisme et du déni scientifique, la prédation exacerbée des ressources (« drill, baby, drill ! ), les guerres et la hausse des dépenses militaires, ne nous permettent plus de préparer confortablement le développement durable pour les « générations futures ». C’est maintenant qu’il faut préserver la paix et la gestion durable des ressources, en trouvant les moyens de protéger les populations et de renforcer la sécurité civile. Ce dernier point reste cependant timidement abordé dans les enceintes de discussions climatiques.
S’adapter ou atténuer ? Pas de faux débats !
Un faux débat peut opposer les politiques d’atténuation et d’adaptation. Beaucoup considèrent que « s’adapter », c’est renoncer à « atténuer ». Cependant, aucun scenario du GIEC ne prévoit une possible baisse de température moyenne. C’est la baisse des gaz à effet de serre qui est recherchée, pour atténuer la hausse des températures et ses effets d‘emballement. Le scenario le plus optimiste à +1,5 °C en 2100 (objectif de la COP 21 à Paris en 2015) est fondé sur des politiques climatiques drastiques qui n’ont pas pu se mettre en œuvre. Il n’est plus plausible aujourd’hui.
Dans son introduction au Sommet de Marseille, le Sénateur écologiste Ronan Dantec a voulu « briser un tabou » en fixant l’objectif d’un scenario à +4°C à 2100, sachant que cette hypothèse tient compte la neutralité Carbone en 2050 en Europe et des engagements de la Chine. En se positionnant sur les scenarios les plus pessimistes à la fin du siècle, on redonne paradoxalement de la motivation à agir maintenant, plutôt que de provoquer des paniques de « sauve qui peut » sur des objectifs inatteignables. Les idéologies darwinistes, le retour en force de la loi des plus forts et des plus riches, se nourrissent de cette panique.
Reprendre le fil de politiques écologiques fondée sur le bien-être et la protection de tous est vital. Il se trouve que de nombreuses mesures d’adaptation sont les mêmes que l’atténuation : isoler les bâtiments évite de consommer de l’énergie (atténuation) et de souffrir de canicule l’été (adaptation), planter des arbres rafraîchit les villes (adaptation) tout en stockant le CO2 (atténuation). En protégeant de la vulnérabilité, l’adaptation peut être une vision d’anticipation et de transformation. La différence est qu’elle s’inscrit dans un présent immédiatement perceptible par les populations, ce qui aide à apaiser les visions du futur.
Protéger dans l’urgence, aménager dans la durée : Un double impératif
En effet, les politiques de long terme, qui restent évidemment nécessaires, sont confrontées à l’urgence de protéger les populations dans des situations de crise spectaculaires qui peuvent décourager d’agir, comme si la bataille était de toute façon perdue : cyclone à Mayotte, grandes inondations à Valence, grands incendies à Los Angeles, prédation des ressources déclenchée par la fonte des glaces en Arctique… La France métropolitaine n’est pas épargnée, et pas suffisamment préparée. La montée des eaux en Méditerranée vient, par exemple, de faire l’objet d’un rapport alarmiste des trois Chambres régionales des comptes de Corse, PACA et Occitanie.
Ce rapport pointe l’aveuglement du marché de l’immobilier et des plans locaux d’urbanisme. Il chiffre l’explosion prévisible des coûts d’assurance et d’indemnisation. Les petites communes de la vallée de la Roya qui ont subi de grandes inondations en octobre 2020, en connaissent malheureusement la douloureuse expérience, avec l‘incapacité de trouver des assurances aujourd’hui.
Nos plans d’adaptation nationaux et européens ne sont pas à la hauteur de cette révolution à penser dans l’aménagement des villes, des campagnes et des forêts. Le nouveau Plan national d’adaptation au changement climatique attendu depuis 2023 et présenté en mars 2025, se positionne lui aussi sur le scenario à + 4°C en 2100 (+ 2,7 ° en 2050). Il est cependant critiqué pour ses moyens insuffisants, alors que des coupes budgétaires sont actuellement réalisées dans toutes les politiques environnementales.
Un sujet difficile est de permettre une maîtrise foncière efficace pour agir vite. C’est le problème aussi de la lutte contre l’habitat indigne, paralysée par des procédures interminables et coûteuses. Aujourd’hui, les élus locaux sont confrontés à ce qu’ils vivent comme des injonctions contradictoires : construire plus de logements, notamment sociaux (loi SRU), tout en protégeant les terres de l’artificialisation (loi ZAN). Une meilleure articulation entre les Code de l’Urbanisme, de l’Environnement, de la Construction et de l’Habitat, avec la création d’outils communs permettant de concilier les objectifs plutôt que de les opposer, devient une priorité. Trop souvent, la simplification à la tronçonneuse, très en vogue aujourd’hui, se résume à couper des moyens et des réglementations pour l’environnement, au lieu de les intégrer en appui des politiques d’habitat et d’urbanisme.
Dans le même temps, les politiques libérales s’attaquent aussi aux moyens publics de secours et d’intervention. Pourtant les « pompiers privés » des riches résidences en Californie ont été inefficaces contre les grands incendies. Les habitants de Valence en Espagne se sont mis en colère quand ils ont appris que le gouvernement local conservateur avait minimisé les risques météo, et tardé à demander du soutien à l’État espagnol dirigé par le parti socialiste, parce que le coût du recours à l’Unité Militaire d’Urgence était jugé trop élevé.
Ce qui coûte cher, ce ne sont pas les forces de sécurité civile, c’est l’adaptation réactive de crise et les dommages des catastrophes.
Marseille, une ville méditerranéenne aux avant-postes
Comme Valence ou Barcelone, Marseille est une grande ville côtière de Méditerranée confrontée à des changements climatiques majeurs. La Ville s’est récemment engagée dans un Contrat de Ville Climatique qui agit sur des politique publiques structurantes. Il était grand temps !
Parmi toutes les mesures nécessaires, insistons sur la protection des posidonies, puits de carbone plus efficace que la forêt amazonienne, pour s’adapter et atténuer le changement climatique.
Bien des efforts restent à faire sur l’alimentation, l’industrie, l’habitat, la mobilité, la gestion de l’eau. A Marseille, les émissions de CO2 proviennent essentiellement des transports longue distance, déplacements pendulaires, flux autoroutiers Marseille-Aix, Marseille Ouest Etang de Berre. Ce dernier point montre l’importance d’investissements structurants comme le projet ferroviaire Ligne Nouvelle Provence Côte d’Azur, et d’un renforcement du plan de transports métropolitain pour réduire les flux autoroutiers de la voiture thermique.
Cependant, ce contrat climatique sous-estime encore l’importance d’intégrer une vraie politique de gestion des risques et de renfort de la sécurité civile. Ce sera un des enjeux majeurs du prochain mandat. La ville a cette particularité de bénéficier déjà d’un corps de marins-pompiers très efficace et apprécié de la population. Initialement institué comme une sanction de l’État face à l’incapacité de la Ville à sauver des vies dans l’incendie des Nouvelles Galeries en 1938, cette unité militaire de pompiers devient aujourd’hui un atout majeur. Constitué de 2500 militaires et civils, leurs budget est financé par la Ville et par l’État.
Bien au-delà des 128 000 interventions d’urgence par an qu’ils réalisent, leurs bases de données dans l’urbanisme, leur connaissance du terrain mais aussi leurs projets de recherche et d’innovation en font un service support transversal pour l’anticipation et la gestion des risques. Les marins-pompiers se sont distinguées dans la lutte contre l’habitat indigne et surtout dans la crise sanitaire où ils ont innové dans la capacité à analyser et suivre les différents variants du COVID dans les eaux usées. Ils sont en capacité de participer à des projets de recherche européens.
En sauvant des vies tous les jours, les forces de secours transmettent un message universel qui semblait évident il y a quelques années, mais qui redevient précieux aujourd’hui : celle de la vulnérabilité de l’humain et de la nécessaire action collective pour se protéger. Alors que les argumentaires sur le climat sont malheureusement dénigrés à cause de leur complexité, la simplicité et l’efficacité des forces de protection civiles en font les meilleurs alliés des politiques environnementales.
Sophie Camard