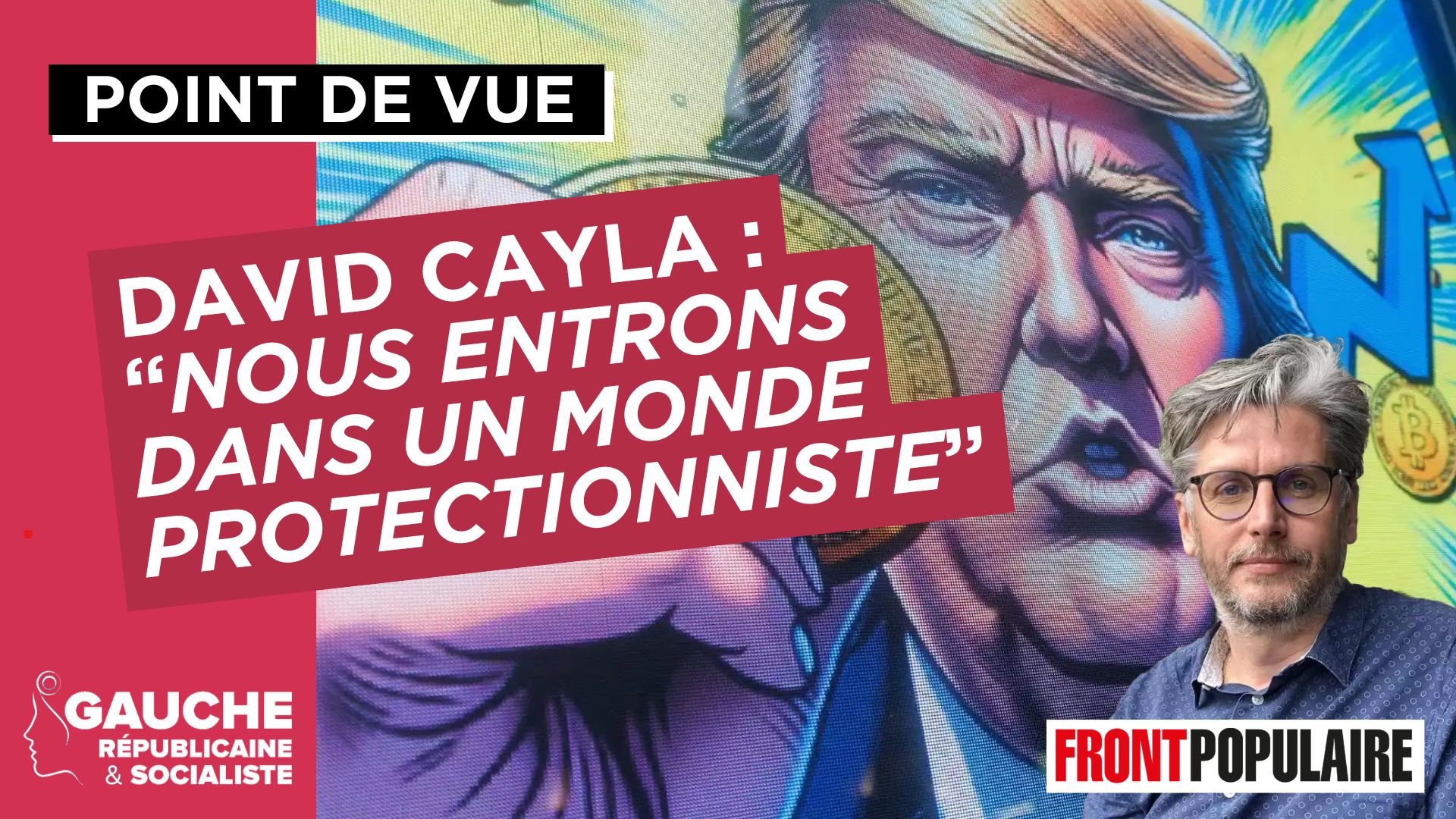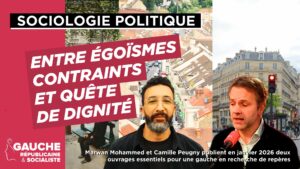ENTRETIEN. Comment faut-il comprendre la hausse massive des droits de douanes décidée par les États-Unis ? Pour notre camarade, l’économiste David Cayla, interrogé par Quentin Rousseau pour Front Populaire, le pari protectionniste trumpien est à l’évidence très risqué. Mais il n’en porte pas moins un rude coup à la mondialisation néolibérale. Nous publions cet entretien avec l’accord de David Cayla.
David Cayla est maître de conférence en économie à l’Université d’Angers. Spécialiste du néolibéralisme, de l’économie européenne, et fin connaisseur de la question du protectionnisme, il défend une économie hétérodoxe. Son dernier livre en date : La gauche peut-elle combattre le néolibéralisme ? (éd. Le Bord de l’eau, 2024).
Front Populaire : Comment qualifiez-vous la politique commerciale et tarifaire lancée par Donald Trump ? Que cherche-t-il à accomplir en imposant des tarifs douaniers au reste du monde ?
David Cayla : C’est clairement une politique commerciale protectionniste qui renoue avec la tradition commerciale américaine de la deuxième moitié du XIXème siècle. En 1861, sous la pression du député du Vermont Justin Morrill, le Président démocrate James Buchanan fut contraint de signer une loi imposant des droits de douane d’environ 45% sur la grande majorité des importations américaines. Cette hausse tarifaire fut l’une des causes de la guerre de Sécession car les États esclavagistes qui exportaient leur coton en Europe étaient de farouches partisans du libre-échange.
Après 1910, les Américains deviennent la première économie mondiale. Les droits de douanes baissent quelques années, avant de repartir à la hausse à partir de 1920. Dans les années 1930 les droits de douanes retrouvent leurs niveaux de la fin du XIXe siècle, même si moins de produits sont concernés. Enfin, de 1947 (signature du GATT, l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce) au premier mandat de Trump, les droits de douane baissent jusqu’à un niveau moyen de 2 à 5%.
Que cherche Trump avec ces droits de douane ? La même chose qu’au XIXe siècle. Il s’agit simplement de protéger l’industrie manufacturière américaine et les emplois. Il est à noter que toutes les importations ne sont pas concernées par les hausses tarifaires. Les matières premières, les services, l’énergie, les semi-conducteurs et les produits pharmaceutiques sont exemptés, ce qui dénote bien que le souci principal de cette politique est de protéger l’industrie manufacturière.
FP : Les critiques contre la nouvelle politique américaine fusent, y compris dans son camp. Sont-elles justifiées selon vous ?
DC : Il y a deux sortes de critiques. Les critiques idéologiques proviennent de ceux qui font du développement du commerce international l’alpha et l’omega de la politique économique. Ces partisans de la mondialisation néolibérale sont effarés qu’on puisse remettre en cause cet édifice construit patiemment durant des décennies. Ils croient au libre-échange sans recul ni questions et ne comprennent tout simplement pas qu’on puisse le contester. Ces critiques, même si elles se déploient très largement dans les médias, n’ont aucune justification et aucun intérêt. La politique commerciale mérite mieux que ces hauts cris effarouchés.
D’autres critiques plus pragmatiques sont néanmoins justifiées. Disons-le clairement, le pari de Donald Trump est risqué et a toutes les chances d’échouer. Une hausse des droits de douane à elle seule ne peut suffire à réindustrialiser l’économie américaine pour au moins trois raisons.
Il existe de nombreux freins à la reprise du secteur manufacturier américain et il n’est pas dit qu’une politique commerciale protectionniste suffise à relancer ce secteur.
Premièrement, le système productif américain est très dépendant des importations. La hausse des droits de douanes sur les composants importés va renchérir le coût de fabrication de l’industrie manufacturière, même si les matières premières et l’énergie sont exemptés. Deuxièmement, ces droits de douanes sont inflationnistes. En effet, tous les produits importés ne pourront être remplacés par une production locale. Or, si les prix augmentent, les consommateurs américains vont reporter leurs achats de biens manufacturés, notamment d’automobiles… ce qui en fin de compte risque d’affaiblir les carnets de commande et les secteurs mêmes que les droits de douane sont censés aider. Enfin, il n’est pas sûr que les Américains parviennent à compenser les importations par une production nationale. Pour cela, il faudrait une réserve de main-d’œuvre employable. Or, le taux de chômage américain est faible et la politique d’expulsion des migrants prive les États-Unis d’une partie importante de leur main-d’œuvre.
Il existe donc de nombreux freins à la reprise du secteur manufacturier américain et il n’est pas dit qu’une politique commerciale protectionniste suffise à relancer ce secteur. Dans ce cas, tout ce que produira cette politique sera une hausse des prix et un appauvrissement des ménages américains.
FP : Comment faut-il interpréter les chutes boursières qui ont suivi, notamment en Asie et en Europe ?
DC : La crise boursière ne peut être une surprise. Toutes les grandes entreprises cotées évoluent dans une économie mondiale qui leur permet de jouer des différences de législation et de règlementation pour produire au moindre coût. Rétablir des barrières douanières, c’est attaquer frontalement ce modèle économique.
De plus, les États-Unis sont, de loin, le premier marché mondial en termes de biens de consommations. L’un dans l’autre, les entreprises cotées du monde entier doivent s’attendre à une forte baisse de leurs profits. Il est donc logique que leur cours boursier s’effondre. De plus, Trump ouvre une guerre commerciale mondiale dont il est difficile de prévoir les conséquences. Cette incertitude participe à créer de la volatilité boursière et explique aussi l’effondrement des bourses mondiales qui deviennent sensibles aux rumeurs et aux spéculateurs.
FP : L’Union européenne s’est fondée sur l’idée que le politique était inféodé à l’économie – et au libre-échange. Que pensez-vous de sa réponse aux nouveaux tarifs américains ?
DC : Je suis loin d’être convaincu par les réponses européennes. L’Union européenne se retrouve confronté à un choix impossible. Soit accepter les droits de douanes américains sans chercher à défendre ses intérêts, soit répliquer au risque de voir la politique commerciale américaine se durcir. Or, l’Union européenne, et singulièrement l’Allemagne, ont besoin d’exporter aux États-Unis. L’Allemagne vient de subir deux années consécutives de récession tandis que son industrie a été lourdement affectée par la crise du gaz.
(…) S’il est possible de trouver un accord unanime des Européens pour proposer du libre-échange, il n’y aura pas d’unanimité en matière de mesures de rétorsion. Beaucoup de pays ont trop à perdre.
Dans ce contexte, la seule stratégie européenne susceptible de rallier l’ensemble de ses membres serait le retour au libre-échange. C’est la raison pour laquelle Ursula von der Leyen a proposé aux États-Unis… un accord de libre-échange. Cet accord n’avait évidemment aucune chance d’être accepté, d’autant que l’administration Trump considère la TVA comme un droit de douane déguisé, puisqu’il taxe les importations européennes mais pas leurs exportations, permettant ainsi aux produits européens d’être vendus moins cher aux États-Unis qu’ils ne le sont en Europe. Rappelons qu’aux États-Unis seule une « sale tax » existe, mais son niveau (5-10%) est bien inférieur à celui de la TVA européenne.
À présent que la proposition européenne a été rejetée par la partie américaine, que va faire la Commission ? C’est à elle qu’incombe la responsabilité de négocier les traités commerciaux. Le problème est qu’en dehors du libre-échange dogmatique qui l’anime, il n’y a pas grand-chose. D’autant que, s’il est possible de trouver un accord unanime des Européens pour proposer du libre-échange, il n’y aura pas d’unanimité en matière de mesures de rétorsion. Beaucoup de pays ont trop à perdre. Les exportateurs que sont l’Allemagne et l’Italie vont craindre une nouvelle hausse des droits de douane. L’Irlande, la base arrière des géants du numérique américains, ne voudra certainement pas qu’on impose des mesures de rétorsion aux grandes plateformes numériques.
Plus fondamentalement, l’UE est empêtrée dans des traités qui ont été entièrement réécrits dans les années 1980 et 1990, et sont donc très influencés par l’idéologie néolibérale. Cette inertie du droit européen est aujourd’hui un handicap car le monde bascule.
FP : La doctrine néolibérale et la mondialisation vont généralement main dans la main. Trump est-il en train de tourner la page du néolibéralisme ?
DC : C’est la thèse que je défends depuis plusieurs années. Le populisme trumpien est à la fois la conséquence de la mondialisation néolibérale et son antidote.
Néanmoins, cela ne signifie pas que ce qui est en train d’advenir est souhaitable. Le trumpisme est très loin d’être un humanisme. De fait, sortir du néolibéralisme ne conduira pas nécessairement à un meilleur monde. Il annonce au contraire le retour d’une logique impériale et l’affaiblissement d’un ordre mondial qui a longtemps cherché à s’organiser autour du multilatéralisme.
(…) En faisant des politiques mercantilistes allemandes le modèle à suivre pour tous les pays européens, nous sommes devenus dépendants de nos exportations.
FP : Dans ce contexte de guerre économique livrée par les États-Unis au reste du monde, quelle pourrait être une réaction intelligente de la France ?
DC : La France devrait militer pour des politiques de relance en Europe. Quel est le problème des entreprises européennes ? La faiblesse de leurs débouchés. Ainsi, au lieu de chercher à vendre notre surplus productif de l’autre côté de l’Atlantique, on ferait mieux de faire en sorte qu’il profite aux ménages européens. Au lieu de comprimer les salaires et les dépenses publiques partout en Europe, on ferait mieux de mobiliser notre épargne pour investir sur le sol européen.
Si nous sommes dans cette situation, c’est parce qu’en faisant des politiques mercantilistes allemandes le modèle à suivre pour tous les pays européens, nous sommes devenus dépendants de nos exportations. Il est plus que temps de rompre avec cette dépendance et d’accepter le fait que nous entrons dans un monde protectionniste où la demande intérieure devient à nouveau préférable aux tentations de la compétitivité extérieure.