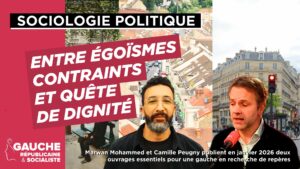La relance de la production hydroélectrique représente un avantage comparatif certain pour notre pays. Mais l’accord conclu cet été entre notre pays et la commission européenne démontre que les leçons des erreurs du passé n’ont pas été retenues. Il faudra aussi gérer d’importants conflits d’usage… une vraie réflexion sur l’intérêt général et la résilience est indispensable.
L’énergie hydroélectrique est l’un des piliers de notre mix énergétique, on n’en parle moins cependant beaucoup moins que du nucléaire, du solaire ou de l’éolien. Et pourtant, cette énergie venue des barrages représente 13,9 % de notre production annuelle d’électricité. Elle est renouvelable et, à en croire le nouveau patron d’EDF, Bernard Fontana, elle doit même redevenir une énergie d’avenir ; elle était effectivement très « populaire » jusqu’à l’avènement du nucléaire.
Peut-on relancer la « houille blanche » comme on surnomme l’hydroélectricité : jusque-là, la gestion de l’hydroélectricité à la française posait problème à l’Union Européenne. Un contentieux entre la France et la commission européenne a ainsi duré plus de dix ans : Bruxelles voulait ouvrir à la concurrence ce secteur en remettant en cause la position prédominante d’EDF dans la gestion des barrages. Dix ans de perdus, jusqu’à un accord de principe conclu à la fin du mois d’août : La France a obtenu de prolonger les concessions des opérateurs actuels, mais en les obligeant à céder un tiers de la production nationale d’hydroélectricité pour qu’ils soient vendu aux enchères à des fournisseurs privés… Une façon de reproduire tout de même la même bêtise qu’avec le nucléaire et l’Arenh – comme quoi les leçons n’ont pas vraiment été retenues.
L’État et EDF ont-ils désormais la voix libre pour relancer les investissements dans les barrages français : la production hydroélectrique a des atouts très complémentaire des autres sources d’énergie, éolien et solaire en particulier. Dans la perspective du développement des énergies renouvelables, l’hydroélectricité a vocation à jouer un rôle important dans le mix énergétique décarboné où la production dépendra énormément du soleil, du vent qui intermittent : elle permet de stocker l’énergie pour la rendre disponible dans des périodes où l’offre est faible et la demande importante, ce qui ne peuvent faire les autres sources. Ainsi le nouveau PDG d’EDF prétend vouloir augmenter les capacités de production hydroélectrique de 20 %.
Comme il serait trop coûteux, écologiquement pas vraiment soutenable, de construire de nouveaux grands barrages en France, l’idée, c’est de développer des infrastructures moins lourdes, qu’on appelle des STEP, pour station de transfert d’énergie par pompage. Cela consiste en fait à créer deux réservoirs, amont et aval : on va pomper de l’eau du réservoir aval pour le transférer en amont et ensuite turbiner cette quantité d’eau en amont vers l’aval lorsqu’on a un déficit de production. Cela permet de stocker de l’eau en amont quand le prix de l’électricité est nul ou négatif en pleine journée ou l’été, par exemple, pour l’utiliser la nuit ou l’hiver, pour produire une électricité plus rare et donc plus chère.
Il reste cependant d’autres obstacles au renouveau véritable de l’hydroélectricité en France, qui sont liés à l’impact environnemental des barrages qui modifient le cours des rivières, noie des territoires entiers, empêche la circulation des poissons et entrave plus largement la biodiversité. Et puis, il y a un autre point noir lié à la multiplication des épisodes soit de sécheresse, soit de trop fortes précipitations, l’un comme l’autre induits par le dérèglement climatique. À ce moment-là, les barrages sont utilisés comme des moyens de réguler le niveau des cours d’eau ; cela crée des conflits d’usage de l’eau entre la production d’électricité et l’agriculture, ou bien la préservation de l’environnement. Par exemple, pour préserver les milieux naturels via des contraintes sur le niveau d’éclairage minimum et, de façon plus importante, des contraintes agricoles sur l’irrigation, qui imposent de retenir l’eau en hiver pour pouvoir alimenter l’agriculture irriguée l’été.
Cette situation ne fait pas l’affaire des producteurs d’électricité, puisque en France, on a une pointe de consommation en hiver ; in fine, les contribuables vont en payer le prix : l’État, chaque année, verse des millions d’euros à EDF et aux autres opérateurs de barrage (assez peu nombreux) pour compenser l’électricité qu’ils n’ont pas pu produire à cause de ces conflits d’usage.
Frédéric Faravel