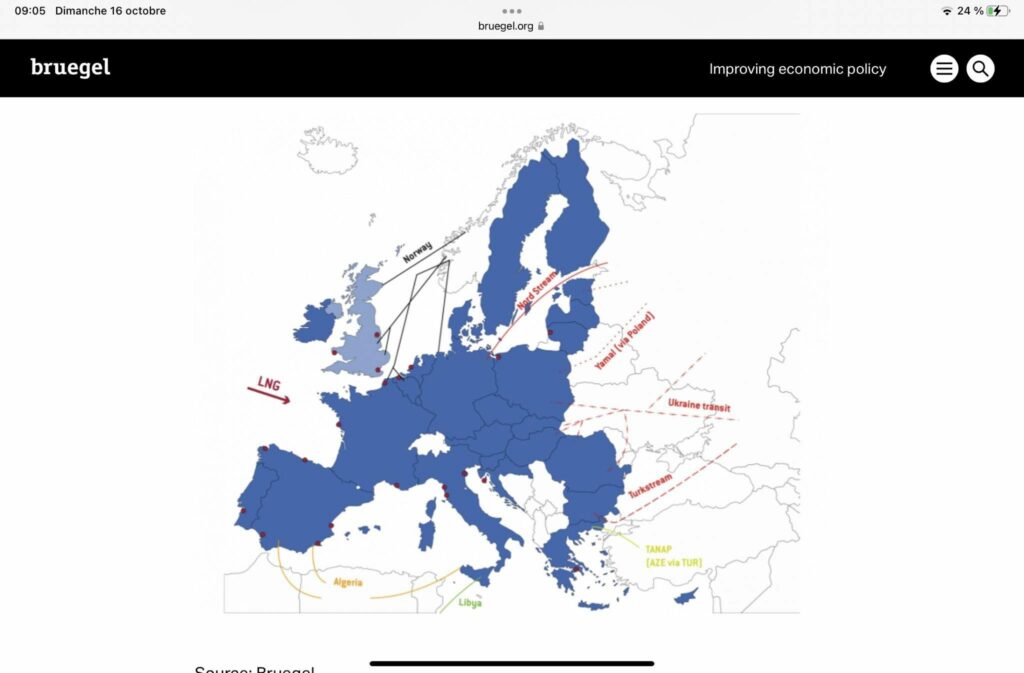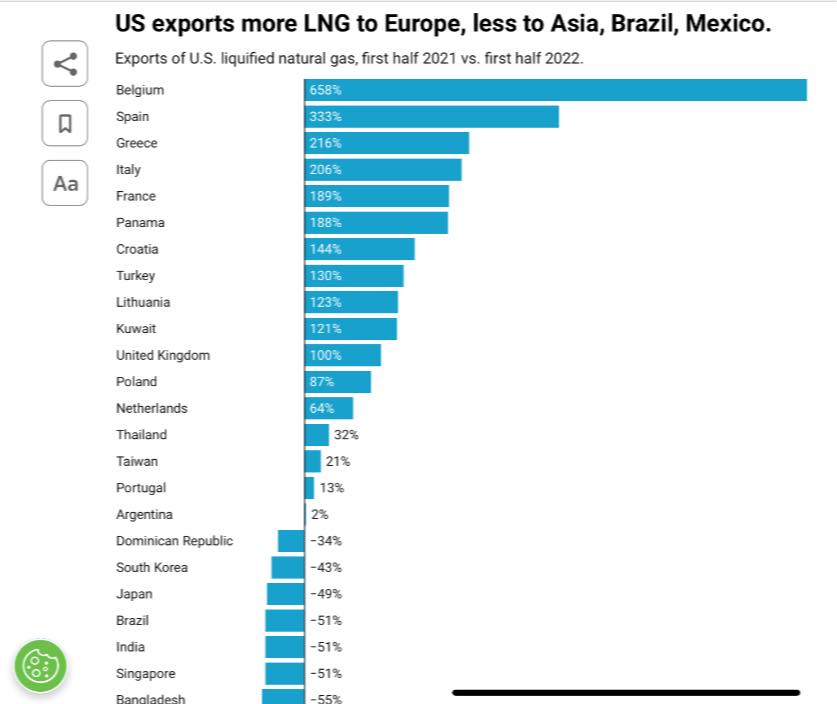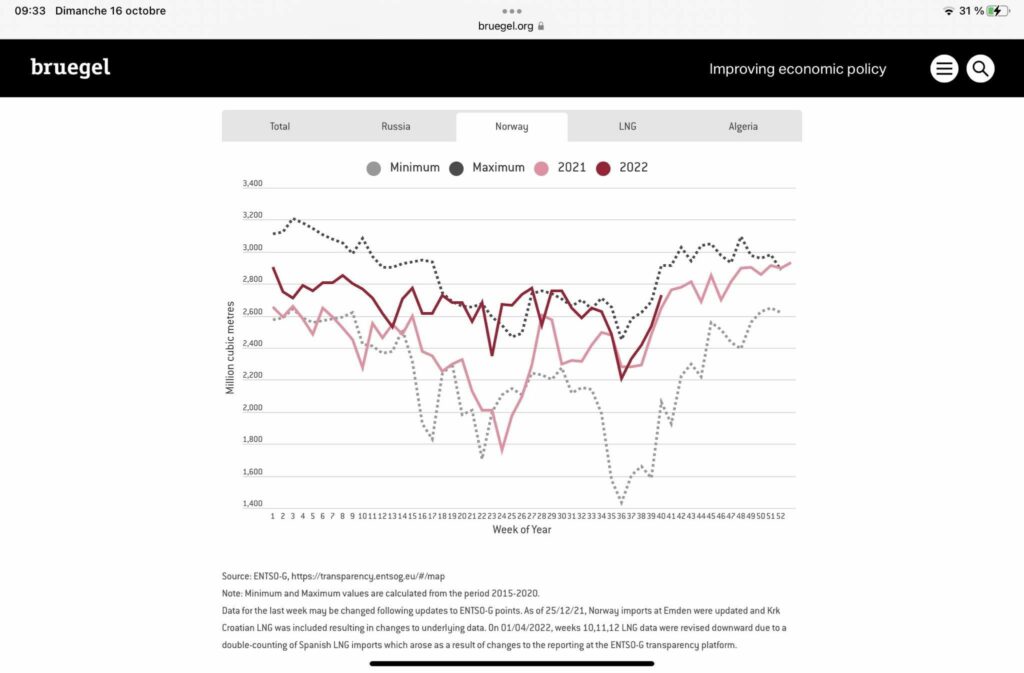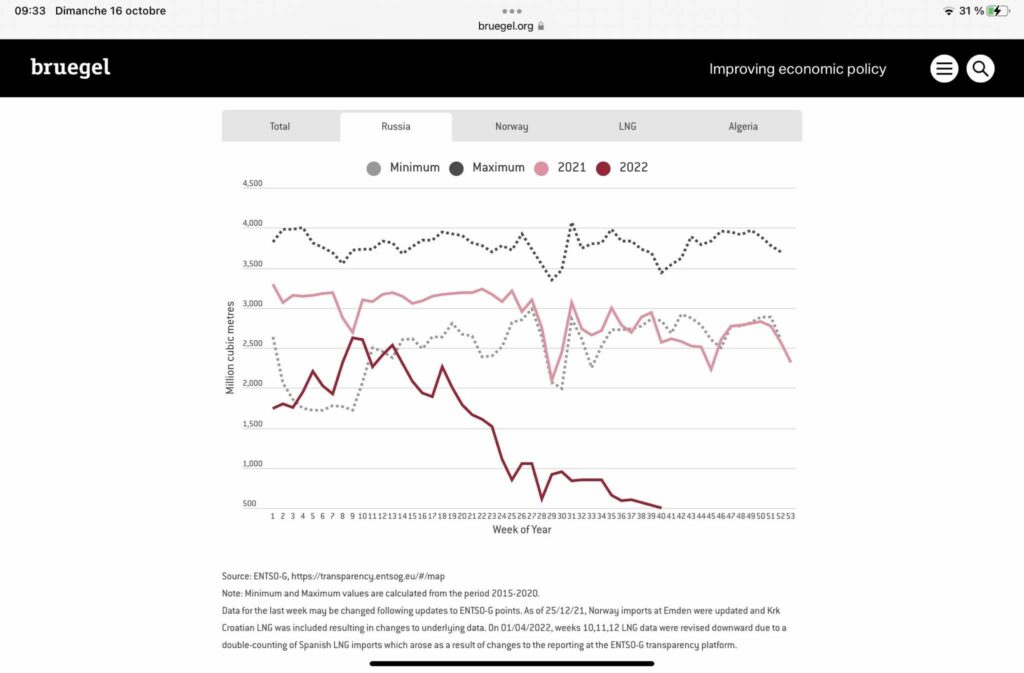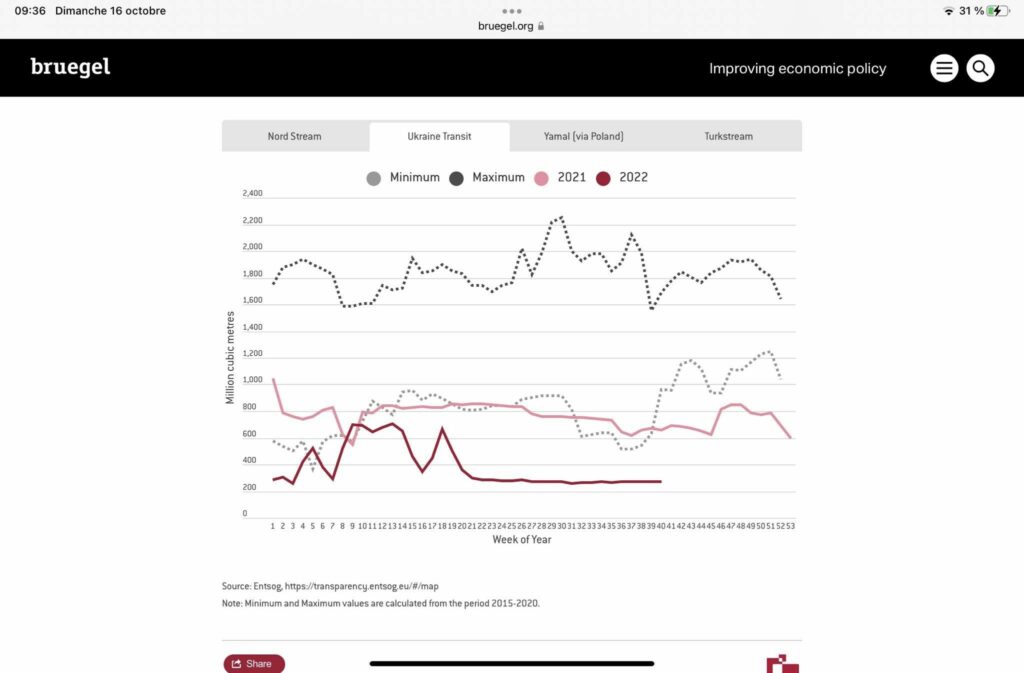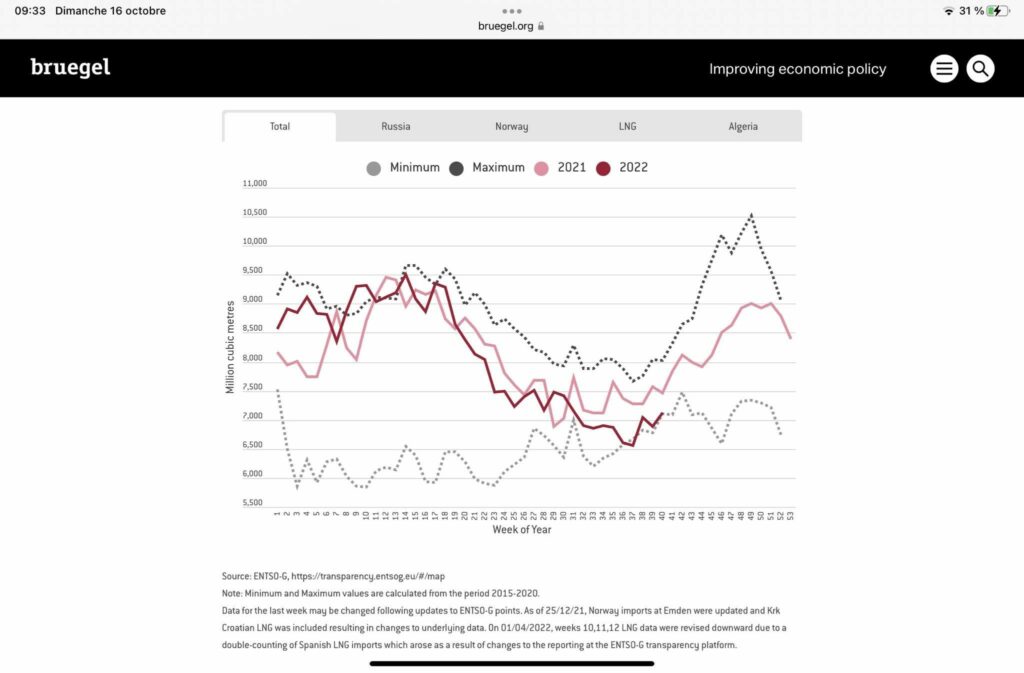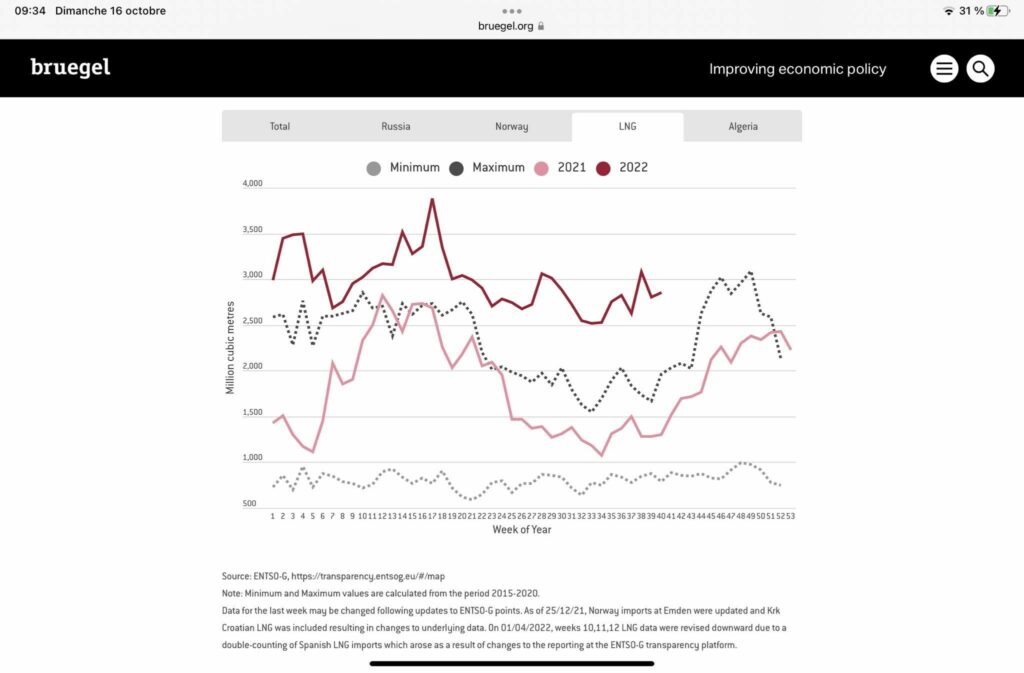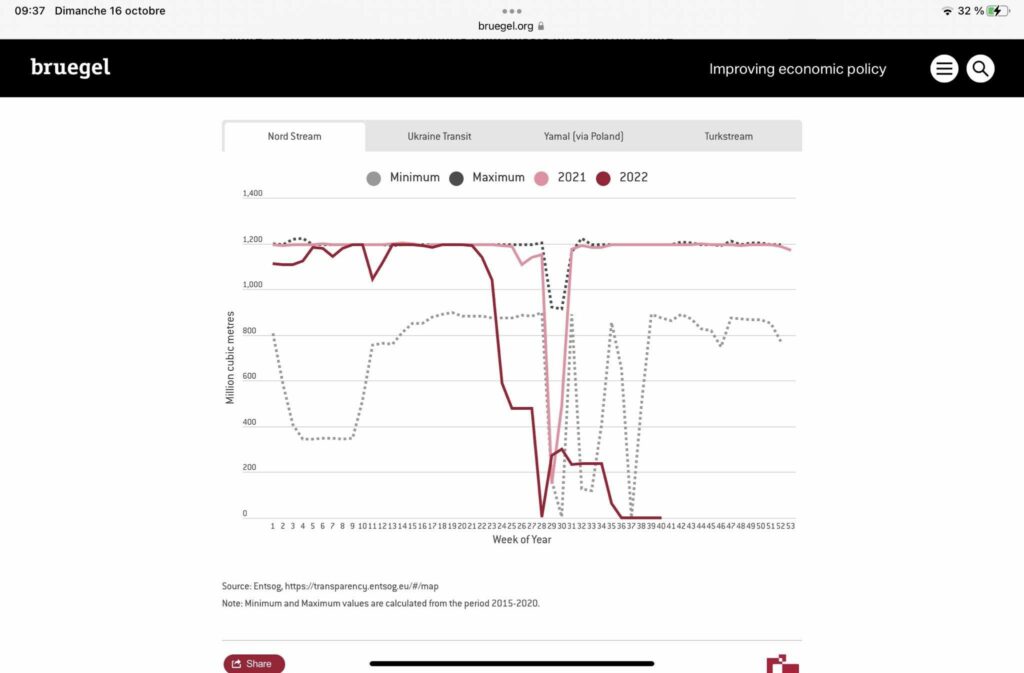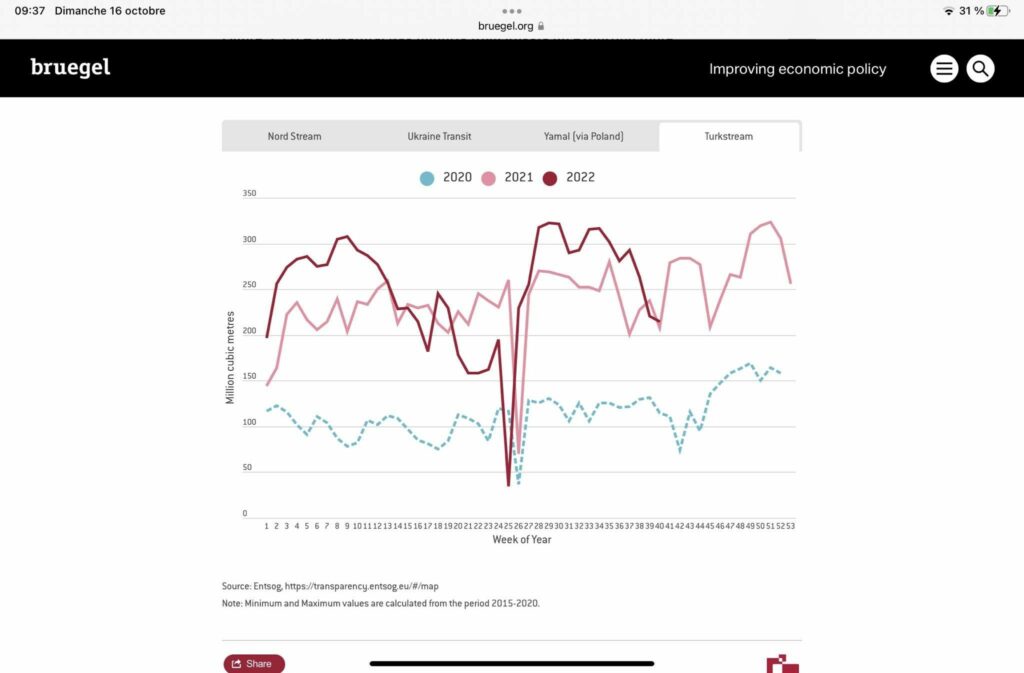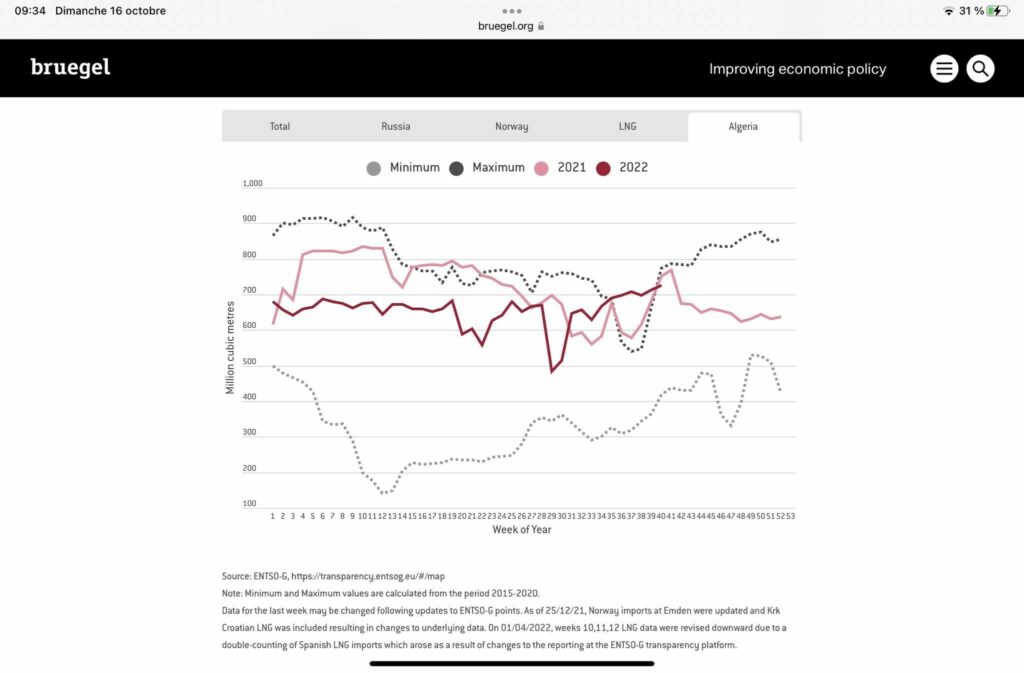entretien croisé – propos recueillis par Fabien Escalona et Ludovic Lamant – publié le 13 mars 2024 à 14h57 dans Mediapart
L’Union européenne doit-elle s’élargir à l’Ukraine ? Alors que la question constitue l’un des clivages de la campagne électorale, Mediapart a organisé un débat entre deux candidats de gauche : Chloé Ridel (PS), favorable à cet élargissement, et Emmanuel Maurel (GRS, liste de la gauche unie pour le monde du travail), qui y est opposé.
Faut-il intégrer l’Ukraine à l’Union européenne (UE) ? Le pays a formulé une demande d’adhésion dans la foulée de son invasion par les troupes russes en février 2022. En décembre 2023, les dirigeants européens ont officiellement ouvert des négociations avec Kyiv.
Pour en débattre, Mediapart a organisé un échange au long cours entre deux candidats de gauche au scrutin européen du 9 juin prochain, en désaccord sur cet enjeu clivant de la campagne.
Chloé Ridel, porte-parole du Parti socialiste (PS) et dixième sur la liste PS-Place publique emmenée par Raphaël Glucksmann, autrice du livre D’une guerre à l’autre : L’Europe face à son destin (L’Aube, 2022), a ainsi dialogué avec Emmanuel Maurel, élu depuis 2014 à Strasbourg, qui se présente en troisième position sur la liste portée par le communiste Léon Deffontaines au nom de la Gauche républicaine et socialiste (GRS), après avoir figuré sur des listes PS (2014) et LFI (2019).
Mediapart : L’Union européenne a décidé d’ouvrir des négociations d’adhésion avec l’Ukraine, un pays en guerre avec la Russie et partiellement occupé. Est-ce une bonne idée, et pourquoi ?
Chloé Ridel : Opposer un refus a priori d’entrer en négociation, ce serait d’abord renoncer à une ambition internationaliste. Notre rôle ne doit pas être d’opposer les peuples et les travailleurs, mais de réconcilier des ambitions : d’un côté, aider l’Ukraine à rentrer dans l’UE, car c’est son souhait ; de l’autre, réunir les conditions qui permettent de ne pas fragiliser notre industrie, notre agriculture, et l’architecture institutionnelle de l’Union.

S’opposer a priori à une perspective d’adhésion, comme le font aujourd’hui l’extrême droite, La France Insoumise et le Parti communiste, c’est aussi se priver d’un levier de transformation de l’UE. Dans tous les cas, le processus devra en effet être conclu à l’unanimité des États membres. Cela signifie la possibilité d’un veto, et donc d’un moyen de pression pour obtenir des améliorations progressistes. On doit profiter de ce processus pour demander une augmentation du budget européen, une réforme de la politique agricole commune (PAC) et une réforme des traités.
Les Ukrainiens ne meurent pas pour nous rejoindre. Ils défendent surtout leur intégrité territoriale et leur patrie.
Emmanuel Maurel
Emmanuel Maurel : Le problème, c’est qu’on nous présente la chose comme allant de soi. La position de Chloé n’est pas la même que celle des principaux responsables des institutions européennes. Quand on entend Charles Michel [président du Conseil européen – ndlr], Ursula von der Leyen [présidente de la Commission européenne – ndlr] ou Roberta Metsola [présidente du Parlement européen – ndlr], c’est comme si l’élargissement était déjà fait. C’est une logique de fait accompli, contre laquelle je m’insurge depuis dix ans. Car oui, l’élargissement fait débat.
Dans l’esprit de ses promoteurs, il s’agit d’une décision symbolique par rapport à un pays agressé. L’UE le soutient humanitairement, financièrement et militairement, mais elle a le sentiment, parfois justifié, qu’elle n’en fait pas assez. Elle cherche donc une réponse politique pour montrer qu’elle est « vraiment » du côté de l’Ukraine. Mais il s’agit d’une fuite en avant.
L’UE ne va pas bien, est confrontée à des crises dans tous les sens – énergétique, écologique, économique, etc. Or ses dirigeants sont incapables de tracer des perspectives pour conforter l’Union. Ils cherchent une sorte de grand projet qui permettrait d’unifier les opinions et les gouvernements. Le problème, c’est que l’élargissement, c’est quelque chose de concret.
À travers leur résistance, les Ukrainiens nous ont rappelé la raison d’être du projet européen.
Chloé Ridel
D’abord, l’Ukraine ne respecte aujourd’hui aucun des critères pour être intégré à l’UE. Ensuite, il y a déjà des gens dans la salle d’attente depuis de longues années, dans les Balkans notamment, qui n’ont pas encore ouvert tous les chapitres de négociation. Enfin et surtout, on ne nous explique pas le projet. Unifier le continent davantage, mais pour aller où ? Mon refus n’est pas seulement technique, il est d’abord politique.
Est-ce qu’avec cet élargissement, l’UE ne retrouve pas une raison d’être plus vitale que la construction d’un grand marché, à savoir la défense d’un modèle politique ?
Chloé Ridel : La dimension symbolique est évidemment présente. Dès la révolution Euromaïdan de 2014, l’Ukraine a exprimé une volonté de se tourner vers l’Europe. Et c’est parce qu’elle s’est tournée vers l’Europe que Vladimir Poutine a attaqué l’Ukraine. En termes de coût net pour le budget européen, l’Institut Delors a calculé que son adhésion représenterait 0,10% du PIB européen. Si cette somme nous amenait à laisser sur le bord du chemin l’Ukraine, et en son sein des gens prêts à mourir pour nous rejoindre, que penseraient de nous les États-Unis, la Chine, les pays africains… ? Que nous abandonnons les nôtres pour si peu.

À travers leur résistance, les Ukrainiens nous ont rappelé la raison d’être du projet européen. Nous avions raté notre entrée dans le XXIe siècle, nous nous étions divisés vis-à-vis des grandes puissances de l’argent et des puissance étrangères. Mais depuis la pandémie et la guerre en Ukraine, le projet européen reprend du sens. C’est celui de la solidarité des peuples autour d’un modèle qui repose sur des institutions démocratiques, ainsi qu’une certaine idée de la justice sociale et de l’écologie.
Je rejoins Emmanuel Maurel pour dire qu’il ne s’agit pas d’aligner de grandes phrases creuses. L’élargissement, c’est un immense défi. Mais il vaut la peine et rencontre nos intérêts. Regardons les Balkans : avoir laissé ces pays à nos portes pendant si longtemps a permis à la Chine et à la Russie de les infiltrer. Le Monténégro s’est ainsi retrouvé piégé par un prêt de la Chine pour une autoroute, que nous avons dû racheter au dernier moment.
Emmanuel Maurel : Que l’on ressente une émotion intense quand on voit l’Ukraine se faire attaquer par la Russie, je l’entends bien. Mais on ne fait pas de la politique uniquement avec des émotions. Par ailleurs je ne dirais pas que les Ukrainiens meurent pour nous rejoindre, ils défendent surtout leur intégrité territoriale et leur patrie. Et enfin, je ne peux pas laisser dire qu’on laisserait l’Ukraine au bord du chemin en n’ouvrant pas des négociations pour l’adhésion. On ne l’a jamais autant aidée qu’aujourd’hui !
Chloé Ridel : Tu penses vraiment qu’ils ne vivraient pas une fin de non-recevoir comme un abandon ?
Emmanuel Maurel : Je ne réagis pas par rapport à ce qu’ils veulent. C’est le risque de dislocation de l’Europe qui m’angoisse le plus.
Je répète qu’on n’en a jamais fait autant, en termes d’aide humanitaire et militaire, pour un pays hors de l’UE. On ne l’a pas fait pour la Bosnie dans les années 1990, et on ne l’a pas fait non plus pour les pays du Maghreb au moment des révolutions arabes dans les années 2010. Je me souviens qu’on ergotait sur des sommes très insuffisantes pour permettre leur développement économique. Au passage, c’est un des effets de l’élargissement toujours plus à l’Est : l’espace méditerranéen n’est plus dans l’agenda de la Commission et du Conseil.
Il faut transformer l’Europe pour accueillir l’Ukraine, parce qu’il est faux de dire que, en l’état, on pourrait l’accueillir.
Chloé Ridel
Quant à l’influence de la Chine, elle ne s’exerce pas qu’auprès des pays non-membres de l’UE, mais aussi en Grèce, au Portugal, en Italie, et même en France. Et pourquoi ? À cause de l’obsession du laissez-faire, et de la concurrence libre et non faussée. Cela me rappelle l’exemple des panneaux solaires. On avait des entreprises européennes qui se constituaient péniblement sur ce marché, on a discuté des moyens de faire face à une concurrence chinoise déloyale, et l’Allemagne d’Angela Merkel a tout bloqué, de sorte que la filière a été détruite.
Chloé Ridel : Tu t’éloignes du sujet. J’alerte moi aussi sur le fait que depuis la crise économique de 2008, la Chine possède 15 % des capacité portuaires européennes. Mais c’est parce qu’on a laissé faire. En quoi est-ce un argument pour nous empêcher de faire bloc, tout en nous élargissant ?

Emmanuel Maurel : Là où je veux en venir, c’est que je pense que tu as tort sur la communauté intellectuelle qui existerait à propos du modèle européen. À l’Est, nos partenaires envisagent l’UE sous l’angle de leur avantage comparatif dans un grand marché. Je le déplore, car j’ai été élevé dans l’admiration de grandes figures comme Vaclav Havel, avec l’impression que l’unification du continent se ferait autour de la culture, de la démocratie, mais ça ne s’est pas passé comme ça.
La France fait partie des pays qui ont le plus payé l’élargissement de 2004, à travers des délocalisations massives à l’Est.
Emmanuel Maurel
Chloé Ridel : Je te le dis en toute amitié : tu es resté coincé dans les années 1990. J’ai lu les mémoires de l’ambassadeur Claude Martin, qui a conduit au Quai d’Orsay toutes les négociation d’adhésion de ces pays d’Europe centrale et orientale. La seule chose qu’ils souhaitaient à cette époque, effectivement, c’était l’économie de marché et l’Otan. Mais nous sommes 25 ans plus tard. Une partie importante de la jeunesse de ces pays est profondément pro-européenne, et elle tient à l’UE car elle la perçoit comme une façon de lutter contre la corruption, en faveur d’institutions démocratiques.
Les choses évoluent et notre responsabilité n’est pas de dire que “de toute façon, on n’a rien en commun”, mais de donner du sens au projet européen, de rassembler autour d’un modèle qui ressort dès que l’on voyage dans le reste du monde. Il y a trois façons de le définir : le libéralisme politique, une certaine vision de la justice sociale, et demain une certaine écologie européenne qui passe par la sobriété.
Quel bilan tirer du précédent élargissement ? On voit bien, avec le récent malaise agricole, comment l’extrême droite pourrait se nourrir d’un nouvel élargissement vécu comme une menace sur les conditions de vie ?
Emmanuel Maurel : Chloé me renvoyait aux années 1990, mais si je peux me permettre, c’est elle qui y est restée bloquée. J’étais moi aussi dans cet espèce d’idéalisme européen, et je me souviens des socialistes qui faisaient campagne sur l’Europe sociale. Mais cet idéalisme s’est fracassé sur la réalité de l’UE, à savoir la compétition et la concurrence érigées comme fondamentaux absolus.
In fine, dès qu’on débat d’harmonisation sociale, les pays de l’Est mettent en avant leur avantage comparatif, qui passe par des salaires très bas. L’élargissement de 2004 s’est d’ailleurs traduit par un accroissement du PIB des pays qui nous ont rejoint, c’est clair, mais les salaires sont restés très bas car c’est leur avantage comparatif.
Je cherche toujours l’intérêt général européen, mais quand on représente la France au Parlement, on défend aussi l’intérêt français. Or notre pays fait partie de ceux qui ont le plus payé l’élargissement de 2004, à travers des délocalisations massives à l’Est, tandis que l’Allemagne en a été la principale bénéficiaire. En raison de la mauvaise stratégie de nos dirigeants mais aussi de la nature de la construction européenne, la France a été la grande perdante des élargissements successifs.

Prenons un exemple concret. Il y a un an, on a dit qu’on ferait des facilités d’exportation pour certains produits agricoles ukrainiens. Les pays de l’Est y étaient les plus favorables. Six mois après, les mêmes exprimaient le fait que ça ne leur convenait plus, que leur marché était déstabilisé, et ont demandé une exemption que l’UE leur a accordée. Depuis, les Français, les Espagnols, les Italiens et les Allemands demandent la même chose. Imaginez, en cas d’adhésion, ce qui se passera sur des plus gros volumes !
Notre responsabilité, en tant qu’internationalistes de gauche, c’est de montrer un chemin.
Chloé Ridel
Chloé Ridel : Je partage ton pessimisme de l’intelligence. Mais sans optimisme de la volonté, ce n’est que de la servitude volontaire. Sur la question des salaires, par exemple, rappelons qu’on a obtenu un smic européen. Et dans cette élection, notre liste propose un serpent salarial européen, comme jadis on avait eu un système monétaire européen, pour faire converger les salaires à travers l’UE.
Il faut faire attention à ne pas tout mettre sur le dos des élargissements. La destruction de l’industrie française est en partie liée à des choix politiques néfastes imputables à nos dirigeants, car d’autres pays de l’Ouest ont mieux protégé leur industrie. Elle est aussi liée à la concurrence internationale. C’est pourquoi je suis favorable à ce que l’Europe protège ses frontières, en ajoutant une jambe industrielle au Pacte vert. Pour résumer, je suis pour l’intégration de l’Ukraine à l’UE, mais aussi pour que l’UE se protège vis-à-vis de la Chine.
En ce qui concerne les produits agricoles ukrainiens, Raphaël Glucksmann reconnaît que les choses ont été mal faites et posent problème, pas tant chez nous qu’en Pologne ou en Roumanie. L’Ukraine est une grande puissance agricole, qui exporte d’ailleurs plus en dehors de l’UE qu’à l’intérieur. Il ne s’agit pas de l’empêcher de se développer. Simplement, cela ne doit pas se faire au détriment de l’agriculture française. Une nouvelle PAC, orientée vers une plus juste répartition des revenus en faveur des petites exploitations et la transition écologique, irait dans ce sens.
On partage un constat sur les problèmes à régler, mais de notre côté il y a une volonté, et de ton côté il n’y en a pas. C’est cela que je critique.
Emmanuel Maurel : Aucune volonté ? Ça fait dix ans que je me bats sur une question aussi essentielle que la souveraineté industrielle, sur le refus de certains accords de libre-échange, tout seul au sein du groupe socialiste qui me tapait dessus, car la majorité de ses membres était complètement convertie au libre-échange. Le serpent salarial européen, c’est une super idée, mais le PS la portait déjà en 1989, puis en 1994, puis en 1999… Quant au Smic européen, il n’existe pas ! C’est vrai qu’à force, j’ai développé une forme de lassitude.
Chloé Ridel : Tu ne peux pas ignorer que le contexte a changé depuis la pandémie en Europe…
Emmanuel Maurel : La pandémie, en effet, a été un moment de prise de conscience extraordinaire. Tout d’un coup, ce qui était absolument tabou à Bruxelles – par exemple les concepts de réciprocité commerciale ou de protectionnisme – devenait audible. Le problème, c’est qu’ensuite la politique menée est allée totalement à l’encontre de l’inflexion qu’il y a eu dans le discours. L’activisme libre-échangiste a repris de plus belle.
On est dans un moment décisif pour l’agriculture européenne, qui a été sacrifiée depuis les accords du GATT et de l’OMC. Or la concurrence de l’Ukraine dans ce domaine présente des risques considérables. Parce que ce n’est pas seulement la taille des exploitations qui pose problème, mais aussi les produits concernés, dont certains sont aujourd’hui interdits en Europe. Confortons déjà un certain nombre de secteurs, et après on verra.
Le risque, c’est qu’à force de faire n’importe quoi, de façon précipitée, non concertée, le projet européen se casse la gueule, purement et simplement.
Chloé Ridel : Pour moi, je le répète, il faut transformer l’Europe pour accueillir l’Ukraine, parce qu’il est faux de dire que, en l’état, on pourrait l’accueillir. Ce qui signifie que l’Europe doit devenir une vraie puissance politique et de protection. Il faudrait pour cela doubler le budget européen, et nous avons des idées de nouvelles ressources propres pour atteindre cet objectif. Si l’on ne prend pas ce chemin-là, alors là, oui, je suis d’accord, l’Union se disloquera lentement.
On a beaucoup parlé des défis socioéconomiques de l’élargissement, mais ils seraient aussi institutionnels. Quelle est votre position à cet égard ?
Emmanuel Maurel : Si on élargit à de nombreux pays et que l’UE finit par compter 36 membres, l’ensemble deviendrait ingouvernable et ce serait donc la fin de l’unanimité sur certains votes. C’est un saut fédéral. Et je pense que s’il y a des gens qui décident de ce saut fédéral, il va falloir demander l’avis aux Français, par référendum.
Chloé Ridel : Nous souhaitons faire sauter l’unanimité au Conseil sur les questions fiscales, parce que c’est ce qui empêche tout progrès en la matière. On a aujourd’hui des paradis fiscaux au sein de l’UE qui mettent leur veto à toute initiative d’harmonisation.
Sur les questions de sécurité et de défense, nous proposons aussi le passage à la majorité qualifiée, parce qu’on n’a pas envie que demain, l’Ukraine puisse mettre son veto à des décisions en la matière. Pour autant, nous sommes pour un système d’« opt out », car personne ne peut obliger une nation souveraine à appliquer des décisions de défense ou de politique étrangère avec lesquelles elle serait en désaccord.
En attendant l’adhésion ou son échec, que propose-t-on à l’Ukraine ? Plus largement, quelle politique de voisinage peut-on envisager en dehors du simple libre-échange ?
Emmanuel Maurel : Il y a déjà un accord d’association qui existe avec l’Ukraine. On ne part pas de rien. Ensuite, je pense qu’il y a d’autres solutions politiques pour affirmer sa solidarité avec des pays autour de l’Europe. Le principe d’une communauté politique européenne est intéressant.
Sur la politique de voisinage, on fait du surplace depuis presque dix ans. C’est pourtant un sujet qui mériterait un budget beaucoup plus important et une réflexion stratégique beaucoup plus conséquente. Ceci afin de réintégrer dans le jeu le Royaume-Uni, mais aussi le Sud méditerranéen, pour que les relations avec ces pays ne se résument pas à des accords sur la question migratoire. Parce qu’aujourd’hui, malheureusement, c’est le cas.
Chloé Ridel : Je trouve aussi que l’idée d’une Communauté politique européenne est intéressante. Il s’agit d’un cénacle alternatif permettant de rassembler les pays qui ne sont pas membres de l’Union européenne, pour des coopérations qui n’impliquent pas d’adhésion totale. Le problème, c’est qu’Emmanuel Macron l’a vidée de son sens en ne clarifiant pas le périmètre de cette communauté, d’où la participation d’un régime dictatorial comme celui de l’Azerbaïdjan.
Maintenant, comment doit-on se comporter vis-à-vis de l’Ukraine ? Pour nous, il faut davantage être au rendez-vous du soutien à la résistance ukrainienne. Si on s’arrête là, l’histoire retiendra que la France aura soutenu l’Ukraine à la hauteur de seulement 0,6 % de notre PIB. On a perdu deux ans depuis l’invasion totale à ergoter sur l’envoi d’armes, ce qui a conduit à donner la main à Vladimir Poutine, qui lui parie sur le fait de nous avoir à l’usure.
Nous avons l’occasion, à travers l’élargissement à l’Ukraine, de transformer l’Europe dans un sens progressiste. Notre responsabilité, en tant qu’internationalistes de gauche, c’est de montrer un chemin. Ne renonçons à rien, ni à l’accueil de l’Ukraine dans la famille européenne, ni au progrès social, ni à la protection de nos travailleurs et de notre agriculture.