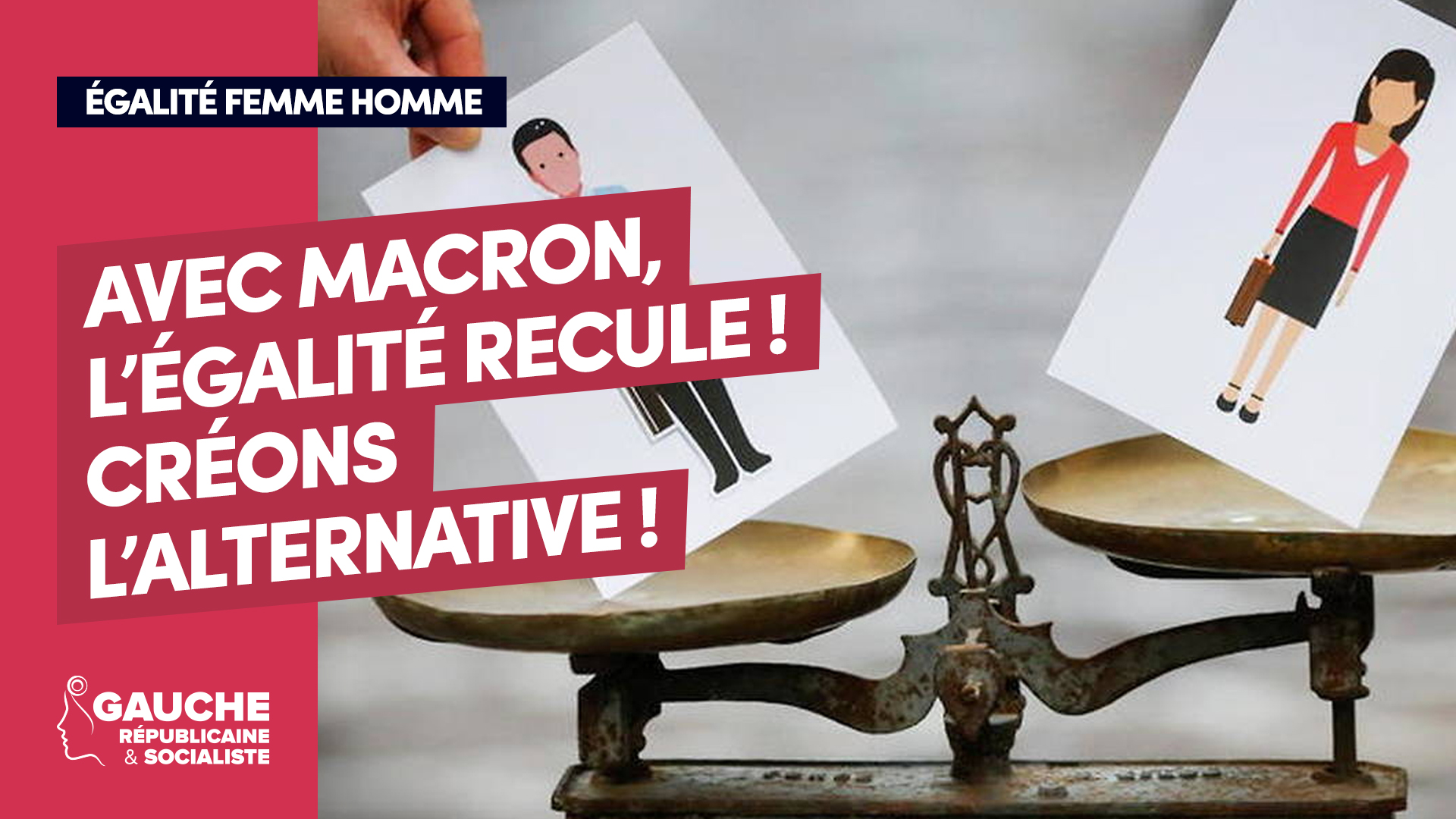Le 29 avril 1945, voici 80 ans jour pour jour, les citoyennes françaises votaient pour la première fois, lors du premier tour des élections municipales. On dit que c’est l’ordonnance du 21 avril 1944, passée alors largement inaperçue dans la France occupée, signée par le Général De Gaulle qui leur avait préalablement accordé ce droit, mais cette ordonnance venait sanctionner un débat houleux au sein de l’Assemblée Consultative de la France Libre à Alger le 24 mars 1944.
Le droit de vote féminin arraché in extremis
Le chef de la France libre s’était engagé dès le 23 juin 1942 dans cette direction : « En même temps que les Français seront libérés de l’oppression ennemie, toutes leurs libertés intérieures devront leur être rendues. Une fois l’ennemi chassé du territoire, tous les hommes et toutes les femmes de chez nous éliront l’Assemblée Nationale qui décidera souverainement des destinées du pays. » Le vote des femmes fait en effet partie du programme de modernisation de la société française voulu par de Gaulle. La question du suffrage féminin n’est pas mentionnée dans le programme du Conseil national de la Résistance en mars 1944. Aussi le Général De Gaulle confirmait le 18 mars 1944 devant l’Assemblée consultative son orientation « le régime nouveau doit comporter une représentation élue par tous les hommes et toutes les femmes de chez nous ». Un sujet sur lequel il semblait plus convaincu que nombre de ces contemporains des deux sexes et, concernant les opinions traditionalistes de certaines femmes, il s’en désolait selon son fils le futur Amiral Philippe De Gaulle : « comment ne comprennent-elles pas qu’elles doivent exprimer leur avis au plan politique et social et en particulier d’abord dans la vie locale ? N’ont- elles pas d’emprise sur la ville, sur le village ? »
Pourtant le 24 mars, les représentants des Radicaux au sein de l’Assemblée consultative s’opposent encore comme ils l’avaient fait face à la volonté des socialistes d’instaurer ce droit de vote universel lors du Front Populaire en 1936 (en juillet la Chambre des députés se prononça l’unanimité par 475 suffrages pour le suffrage féminin ; le Sénat dominé par le Parti radical n’inscrivit jamais ce texte à son ordre du jour). C’est le délégué communiste Fernand Grenier qui portera le flambeau pour que la « femme française » soit désormais électrice et éligible, « afin que nous lui manifestions notre solidarité et notre volonté de ne plus la traiter en mineure, en inférieure ». Le Sénateur radical Paul Giacobbi mène les débats et tente de limiter toute avancée réelle : voudrait n’inscrire dans la loi que le principe de l’éligibilité des femmes, s’inquiétant du déséquilibre des sexes dans la France de l’après-guerre : beaucoup d’hommes étant encore prisonniers en Allemagne, accorder le droit de vote aux Françaises n’équivaudrait-il pas à « remplacer le suffrage masculin par le suffrage féminin » ? Sacré jésuitisme ! Et il faillit bien l’emporter. Mais Fernand Grenier finit par convaincre une majorité de délégués ; au soir du 24 mars 1944, l’amendement Grenier « Les femmes seront électrices et éligibles dans les mêmes conditions que les hommes. » est finalement ratifié par l’Assemblée consultative d’Alger par 51 voix contre 16.
Voter pour le droit de vote
C’est pour cela qu’il faut souligner l’importance du vote du 29 avril 1945. Alors même que les combats ne sont pas terminés en Europe, que les troupes soviétiques affrontent les derniers carrés des fanatiques nazis dans les rues de Berlin, la veille du suicide d’Adolf Hitler, les femmes françaises décident de voter massivement pour ces élections municipales. Elles ont elles-même tordu le cou à la fable selon laquelle la majorité d’entre elles auraient considéré que ce n’était pas leur affaire, que les hommes n’avaient qu’à s’en débrouiller, qu’elles avaient des responsabilités et d’autres influences et n’avaient pas à perdre leur temps sur des questions politiques. Les femmes ont donc voté ce jour-là pour le droit de vote des femmes. Le scrutin municipal de 1945 fut fortement médiatisé, l’attention des journalistes étant presque entièrement focalisée sur le comportement des femmes, entre condescendance contre celles qui n’en maîtriseraient pas les codes et admiration pour la patience des femmes qui firent parfois plusieurs heures de queue afin d’accomplir pour la première fois cet acte citoyen. Les élections du printemps 1945 se soldèrent par une forte percée du PCF ; le vote féminin ne semble pas avoir introduit une révolution majeure dans la pratique électorale, ni déclenché la vague cléricale que redoutaient les radicaux.
Un trop long chemin
Comment ne pas souligner cependant le retard français par rapport aux autres démocraties : la Nouvelle Zélande a établi ce droit dès 1893, l’Australie en 1902 ; entre les deux guerres mondiales, d’autres pays encore nous devancèrent : la Grande-Bretagne, l’Allemagne, les Pays-Bas, les États- Unis, mais aussi l’Inde, la Turquie ou encore le Brésil. Qui se souvient de la candidature de Marie Denizard à l’élection présidentielle de 1913, de celle de Marguerite Durand aux élections législatives de 1910 ou encore de Louise Weiss qui aurait refusé d’intégrer le gouvernement Blum en répondant « j’ai lutté pour être élue, pas pour être nommée » ? Combien de temps furent méprisées et humiliées les conseillères issues des élections municipales de mai 1925, Augustine Variot à Malakoff, Marie Chaix à Saint-Denis, Marthe Tesson à Bobigny et Marguerite Chapon à Villejuif ou Joséphine Pencalet représentante des Penn Sardines en lutte de Douarnenez : il y a souvent très peu d’écarts de voix avec leurs homologues masculins puisque leurs noms sont peu rayés, preuve que l’électorat est déjà prêt pour cette avancée. Pourtant, le conseil d’Etat annulera une à une ces élections dès janvier 1926, le préfet de la Seine n’hésitant pas à envoyer la police pour empêcher Augustine Viarot de siéger en avril 1926.
Comment ne pas souligner également qu’il aura fallu que Charles De Gaulle constate, avec une forme de paternalisme, leur courage à travers deux conflits mondiaux pour qu’il soit convaincu de leur accorder des droits civiques ; finalement, cela n’allait pas de soi par le simple argument de l’égalité humaine.
Continuer le combat
Aujourd’hui, ce droit semble acquis et la parité a installé dans les assemblées soumises au scrutin de liste la place de de l’élue comme incontournable. On connaît cependant les tactiques pour contourner la parité dans les partis conservateurs (avec une forme d’expertise des LR au Sénat en la matière) et on constate de scrutins en scrutins combien de partis sont prêts à accepter de payer des amendes importantes pour ne pas respecter l’obligation de parité dans les candidatures et dans les équilibres entre les sexes dans leurs groupes parlementaires ? La proportionnelle est sans doute un combat à mener sur ce chemin inachevé. Sans parler même de la vigilance face aux offensives réactionnaires toujours vivaces.
Frédéric Faravel