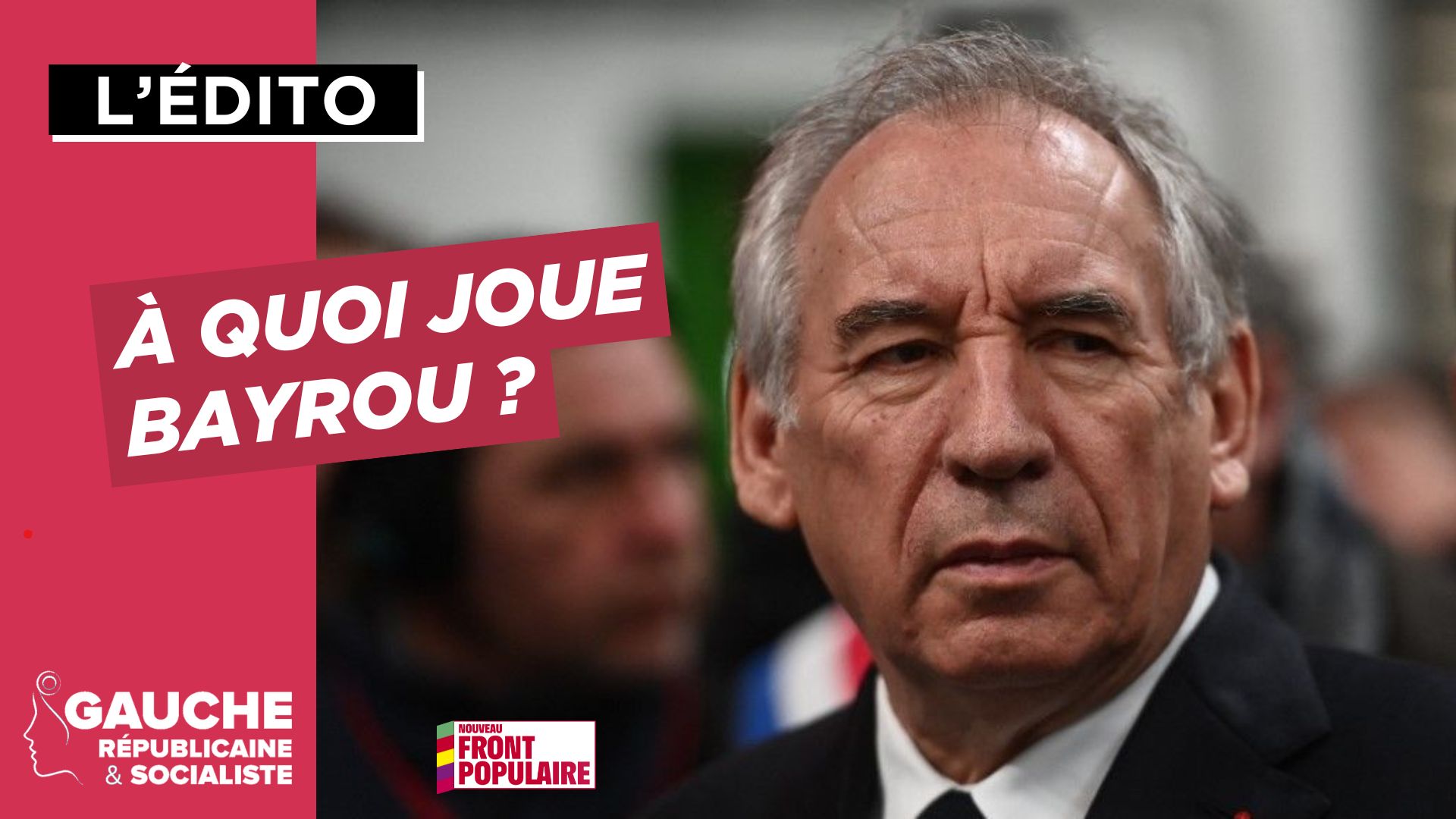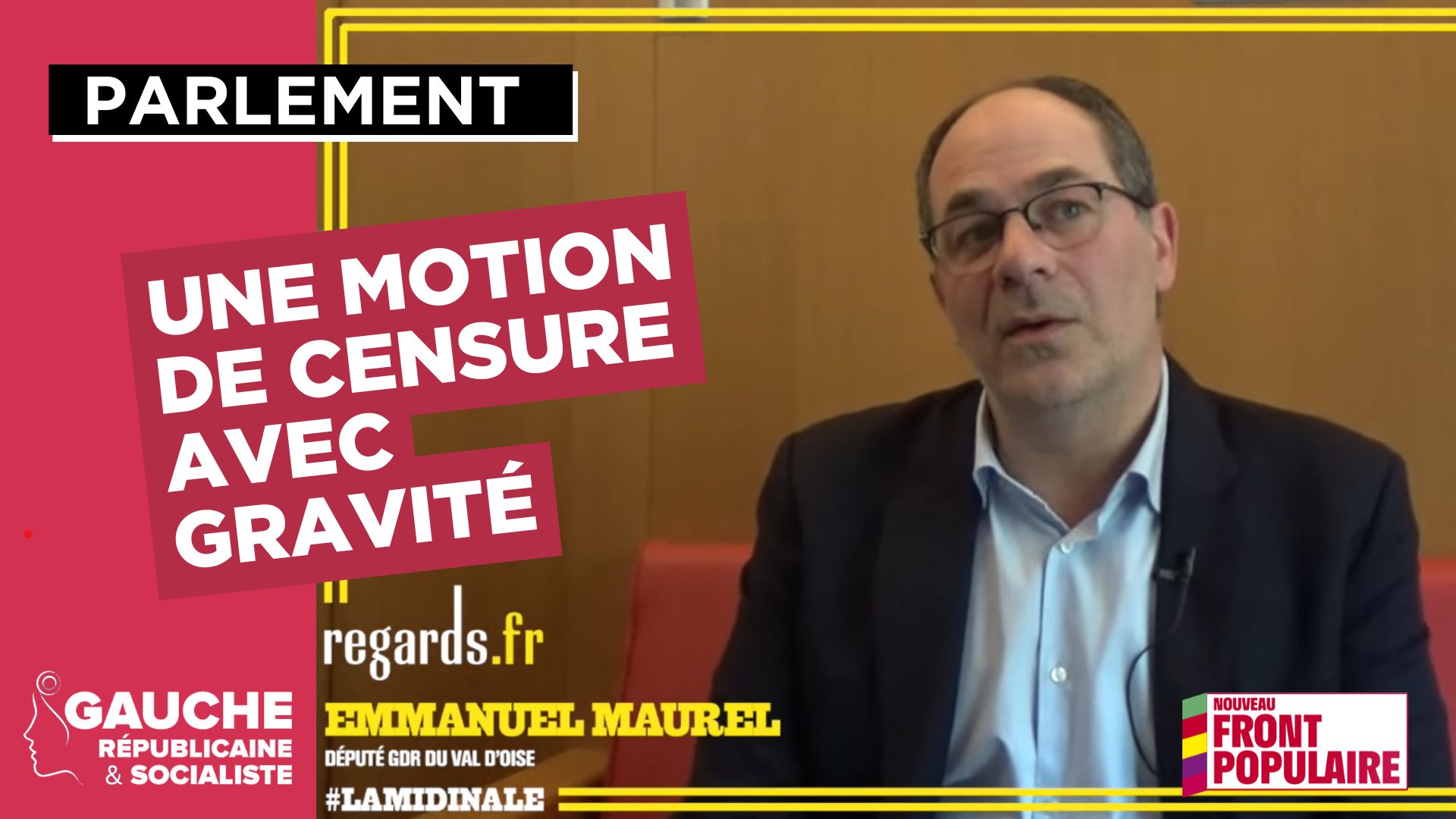Propos recueillis par Isabelle Vogtensperger et publié dans Marianne le 15 août 2024 à 18h00
Lundi dernier, le Premier ministre démissionnaire, Gabriel Attal, lançait l’idée d’un « Pacte d’Action pour les Français » destiné à opérer une large coalition parlementaire, dont seraient exclus le Rassemblement national et La France insoumise. Pour Emmanuel Maurel, fondateur de la Gauche républicaine et socialiste et député, membre du Nouveau Front populaire, il s’agit avant tout d’une tractation politicienne et d’un déni de la situation politique.
Emmanuel Maurel estime que le « Pacte d’Action » proposé par Gabriel Attal cache en réalité un désir de maintenir une gestion austéritaire des finances publiques sans réelle remise en cause de la politique menée jusqu’alors par la majorité présidentielle. Celle-là même qui a pourtant été largement désavouée par les Français aux dernières élections législatives.
La meilleure stratégie que la gauche puisse tenir est dès lors, selon lui, de défendre son programme. Et il considère que les socialistes ne s’abstiendront pas de combattre la politique de Renaissance-LR, contre laquelle ils ont lutté durant sept ans.
Marianne : Le parti présidentiel tente une large coalition (dont sont exceptés le RN et LFI) avec ce « Pacte d’action » proposé par Gabriel Attal pour réunir gauche et droite. Qu’en pensez-vous ?
Emmanuel Maurel : Je suis surpris par cette initiative du Premier ministre démissionnaire. Il aime à rappeler, comme le président, que « personne n’a gagné » les élections législatives. Mais il y a bien une coalition parlementaire qui a été battue les 30 juin et 7 juillet derniers : c’est celle qu’il dirigeait ! On dit que les relations entre les deux têtes de l’exécutif se sont distendues. Je trouve néanmoins qu’il y a une communauté de pensée qui perdure : leurs tentatives maladroites procèdent du même déni de la situation politique.
Ensuite, je ne vois pas comment on pourrait avoir une discussion féconde, de nature à déboucher sur une cohérence d’action, en s’adressant aussi bien à la gauche qu’à LR ou même à Horizons. En réalité, cette démarche est avant tout politicienne : Gabriel Attal mobilise son talent pour tenter d’accréditer l’idée que ce n’est qu’autour de son parti, pour ne pas dire de lui, qu’un équilibre pourra être trouvé.
« La maxime du Guépard est désormais dépassée : il faudrait que rien ne change pour que rien ne change ! »
Or non seulement Renaissance n’a plus les forces qui lui permettraient de prétendre à ce rôle, mais surtout, les électeurs ont clairement signifié qu’ils exigeaient un changement de cap.
Le « Pacte d’Action » qui repose avant tout sur le maintien d’une gestion austéritaire des finances publiques, ne propose rien de nouveau par rapport à la politique que les Français ont désavouée. La maxime du Guépard est désormais dépassée : il faudrait que rien ne change pour que rien ne change! En ce sens, plus qu’un « pacte d’action », on nous propose un pacte d’immobilisme.
Quelle serait la meilleure stratégie pour la gauche : se rallier à cette large coalition ou au contraire, maintenir l’union avec La France Insoumise ?
La meilleure stratégie pour la gauche est de défendre son programme. Nos concitoyens en connaissent les grandes lignes : soutien au pouvoir d’achat des classes populaires et moyennes ; redistribution des richesses en faisant davantage contribuer les plus fortunés ; sauvetage et extension des services publics, notamment l’école et l’hôpital ; planification écologique et restauration de notre base industrielle, laquelle, quoiqu’en dise Macron, continue de s’affaisser. À mon sens, c’est sur ces bases qu’il faut travailler et le Nouveau Front Populaire a des propositions solides pour relever ces défis.
Le Président de la République et ses troupes affaiblies au Parlement continuent de mépriser ces orientations. Et ils essaient de nous diviser pour tenter de les escamoter, mais ça ne marchera pas. La coalition de gauche est bien plus solide qu’ils semblent le croire. Le président avait fait une grosse erreur d’appréciation en nous pensant incapables de nous mettre d’accord sur un programme et des candidats en quelques jours après sa dissolution surprise. Il persévère dans l’erreur aujourd’hui.
Il ne m’a certes pas échappé que le NFP n’avait pas la majorité absolue à l’Assemblée nationale, et je ne verse pas dans le maximalisme du « tout ou rien » et du « nous tous seuls ». Mais la logique politique et démocratique commande de confier à la coalition arrivée en tête l’exercice du pouvoir : à charge ensuite pour nous de bâtir les majorités nécessaires au vote des réformes.
Pour Alain Minc dans Le Figaro, obtenir l’abstention des socialistes serait une stratégie habile de la part du Président – ce que ce pacte pourrait permettre d’obtenir. Qu’en pensez-vous ?
Ce que propose Alain Minc, c’est une sorte de soutien sans participation des socialistes à un gouvernement minoritaire Renaissance-LR et tout ça pour faire quoi ? Peu ou prou la même chose que depuis 2017 et a fortiori depuis 2022, c’est-à-dire une politique profondément inégalitaire et austéritaire.
Je n’imagine pas une seconde que les socialistes s’abstiennent de combattre une politique qu’ils dénoncent depuis sept ans et qu’ils ont contribué à faire battre dans les urnes cette année. Le PS est un grand parti de gouvernement, ancré territorialement, qui a bénéficié du NFP autant qu’il l’a fait progresser. Je ne le vois pas changer subitement d’orientation.
Les macronistes ont vraiment un drôle de rapport au réel. Ils essaient de résoudre la quadrature du cercle en se disant « notre politique a été battue, mais on va quand même la poursuivre, malgré – et contre – le vote des Français ». Et comme ils n’y arrivent pas, ils repoussent à nouveau les échéances : certaines éminences préconisent de repousser la nomination d’un Premier ministre non pas après les JO – c’est-à-dire maintenant – mais « fin août ou début septembre », voire après.
Le grand gagnant de ce pacte serait finalement le parti d’Emmanuel Macron. N’est-ce pas un sacrifice trop important pour les socialistes ? Un « déni de démocratie » comme dirait Mélenchon ?
Nous devons faire en sorte que les seuls « gagnants » de la période soient les Français, et singulièrement les plus vulnérables d’entre eux, qui attendent de leurs représentants qu’ils s’attaquent immédiatement aux problèmes auxquels ils sont confrontés, à commencer par le pouvoir d’achat. Ce que veulent nos compatriotes c’est que la politique soit à leur service et au service du pays. C’est à mon avis un enseignement qu’on peut tirer du scrutin des 30 juin et 7 juillet, qui a d’abord été un refus de mettre l’extrême droite au pouvoir, mais qui a aussi été un appel lancé aux responsables politiques pour qu’ils répondent enfin aux urgences économiques, sociales, écologiques, régaliennes de la France.
« Nous devons faire en sorte que les seuls « gagnants » de la période soient les Français, et singulièrement
les plus vulnérables d’entre eux »
Ce qui constituerait un « déni de démocratie » serait qu’on s’enlise dans des voies sans issues. Vouloir impulser des réformes avec seulement 193 députés en est une. Mais vouloir faire passer en douce un agenda repoussé par les électeurs en est une autre. Il faut donc essayer d’avancer en respectant la démocratie, c’est-à-dire en confiant au Nouveau Front Populaire la tâche de former un gouvernement.
Quelle gauche peut encore espérer tirer profit des tractations en cours ?
La gauche, dans sa grande diversité, est majoritairement représentée dans le Nouveau Front populaire. Chacun sait qu’elle a mis déjà beaucoup de temps (trop) à s’entendre sur un nom pour Matignon, prenant le risque de décevoir nos concitoyens qui avaient mis en elle de réels espoirs. Mais tout reste encore possible ! Macron pense que la « parenthèse enchantée » des JO lui permettra de reprendre la main, en usant justement de vaines tractations.
Je crois au contraire que les deux semaines qui viennent de s’écouler constituent pour nous un formidable point d’appui : l’esprit de concorde, l’ouverture aux autres, le patriotisme joyeux, le goût du collectif, dessinent les contours d’une France généreuse, entreprenante, solidaire que nous pouvons incarner et défendre.
Je reste convaincu que des réformes portées par la gauche – sur le SMIC, les retraites, les services publics, la politique industrielle – renforceront notre économie et notre modèle social et républicain. La France aurait tout à gagner d’une politique en faveur de la majorité des gens, qui réduit les inégalités, apaise les tensions et redonne espoir. Historiquement, elle s’est d’ailleurs toujours construite comme ça.