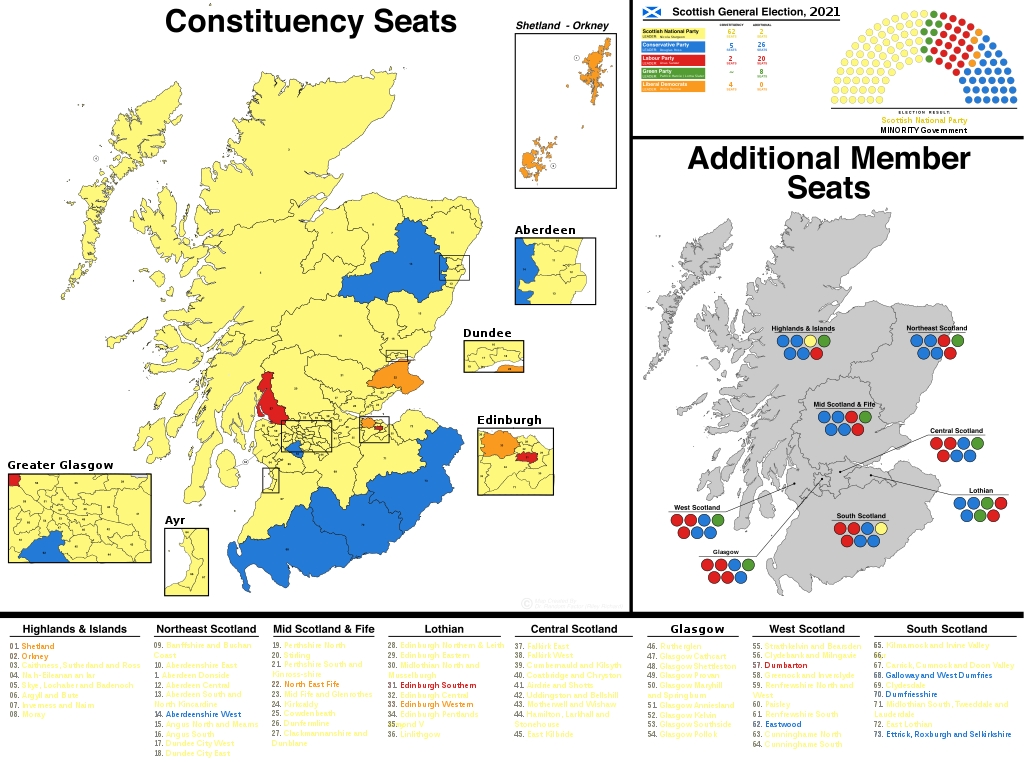Aide-soignante devenue députée, Caroline Fiat dénote, même chez les Insoumis. Entretien avec Soizic Bonvarlet, publié dans La Revue Charles, le 6 mai 2021
Lorsque nous l’avons interviewée, Caroline Fiat venait de passer sa dernière nuit au sein du service de réanimation du CHU de Nancy, avant de rejoindre les bancs de l’Assemblée. La députée de Meurthe-et-Moselle, mère de deux enfants en bas âge, avait pris la décision, comme durant la première vague, d’enfiler de nouveau sa tunique d’aide-soignante, pour monter au front dans la guerre contre l’épidémie de Covid-19. C’est d’ailleurs en grande partie à ce titre qu’elle a été nommée parmi les finalistes du prix de la femme d’influence politique 2020. Elle nous a parlé de son engagement et de ses luttes, à l’hôpital comme dans l’hémicycle.
À quand remonte votre engagement politique et quelles sont les principales raisons l’ayant motivé ?
Cela remonte à mes seize ans, donc au siècle dernier, une réforme du lycée. C’était devenu un combat pour moi car cette réforme faisait qu’en changeant les programmes, on n’avait de ce fait plus la possibilité d’acheter les manuels scolaires à la bourse aux livres. J’avais mené le combat, ce sont mes premières manifs. Mes parents, me trouvant très investie, étaient assez fiers de moi. Je séchais pour manifester et ils ne disaient rien.
Mes parents étaient à la CGT, communistes sans être encartés. Mon papa était agent technique dans un centre hospitalier et ma maman vendeuse, avant de travailler pour l’association des paralysés de France. Quand j’allais manifester avec eux il y avait souvent les Jeunesses communistes, alors plutôt que rester avec des vieux je préférais être avec des jeunes de mon âge. Et puis j’ai fini par prendre ma carte à la CGT vers l’âge de 24-25 ans. Et au Parti communiste à l’occasion de la campagne présidentielle de Robert Hue. Après tout on a tous notre croix à porter. Moi j’ai été convaincue d’adhérer au Parti communiste grâce à Robert Hue. Je ne suis pas restée adhérente longtemps, même si mon cœur restait communiste. J’avais commencé à prendre du recul dès la campagne présidentielle de 2012.
En juillet 2016, j’ai fait une grosse dépression. En septembre, je vais à la fête de l’Huma, des amis, voyant que je vais très mal, me conseillent de rejoindre le mouvement « Ensemble ! », de Clémentine Autain, pour me sortir de chez moi, voir du monde. Je me rends à quelques réunions en Meurthe-et-Moselle, et « Ensemble ! » décide d’intégrer La France insoumise, et donc j’y entre aussi. Je suivais de loin, mais je me suis vraiment investie à La France insoumise à ce moment-là.
Comment vivez-vous le fait d’être une femme à l’Assemblée nationale ? Avez-vous été surprise par le sexisme qui peut s’y exercer ? Est-il équivalent à celui que vous avez pu connaître auparavant dans votre vie professionnelle ?
Surprise, non. Le sexisme en politique a toujours existé. Je n’étais pas spécialement surprise, mais étonnée car quand j’ai été élue, on parlait de « renouvellement », du « nouveau monde » de La République en marche, avec beaucoup de femmes qui faisaient leur entrée à l’Assemblée. Donc je pensais que nous serions beaucoup à nous battre. Finalement, nous sommes 41% je crois, et très peu à lutter sur le sujet. Moi j’ai mon caractère, quand il y a trop de bavardages et que je vois qu’on ne m’écoute plus, je me tais en l’attente d’avoir de l’attention. Comme avec des enfants ! Ce qui est toujours très impressionnant, c’est l’attitude des hommes députés pendant les questions au gouvernement. Vous pouvez être sûr qu’un homme parle, l’attention est là. Là où quand une femme parle, beaucoup d’hommes discutent entre eux, sortent les téléphones etc. Donc il faut se battre pour se faire respecter. Et je pensais réellement que nous serions plus nombreuses à nous battre.
Quel pouvoir d’influence une aide-soignante, experte des enjeux liés à l’hôpital, a-t-elle à l’Assemblée, par exemple lors de l’examen des PLFSS (projet de loi de financement de la sécurité sociale) ?
Je ne dirais pas que je suis une « experte », mais je sais que je suis écoutée, et que tout du moins quand je me fâche, que j’arrive avec des affirmations, elles sont prises en compte par les autres parlementaires. Ils font attention, parce que c’est du vécu.
Je sais de quoi je parle, et il ne faut pas trop me titiller. Est-ce que cela a réellement fait bouger les lignes ? Je ne sais pas.
Vous sentez-vous d’autant plus écoutée, dans la période actuelle, sur les bancs de l’hémicycle, que vous étiez sur le front durant l’une des phases les plus virulentes de l’épidémie de Covid-19 ?
Nous sommes beaucoup à l’avoir fait durant la première vague, y compris à La République en marche ou chez Les Républicains. En ce qui me concerne, quand mes collègues se sont rendus compte qu’ils ne me voyaient pas depuis quinze jours à l’Assemblée, beaucoup m’ont envoyé des messages pour savoir si j’étais retournée travailler. Et beaucoup m’ont remerciée. Des messages bienveillants issus de députés de tous bords, pour me dire de faire attention à moi.
Sur la deuxième vague, je trouve très étonnant ce silence assourdissant par rapport aux soignants et aux malades. Je ne voulais pas qu’on soit applaudis, je ne vais donc pas m’en plaindre, mais le fait que ce ne soit plus le cas est un signe. Que l’on travaille dans des conditions anormales devient normal. Donc on n’en parle plus. Or la vie est un marathon, pas un 100 mètres. Y être allé durant la première vague, c’est bien, mais il faut continuer. Les besoins sont toujours là.
Après je pense que c’est d’autant plus facile pour moi d’y retourner que je suis restée fidèle à mes convictions. Je ne risque pas grand-chose. Là où un député de la majorité risquerait peut-être d’être mal reçu dans un service. Et par ailleurs, moi la première fois ça m’avait fait du bien psychologiquement aussi, de retourner aux sources, de ne pas devoir aller rechercher des souvenirs d’il y a trois ans, en particulier quand je devais m’exprimer à l’Assemblée.
Pourquoi ne vouliez-vous pas être applaudie ?
Parce que si j’avais conscience que beaucoup de gens applaudissaient avec conviction, pour nous soutenir et nous remercier, je voyais aussi l’effet de mode. Et puis surtout, il y avait les applaudissements dans l’hémicycle. En février 2020, un mois avant la première vague, une infirmière avait été égorgée sur son lieu de travail, j’avais demandé une minute de silence à l’Assemblée. Richard Ferrand avait refusé, et un mois après, ils applaudissaient tous. Ça ne passe pas.
Comment avez-vous vécu cette période ? Vous sentiez-vous alors plus utile dans l’exercice de votre métier ou de votre mandat ?
Je me sentais aussi utile dans un rôle que dans l’autre. Mais encore une fois, psychologiquement ça m’a fait du bien d’y retourner. J’embauchais à 19h, je quittais à 7h, c’était du concret, je savais ce que j’avais fait et pour quels résultats, même s’ils n’étaient pas forcément positifs. Là où quand vous êtes parlementaire, vous pouvez travailler vingt-quatre heures sur vingt-quatre, les résultats vous ne les voyez pas.
Comment avez-vous géré, entre votre travail en réa, celui en tant que parlementaire et votre vie de famille ?
Pour la deuxième vague, cela a été presque plus simple. Pour la première, je n’étais heureusement pas toute seule, mon mari assurait. Je travaillais de nuit, je dormais un peu le matin, et au réveil il y avait « continuité pédagogique » avec mes enfants, qui ont 6 et 8 ans. Cette fois, comme ils allaient à l’école, j’ai pu me reposer un peu. Et puis pour le travail parlementaire, il y avait mes collaborateurs, avec qui j’échangeais l’après-midi.
Mais ce qui était dur, pour moi comme pour tant d’autres, c’est qu’il n’y avait plus de vie de famille. Pas de bisous ni de câlins, je dormais dans la chambre d’amis, je ne prenais presque plus mes repas à côté d’eux. Car même si vous vous êtes protégé, vous n’êtes jamais à l’abri.
Jean-Luc Mélenchon, votre président de groupe à l’Assemblée, a-t-il été particulièrement admiratif de cette décision que vous avez prise ?
Tous mes collègues sont fiers de moi, mais Jean-Luc Mélenchon, au-delà de ça, il a eu peur pour moi. Et ce même si je lui disais que j’étais malgré tout presque plus protégée à l’hôpital, que lui ou d’autres en allant acheter leur kilo de sucre au supermarché.
Il y avait une vraie anxiété chez lui par rapport au fait que je puisse tomber malade, je pense que c’est la raison pour laquelle il m’a mise beaucoup en avant durant cette période. Et puis parce qu’il sait que je suis maman, que je m’investis déjà beaucoup en tant que parlementaire, et qu’il m’arrive d’être fatiguée. Surtout la deuxième fois, à l’issue des débats sur le PLFSS.
Mais je trouve ça mignon, ça prouve que le méchant Jean-Luc Mélenchon, qui ne fait soi-disant que grogner, hurler ou insulter tout le monde, est en fait un vrai gentil. Le soir où il a annoncé sa candidature pour 2022, je travaillais. Je n’ai rien suivi de la soirée, mais il y avait une réunion en visio. J’ai fait une pause pour fumer ma cigarette, et je me suis connectée quelques minutes. Jean-Luc était tout content de me dire qu’il m’avait citée au journal de 20 heures. Je le savais, j’avais déjà reçu à peu près 5000 messages… Il se bouffe de l’intérieur tellement il se fait de souci pour les autres. Au début de la première vague, j’en plaisantais, mais j’ai vite compris qu’il avait vraiment peur. Donc j’ai arrêté, et j’ai commencé à le rassurer, à lui envoyer des messages régulièrement dans lesquels je lui disais que je n’avais pas de température, que j’allais bien.
Le « Ségur de la Santé » qui avait été lancé par le gouvernement, est-il en mesure d’améliorer le quotidien des soignants ?
Non. Il fallait une augmentation de 300 euros. Les syndicats n’ont pas balancé un chiffre irréfléchi. Au final, on a 183 euros. On ne crache pas dessus, sauf que ce n’est pas assez. Dans des régions transfrontalières comme la mienne, si on veut récupérer les 40 000 soignants qui travaillent en Belgique, au Luxembourg ou en Suisse, il faut 300 euros, cela représente l’écart moyen de salaire, combiné au coût du transport. Il faut des moyens humains. Beaucoup d’hôpitaux manquent de personnel. Au CHU de Nancy, lors de la première vague on avait 40 postes vacants, tout simplement parce que cela revient cher de se loger dans des métropoles. Les 300 euros étaient donc largement justifiés. Et donc non, le Ségur n’apporte pas les réponses nécessaires. D’autant que tous les personnels n’ont pas droit à cette augmentation.
Qu’aviez-vous pensé de la répression de la manifestation du 16 juin 2020, qui s’était notamment abattue sur une infirmière, Farida C. ?
J’y étais. Nous sommes arrivés aux Invalides, donc aux abords de l’Assemblée nationale, il y avait plusieurs cordons de CRS. J’avais pourtant ma tunique d’aide-soignante et mon écharpe tricolore, on s’est pris des gaz lacrymogènes, c’était d’une violence inouïe. Il y avait une trentaine de personnes habillées en noir qui faisaient n’importe quoi, mais en voyant le nombre de CRS au kilomètre carré, j’ai pensé qu’ils allaient les entourer, pour protéger les soignants et nous laisser terminer notre manifestation bon enfant. Ce n’est pas ce qu’ils ont fait. On nous a gazés, c’était du jamais-vu. On les regardait en se disant que la prochaine fois que l’un d’entre eux arriverait avec un collègue blessé, on n’aurait peut-être pas envie de les soigner. Policiers, gendarmes, avec les soignants on travaille souvent ensemble, et là c’était l’incompréhension totale. D’autant qu’il y avait très très peu de casseurs. Concernant l’infirmière, elle était fatiguée, excédée de la situation. Je lui ai apporté mon soutien. Se faire gazer alors que nous venions de traverser des mois très difficiles, ce n’était peut-être pas la meilleure réponse.
Comment jugez-vous la situation actuelle au regard de l’épidémie et des dispositions prises par le gouvernement ?
Cela génère en moi de la colère, car c’est du bricolage. Depuis le premier déconfinement on leur a dit qu’ils allaient droit dans le mur, qu’ils ne prévoyaient rien, qu’il fallait planifier la deuxième vague, pour être prêts. A l’Assemblée, on a fait des auditions, des commissions d’enquête. Le 16 juillet, j’ai interpellé le Premier ministre pour lui dire que suite à l’annonce de Jérôme Salomon quant à la possibilité d’une deuxième vague, les établissements de santé n’étaient pas prêts, et qu’il fallait débloquer de l’argent immédiatement, notamment pour embaucher. Ils ne l’ont pas fait. Quand fin octobre, on entend que la deuxième vague arrive, et que comme tous nos amis européens, on ne l’a pas vue arriver, vous ne pouvez qu’être en colère. Qu’ils ne m’aient pas écoutée moi, d’accord, mais enfin c’est le directeur général de la Santé qui l’annonce. Qu’ont-ils fait entre le 16 juillet et fin octobre ? Rien. Nous avions moins de lits de réa qu’avant la première vague. Bref, ce serait bien que Messieurs Castex et Véran aient parfois les pieds sur terre et qu’ils redescendent un tant soit peu.
Vous auriez été pour un confinement plus strict jusqu’à maintenant ?
Sincèrement, bien malin celui qui affirme « moi à leur place, j’aurais pris telle ou telle décision ». C’est pour cela que par ailleurs j’attaque assez rarement en frontal. Il y a des moments-clés où je savais ce qu’il fallait faire, là oui j’attaque.
J’ai entendu, par exemple, l’engouement des gens pour Noël et le nouvel an. Entendu aussi les difficultés d’Olivier Véran à répondre. Moi par rapport à ça, j’aurais eu une toute autre vision. J’aurais été plus cash, c’est clairement ma casquette de soignante qui aurait pris le dessus, en disant aux gens qu’on allait peut-être se passer une fois de fêter Noël et le nouvel an, dans l’optique de garder des gens vivants avec qui l’on pourra passer plein d’autres fêtes. Alors oui, c’est chiant, il y a plein de gens qui font des dépressions, mais aller faire Noël avec mamie Jeannette pour qu’elle ne soit pas seule, mais que quinze jours après elle se retrouve en réa, et culpabiliser d’en avoir été un peu responsable, je ne suis pas sûre qu’on aille beaucoup mieux après. Je pense qu’il faut être ferme, se dire que pendant qu’on espérait pouvoir fêter Noël, les soignants, déjà exténués, n’ont pas eu de vacances du tout. Ils ne se sont même pas posé la question de savoir s’ils auraient un réveillon, mais juste un seul jour de repos.
Quel regard portez-vous sur la commission d’enquête parlementaire relative à la gestion de la crise sanitaire, dissoute en janvier dernier, et au sein de laquelle vous avez été particulièrement impliquée ?
Elle était très suivie au départ, et après les vacances d’été, c’est retombé. Et puis c’est sous serment, mais quand les auditionnés n’ont pas envie de répondre, ils ne répondent pas. Je sais que ce n’est pas un tribunal, mais la semaine dernière il y a eu l’audition d’Olivier Véran, je travaillais donc c’est ma collègue Bénédicte Taurine qui a posé ma question, il ne répond pas du tout. Je voulais absolument savoir si Agnès Buzyn l’avait prévenu lors de la passation de pouvoir, qu’il n’y avait pas de masques et que ça allait être un « tsunami », comme elle l’a dit ensuite. C’est une information importante. Il ne répond pas. Et donc on baisse un peu les bras. Au Sénat ils y arrivent mieux, donc on laisse un peu faire les collègues sénateurs.
Moi je pense qu’il faut assumer. Olivier Véran ou Agnès Buzyn seraient arrivés devant les caméras en disant « bon les gars, on a merdé, en septembre 2019, les masques étaient périmés, on les a brûlés, par souci d’économies on n’en a pas racheté, pensant que ce serait inutile, et pas de bol, on a eu une pandémie six mois après », tout en soulignant l’importance du port du masque dès qu’on en aurait, ils se seraient grandis. Et ça leur aurait évité de se contredire à trois mois d’intervalle.
Le contexte est dégradé du point de vue sanitaire, mais aussi sécuritaire. Particulièrement suite à l’assassinat de Samuel Paty, les « Insoumis » ont dû faire face à l’invective et se sont vus attribuer le qualificatif d’« islamogauchistes », quand il n’étaient pas accusés de nourrir des « ambiguïtés avec le cadre républicain », pour reprendre les mots d’Anne Hidalgo. Comment vivez-vous cela ?
Premièrement, ce terme ne veut rien dire. Deuxièmement, il faut bien faire attention à ce que l’on dit et aux attaques que l’on profère, car cela revient à nous mettre des cibles dans le dos. Si demain il arrive quoique ce soit à l’un d’entre nous, ce ne sera pas la peine, et j’ai déjà prévenu, de se mettre debout pendant une minute dans l’hémicycle. En pleine période de terrorisme, où l’on a besoin d’unité nationale, où il faut expliquer aux gens que rien ne se règle par la violence, où il faut débattre, parler sereinement, quel est l’intérêt d’aller dire « ce sont des islamogauchistes, allez-y ! » Mais où sommes-nous ? On marche sur la tête ! Il faut soutenir toutes les religions, mais pas les Musulmans ? Je précise que je suis une bille dans le registre de la laïcité, ce n’est pas mon sujet, mais enfin, une mosquée est attaquée, il y a une marche qui est organisée en soutien, on se fait traiter d’islamogauchistes, Mireille Knoll est tuée, on va manifester, on se fait exfiltrer… On ne peut plus apporter son soutien quand une religion est visée ?
Le terrorisme n’est pas lié à l’islam religieux, mais à l’islam politique, et moi je suis très triste de voir des personnes musulmanes insultées, qui se sentent mal en raison d’une religion mal perçue. Et par ailleurs, faire trop de politique politicienne autour des religions, je pense définitivement que ce n’est pas bon.