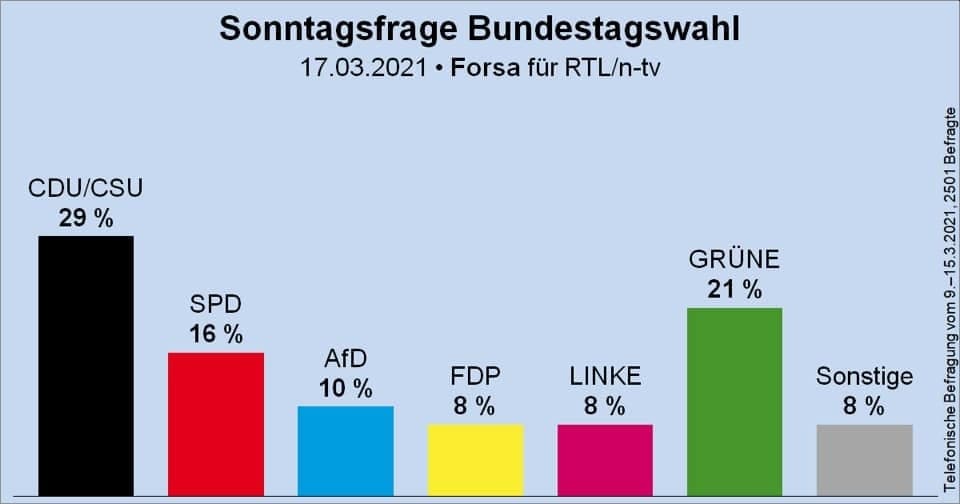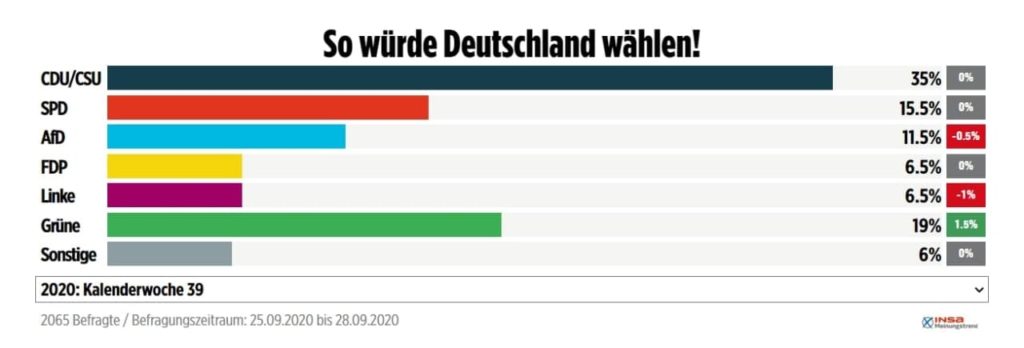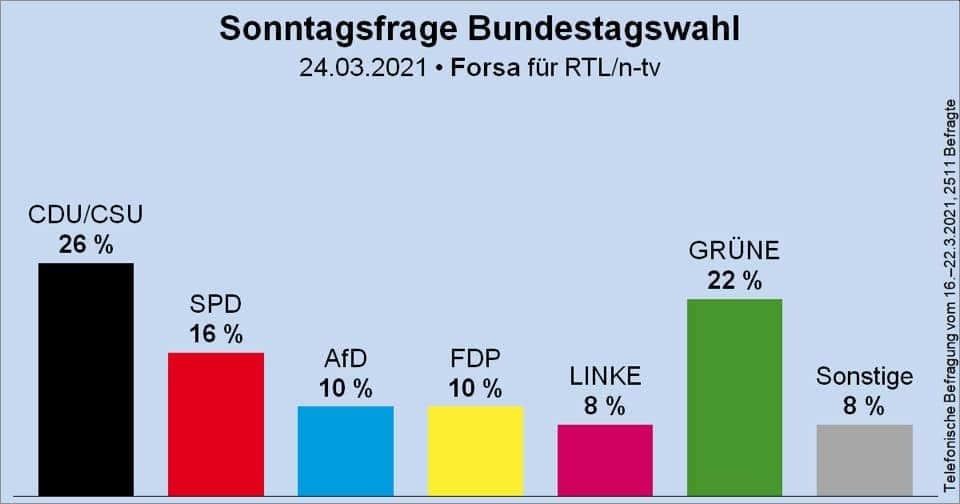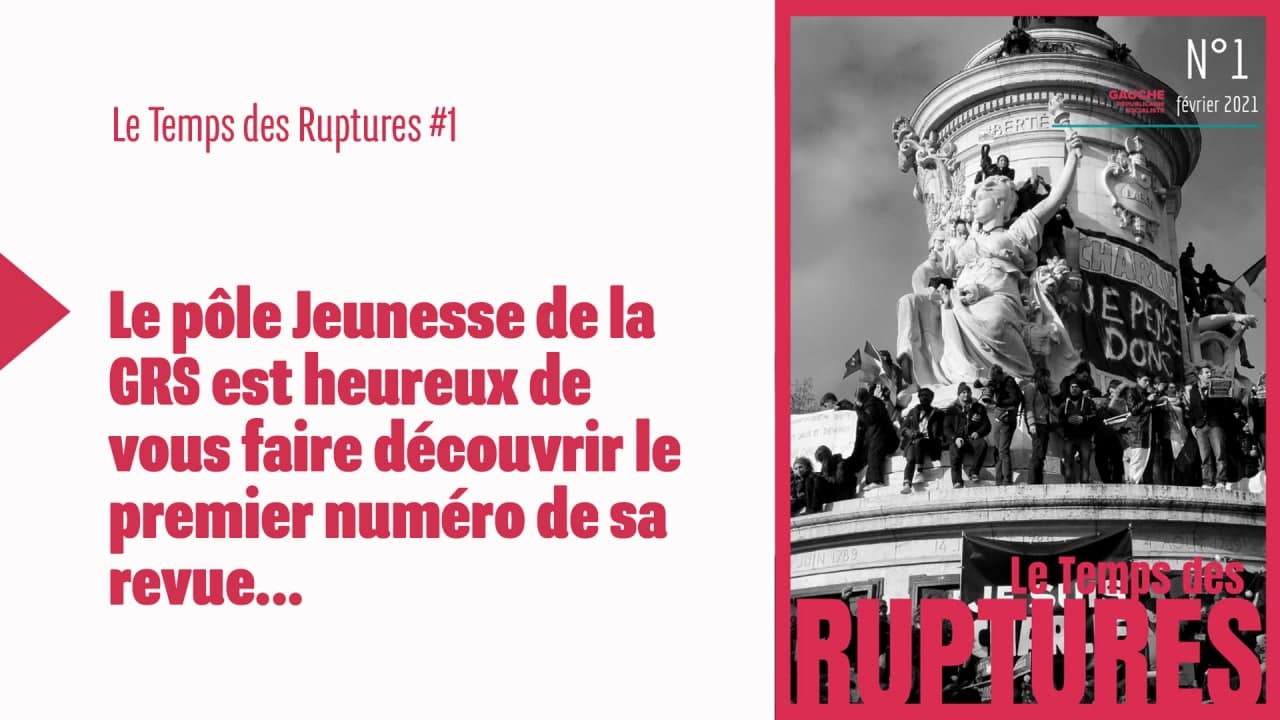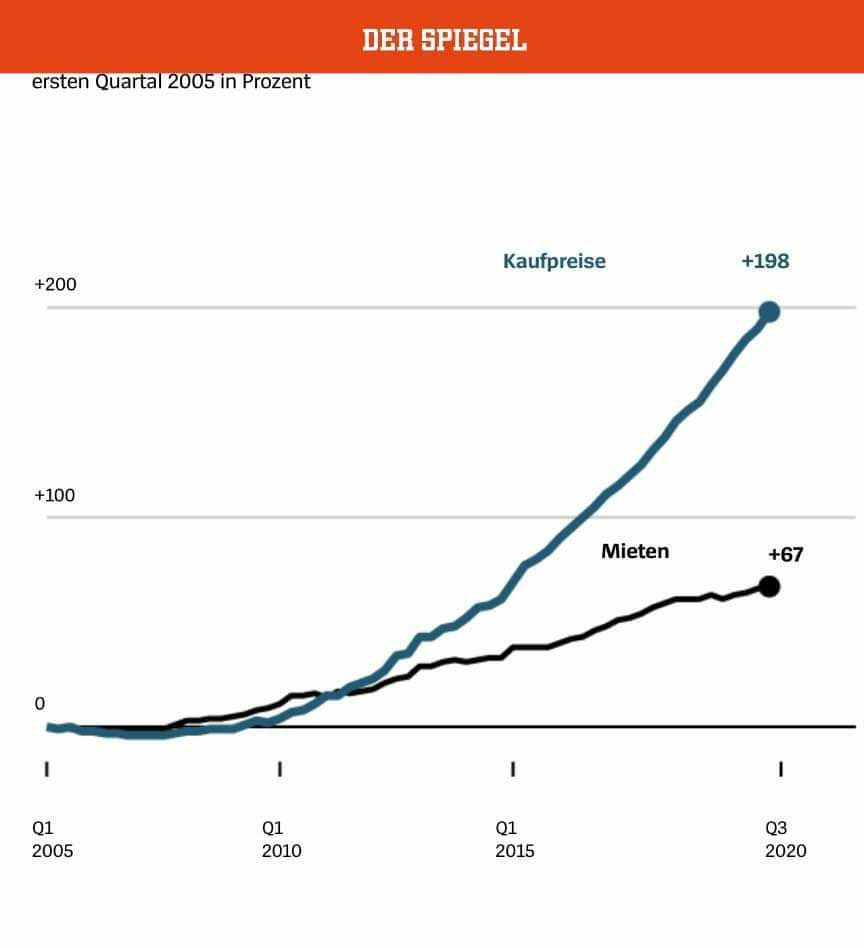Le décès du Prince Philip aura peut-être offert un fragile répit à la province du Nord de l’Irlande. En effet, certains initiateurs unionistes des manifestations prévues pour le week-end avaient appelé à leur suspension vendredi soir par « respect pour la reine et pour la famille royale ». Des heurts ont cependant à nouveau éclaté dans la soirée, mais d’une ampleur moindre que ces deux dernières semaines. Alors que cette semaine correspond tout à la fois au 105e anniversaire de la Révolution irlandaise de Pâques 1916 et au 23e anniversaire du « Good Friday Agreement »1 qui a ramené la paix dans la partie de l »Île toujours rattachée au Royaume Uni, qu’est-ce qui explique cette flambée de violence ?
Après plusieurs jours de tension et d’accrochage, les événements ont particulièrement dégénéré dans la nuit du 7 au 8 avril qui ont donné lieu à une sorte de « déjà-vu » qu’on pensait enterré. Une foule « unioniste »2 s’est rassemblée sur Lanark Way, à Belfast, « où un autobus a été incendié », ont rapporté les forces de la police nord-irlandaise. Des incendies ont été signalés sur cette avenue, où d’énormes barrières métalliques séparent un quartier catholique d’un quartier protestant, selon la correspondante de la BBC, Emma Vardy. Des centaines de personnes ont jeté des cocktails Molotov. La circulation du métro a été suspendue. Depuis le 29 mars, chaque nuit apporte son nouveau lot d’échauffourées et de violence. Des groupes d’adolescents, certains âgés d’une douzaine d’années seulement, armés de briques, de barres de fer et de cocktails Molotov, affrontent des forces de l’ordre retranchées derrière des Land Rover blindées et des canons à eau. Les jeunes assaillants sont généralement quelques dizaines, quelques centaines dans le pire des cas, souvent encouragés et applaudis par les adultes, parfois manipulés par des groupes paramilitaires unionistes. La police d’Irlande du Nord accuse notamment deux groupes paramilitaires unionistes de manipuler les jeunes émeutiers : l’Ulster Volunteer Force (UVF)3 et l’Ulster Defence Association (UDA)4.
Face aux émeutes déclenchées à l’initiative de jeunes manifestants unionistes, la première ministre nord-irlandaise, Arlene Foster, a déclaré sur Twitter dans la nuit du 7 au 8 avril : « Il ne s’agit pas d’une manifestation. C’est du vandalisme et une tentative de meurtre. Ces actions ne représentent ni l’unionisme ni le loyalisme. » Pourtant ce tweet cache mal le fait qu’elle est en grande partie responsable de la situation. Son parti, le Democratic Unionist Party (DUP)5, et elle-même avaient mené une campagne acharnée en faveur du Brexit aux côtés d’une partie des conservateurs britannique et de Boris Johnson ; un temps indispensable à la majorité parlementaire de Theresa May, le DUP avait également compliqué les négociations déjà invraisemblables entre le Royaume Uni et l’Union européenne (UE) pour organiser la sortie du premier de la seconde. Arlene Foster fait donc face aux conséquences directes de ce choix politique qui n’avait d’ailleurs pas été suivi dans la province puisque les citoyens d’Irlande du Nord avait voté à 55% en faveur du maintien dans l’UE.
Conséquences du Brexit et effet révélateur
Or l’accord de paix signé en 1998 a estompé la frontière entre la province britannique et la République d’Irlande ; le Brexit est donc venu fragiliser le délicat équilibre, en nécessitant l’introduction des contrôles douaniers entre Royaume-Uni et UE. Après d’âpres négociations, Londres et Bruxelles sont parvenus à s’accorder sur une solution, le protocole nord-irlandais, qui permet d’éviter le retour à une frontière physique sur l’île d’Irlande en déplaçant les contrôles dans les ports nord-irlandais. Si des dispositions ont été prises pour accompagner les entreprises de la province face à cette transformation, les nouvelles dispositions, qui, de fait, maintiennent l’Irlande du Nord dans l’union douanière et le marché unique européens, entraînent des perturbations dans les approvisionnements. Au début du mois de mars 2021, le premier ministre britannique, Boris Johnson, avait été confronté, lors d’une visite en Irlande du Nord, à un mécontentement croissant sur les conséquences du Brexit. Favorable à un abandon pur et simple des contrôles sur les marchandises en provenance de Grande-Bretagne, Arlene Foster a jugé « intolérable » les dispositions entrées en vigueur le 1er janvier dernier. De son côté, Michelle O’Neill, vice premier ministre de la province et leader du Sinn Féin6 pour l’Irlande du Nord, a refusé de le rencontrer, lui reprochant son « approche téméraire et partisane » vis-à-vis du protocole nord-irlandais.
Mais, plus profonde une partie importante de la population unioniste éprouve un sentiment de trahison. Les émeutiers s’intéressent peu à la complexité des questions commerciales nées du Brexit, mais « sont en colère » car ils comprennent (enfin) qu’ils ont été trahis précisément par le gouvernement britannique envers lequel leurs parents, leurs grands-parents et leurs arrière-grands-parents faisaient preuve d’une loyauté aveugle. Boris Johnson avait promis une circulation sans entrave entre la province et la Grande Bretagne, ce qui n’est évidemment pas le cas. la ministre de la justice nord-irlandaise, Naomi Long (membre du parti de l’alliance7) a ainsi résumé la situation sur la BBC4 : « Ils ont nié l’existence de toute frontière, alors même que ces frontières étaient érigées ».
Certains pensent également que les négociateurs du Brexit ont cédé aux nationalistes, qui aurait tacitement menacé d’une réponse sanglante à la perspective de toute reprise des contrôles à la frontière irlandaise. En réalité, les responsables nationalistes de la province – y compris ceux qui n’ont jamais pris part aux agissements paramilitaires – s’étaient publiquement inquiétés que le rétablissement de la frontière ne déclenche des troubles. « Cela a créé un précédent explosif selon lequel beaucoup de jeunes loyalistes regardent le protocole et arrivent à la conclusion que la violence est récompensée », a déclaré le militant unioniste Jamie Bryson au journal News Letter.
Les braises de la « guerre civile » toujours chaudes 23 ans après ?
Mais le Brexit ne représente que l’un des aspects d’une crise plus large chez les Unionistes en Irlande du Nord. En 2017, ils ont perdu leur majorité historique à l’Assemblée régionale de Stormont. Puis, en 2019, les élections britanniques ont, pour la première fois, envoyé plus de députés nationalistes que d’unionistes à Westminster. S’y ajoutent les signes d’un mouvement démographique, avec la jeune génération, vers les nationalistes, donnant aux unionistes le sentiment d’être une minorité assiégée.
Dans ce contexte, l’Irlande du Nord est tout juste sorti de sa deuxième crise institutionnelle. De 2017 à 2020, le DUP a choisi une stratégie d’obstruction après la perte de la majorité unioniste au parlement de Stormont, refusant de reconstituer le gouvernement provincial qui regroupe les cinq grands partis d’Irlande du Nord. Indispensable à Theresa May, le DUP tenu contre vents et marées dictant une bonne partie des décisions concernant la province depuis Westminster où le gouvernement britannique avait été contraint de gérer les affaires courantes en l’absence de gouvernement provincial. Les choses ont changé lors qu’Arlene Foster, comme son prédécesseur Peter Robinson avant elle, a été prise dans un scandale politico-financier qui a largement entamé son « crédit » politique. Sinn Féin, SDLP8 et Alliance Party ont eu beau jeu dès lors d’exiger soit le retrait d’Arlene Foster ou ses excuses publiques avant de reconsidérer la possibilité de reformer un gouvernement multipartite. En 2019, une fois Boris Johnson débarrassé de l’épée de Damoclès du DUP qui avait pénalisé Theresa May au sein de la Chambre des Communes, la position d’Arlene Foster était devenu fragile. Les négociations pour un gouvernement provincial ont repris et ont abouti à sa reformation en janvier 2020, toujours avec Arlene Foster en premier ministre, mais dans lequel les positions des nationalistes irlandais et en premier du Sinn Féin étaient renforcées.
Ce dernier a d’ailleurs logiquement utilisé toute la période qui a suivi le référendum sur le Brexit pour plaider avec force d’arguments en faveur d’une réunification de l’Irlande : le Brexit est un choix anglais ; les citoyens d’Irlande du Nord ne souhaitaient pas quitter l’UE (et pour atteindre 55% en faveur du maintien, il a bien fallu que des « Protestants » votent aussi contre le Brexit) ; la réunification de l’Irlande permettra à tous les citoyens irlandais au nord comme au sud de bénéficier du rétablissement d’une situation économique déséquilibrée. Le Sinn Féin bénéficie d’une véritable efficacité politique car il est le seul parti depuis 20 ans à être présent dans les deux parties de l’Île (il est l’opposition au gouvernement libéral-conservateur de la République, il participe au gouvernement provincial du nord avec le poste de vice premier ministre depuis mai 2007). La crise sanitaire a évidemment ralenti cette campagne mais ne l’a pas arrêtée et les pénuries résultant de l’application de l’accord commercial entre l’UE et la Grande-Bretagne depuis janvier 2021 ont renforcé son point de vue. « Nous pensons qu’un référendum [d’unification] peut être organisé dans les cinq ans », déclarait le 2 mars 2021 Mary Lou McDonald, présidente du Sinn Féin et cheffe de l’opposition en République d’Irlande,. Sa stratégie est de développer initialement une unification économique. Elle évoque, par exemple, la mise en place d’un système de santé unifié.
Les tenants de l’Unionisme sont donc particulièrement sur la défensive. Ces dernières semaines, les leaders unionistes ont tenté d’attaquer l’image des dirigeants du Sinn Féin pour enrayer leur chute. Cela a culminé voici quelques semaines. En effet, à la fin du mois de mars 2021, le responsable du service de police de l’Irlande du Nord (PSNI) décidé de ne pas poursuivre vingt-quatre responsables du Sinn Féin qui avaient assisté, à la fin de juin 2020, aux obsèques de Bobby Storey, qui aurait été le chef du renseignement de l’Armée républicaine irlandaise (IRA), malgré les restrictions en vigueur contre l’épidémie due au coronavirus. La présence dans la foule de Michelle O’Neill et de Mary Lou McDonald a été perçue par une partie des Unionistes les plus intransigeants comme un bras d’honneur fait au fragile équilibre politique dans la province. Qu’importe si Michelle O’Neill a présenté des excuses pour ne pas avoir respecté les règles de distanciation physique. Les principaux partis unionistes ont appelé le chef du PSNI, Simon Byrne, à démissionner, affirmant que les communautés avaient perdu confiance en son autorité. Arlene Foster a affirmé que l’adhésion de la population aux restrictions était menacée en raison de la perte de confiance dans la loi et l’ordre causée par la décision de ne pas poursuivre les membres du Sinn Féin. C’est là aussi toute la limite de cette campagne : si Mme Foster (dont la crédibilité est-elle profondément écornée) jugeait que la présence à cet enterrement était inacceptable (et pire que ses propres turpitudes) alors elle pouvait décider de ne plus collaborer avec le Sinn Féin et mettre fin au gouvernement autonome. Elle a choisi de continuer de diriger la province avec des dirigeants qu’elle cherche pourtant chaque jour à salir dans l’opinion publique. On ne peut imaginer grand écart plus inconfortable, mais il est certain que le feu couvant a été alimenté par de nombreuses giclées d’huile d’Arlene Foster.
Notons pour finir de décrire le contexte que des opérations de police contre le trafic de drogue dans le comté d’Antrim, sur lequel l’Ulster Defence Association (UDA) a la mainmise, ont également contribué à attiser les tensions dans la province ; l’UDA cherche sans doute au travers des émeutes a réaffirmé sa capacité de nuisance et à forcer les autorités à la « laisser en paix ».
Appels au calme
Depuis plusieurs jours, les appels au calme se multiplient de tous les côtés. Après avoir longtemps soufflé sur les braises ou ignoré la situation, les classes politiques britannique, irlandaise et nord-irlandaise ont finalement appelé au calme jeudi 8 avril. Boris Johnson s’est exprimé pour la première fois, se disant « profondément préoccupé ». Le gouvernement nord-irlandais a publié une déclaration commune : « La destruction, la violence et les menaces de violence sont complètement inacceptables et injustifiables, quelles que soient les inquiétudes que puissent avoir les communautés. » Naomi Long, ministre provinciale de la Justice (précédemment citée), a expliqué comprendre le sentiment de colère des Unionistes : « Même la plupart des gens qui s’opposent au Brexit ont une certaine sympathie pour ceux qui se sentent trahis. On leur avait promis des lendemains merveilleux mais c’était un fantasme. Le Brexit n’allait jamais se terminer de cette façon. Ceux qui sont au gouvernement [britannique] le savaient, mais ils étaient plus intéressés par leur ascension vers le pouvoir que par les questions d’instabilité en Irlande du Nord. »
Tout en dénonçant les manipulations du DUP que nous avons décrites plus haut, le Sinn Féin a tout à la fois appelé les dirigeants politiques à s’unir pour mettre fin aux émeutes et placé les dirigeants unionistes devant leurs contradictions : « Aujourd’hui, nous devons être unis pour appeler toutes les parties concernées à s’abstenir de nouvelles menaces ou de recourir à la violence et appeler ceux qui dirigent les jeunes à s’engager dans la violence à cesser. Il y a de la place pour tout le monde dans le processus politique, mais il n’y a aucune place dans la société pour ceux qui sont armés et illégaux et qui devraient se dissoudre. Vous êtes les ennemis de la paix. Ceux qui sont impliqués dans la violence, les dommages criminels, la manipulation de nos jeunes et les attaques contre la police doivent cesser. »
« Soulignant que la violence est inacceptable, ils ont appelé au calme, a réagi Dublin. C’est par le dialogue et un travail sur les institutions mises en place par l’accord du Vendredi saint qu’il faut avancer. » La Maison Blanche a également appelé au calme, se disant « préoccupée » par ces violences qui interviennent alors que le président des Etats-Unis, Joe Biden, fier de ses origines irlandaises, avait déjà exprimé ses inquiétudes concernant les conséquences du Brexit pour la paix dans la province.
La situation est préoccupante car le gouvernement et l’opinion publique britanniques ne semblent pas prendre la mesure de la situation, alors même que le feu couve depuis 2016. Sur Twitter, Jennifer Cassidy, chercheuse irlandaise en diplomatie à l’université d’Oxford, s’interrogeait ainsi sur le relatif silence des médias britanniques : « Si ces violences avaient lieu dans n’importe quelle autre partie du Royaume-Uni, il y aurait une couverture médiatique vingt-quatre heures sur vingt-quatre, des appels au calme, à la paix, des discours pendant des heures auParlement. Mais parce que c’est l’Irlande du Nord, vous pensez que dire “ ne faites pas ça ” suffira ? Réagissez. »
Car les émeutes sont bien le révélateur d’un mal beaucoup plus profond qui ne se résoudra que par des choix et des initiatives politiques inédites et sans doute iconoclastes. Sans cela, la guerre civile pourrait renaître dans la province sous une forme nouvelle. La situation actuelle participe en tous les cas d’un processus de délitement progressif du Royaume-Uni.
Aux racines du conflits nord-irlandais
Nous n’allons pas revenir ici sur un conflit colonial qui est né voici près de 800 ans avec la volonté anglaise de conquérir l’Irlande, ambition relancée à compter de la dynastie des Tudor à la Renaissance. La conquête et la domination ethno-politique de l’île Verte par la monarchie de l’île voisine s’est doublé à compter du début du XVIIème siècle d’un conflit politico-confessionnel, la monarchie britannique réservant le pouvoir et les droits civiques aux Anglicans et aux Presbytériens d’origine écossaise, minoritaires sauf en Uslter la province du nord-est qui a fait l’objet d’une véritable stratégie de colonisation et d’implantation agricoles de populations protestantes écossaises.
L’influence de la Révolution française puis le processus d’émancipation progressive des catholiques de la monarchie britannique ont conduit au réveil de l’identité nationale irlandaise, à la fin du XVIIIème siècle. Le ressentiment contre la monarchie britannique a été portée à son comble par la Grande Famine de 1845 et 1852 qui provoqua plus d’un million de morts et plus encore d’émigration. L’Irlande ne s’en est jamais réellement remise et son développement économique et humain en subit toujours les lointaines conséquences. La disparition progressive de la langue irlandaise engagée par la Grande Famine suscita un réveil culturel gaélique qui nourrit également l’idéal nationaliste. La lenteur du processus d’autonomisation politique, promis et toujours remis à plus tard, aboutit à la radicalisation politique d’une partie des nationalistes irlandais qui, associés aux socialistes, lancent l’insurrection de Pâques 1916 et fondent ensemble l’IRA (fusion entre l’Irish Republican Brotherhood et la Citizen Army des socialistes irlandais).
Si l’insurrection est un échec, la violence effroyable de l’armée britannique pour la détruire puis la répression terrible qu’elle organisa (avec le soutien de milices paramilitaires protestantes qui ressemblent beaucoup aux futurs « faisceaux » de Mussolini) finissent par rallier la population irlandaise au Sinn Féin. Le gouvernement britannique, dont l’administration sur l’île s’est effondrée et a été de fait remplacée par des institutions parallèles, finit par négocier avec les nationalistes irlandais et obtient après le chantage d’une « guerre totale » qu’ils acceptent une indépendance relative en 1922 et la partition de l’île, le Royaume-Uni conservant six des neufs comtés de la province d’Ulster, majoritairement peuplés des descendants des anciens colons anglais et écossais, mais surtout partie la plus riche et la plus industrialisée (avec notamment les importants chantiers navals de Belfast). Le Sud connut une guerre civile de deux ans (l’IRA sera la branche armée du Sinn Féin maintenu refusant le traité imposé par la Grande-Bretagne) et n’accéda à l’indépendance pleine et entière qu’en 1938, la République y sera enfin proclamée en 1948-1949.
Au nord, c’est un régime ségrégationniste qui se met en place sous l’autorité de dirigeants politiques acquis à la couronne britannique et considérant les Irlandais catholiques qui constituent alors quelques 40% de la population de la province au mieux comme des ennemis de l’intérieur, souvent comme des sous-hommes ou des demi-sauvages. Ainsi dans l’une des provinces appartenant directement à la démocratie européenne la plus avancée un gouvernement anti-démocratiques va diriger le territoire pendant plus de 40 ans, sans aucune autre réaction que quelques attentats ratés organisés par ceux qui se considèrent comme les continuateurs de l’IRA de 1916 et de 1922.
Plusieurs dirigeants de l’apartheid qui régit l’Afrique du Sud en visite en Irlande du Nord au début des années 1960 s’exprimeront publiquement sur place pour dire tout le bien et l’admiration qu’ils éprouvent pour le régime nord-irlandais, qu’ils jugent « plus efficace » que le leur !?! Les Irlandais catholiques sont de fait exclus de la plupart des offices publics, l’embauche des Protestants est systématiquement favorisée. Ainsi malgré l’existence d’une importante classe ouvrière en Irlande du Nord, les ouvriers unionistes défendirent toujours le point de vue de leurs industriels unionistes considérant les ouvriers catholiques comme des ennemis. L’Ulster Unionist Party règne en maître sur la Province avec l’appui de l’Ordre d’Orange, officine maçonnique protestante. Seuls quelques députés provinciaux indépendants arrivent à se faire élire dans les comtés les plus catholiques de la province, où une partie des habitants acceptent de participer aux élections.
En 1964, pour dénoncer les discriminations économiques est créé le mouvement Campaign for Social Justice. Après plusieurs attaques contre les Irlandais inspirées par le Révérend Ian Paisley, la Northern Ireland Civil Rights Association (NICRA) est fondée en 1967 sur le modèle du mouvement d’émancipation des noirs américains ; elle en reprend d’ailleurs l’hymne We Shal Overcome. Le mouvement aconfessionnel, soutenu par tous les organisations et tendances politiques ne soutenant le régime, a pour objectif l’instauration d’une véritable démocratie fondée sur l’égalité des droits civiques, sociaux et économiques dans la Province. Ces manifestations de plus en plus massives vont systématiquement être attaquées physiquement par les organisations paramilitaires « loyalistes », ce qui justifiera l’envoi en 1968 d’un contingent militaire britannique initialement pour garantir la paix civile. Mais la troupe et l’encadrement militaire vont rapidement considérer la population irlandaise, non unioniste, comme suspecte ou en soi hostile ; ils vont collaborer avec les mouvements paramilitaires loyalistes. Des attentats organisés par ces groupes sont même attribués à l’IRA qui n’a à cette époque pas une seule arme en état de marche ou d’explosifs.
L’IRA scissionne en décembre 1969, entre ceux qui fidèles à la direction marxiste-léniniste du Sinn Féin, veulent privilégier la lutte « politique et économique » et ceux qui face aux exactions croissantes des paramilitaires et de l’armée britannique veulent se réarmer pour protéger la population irlandaise. Sinn Féin scissionne sur les mêmes modalités dans les semaines qui suivent. Le réarmement de l’organisation politico-militaire nationaliste débute alors. Cependant aucune des manifestations de la NICRA ne peut se dérouler en sécurité : le 30 janvier 1972, l’armée britannique tire sur des manifestants pacifiques et fait 14 morts. La fable d’une provocation armée de l’IRA a été depuis longtemps éventée et la justice britannique a reconnu la responsabilité entière et totale de l’armée dans ce massacre. Le gouvernement britannique supprimera les institutions autonomes de la province cette même année. Mais la guerre civile est lancée. Elle fera plus de 3 500 morts. L’IRA va désormais recruter à tour de bras et ses actions militaires vont rattraper celles des mouvements paramilitaires loyalistes. D’un côté comme de l’autre, les cibles ne furent pas seulement policières et militaires et des dérives mafieuses ont été fréquentes. Après que John Major ait fait échouer la plus longue trève décrétée par l’IRA en 1994 par son refus d’engager des discussions politiques, une nouvelle trève est décrétée après l’élection de Tony Blair en 1997. Les négociations s’engagent qui conduiront aux accords du Vendredi Saint, à la démocratie, au partage du pouvoir et au désarmement.
1Good Friday Agreement : en Français, « accord du Vendredi Saint » négocié sous l’égide de Tony Blair et du premier ministre irlandais et signé par plusieurs partis d’Irlande du Nord (SDLP, Sinn Féin, UUP, UDP et PUP) le 10 avril 1998, il a mis en place le processus de paix qui a démocratisé la province, refondé totalement les services de police, abouti au désarmement des différents groupes paramilitaires…
2Unionistes : L’Unionisme est l’affirmation politique de la volonté de rester membre du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord plutôt que de rejoindre l’Etat libre puis la République d’Irlande. L’Unionisme défend les intérêts des communautés protestantes d’Irlande du Nord (Anglicans et Presbytériens) qui y sont encore majoritaires. Souvent confondue avec le « Loyalisme », cette dernière dénomination politique est plus particulièrement utilisée pour désigner les mouvements paramilitaires protestants qui ont alimenté la guerre civile pendant 29 ans.
3L’Ulster Volunteer Force (UVF) est un groupe paramilitaire loyaliste d’Irlande du Nord, fondé en 1966, reprenant le nom d’une ancienne milice unioniste. Son objectif affiché est de lutter contre l’IRA et pour le maintien de l’Irlande du Nord dans le Royaume-Uni. Le nom vient des Ulster Volunteers, créés en 1912 pour défendre l’union entre l’Irlande et la Grande-Bretagne. L’UVF est placée sur la liste officielle des organisations terroristes du Royaume-Uni et des États-Unis. Pendant le conflit nord-irlandais, l’UVF s’est rendue responsable de 426 morts (sur 3500). Le 27 juin 2009, l’Ulster Volunteer Force achève officiellement son désarmement. En 2020, le PSNI évalue à 12 500 le nombre de membres de l’UVF et de l’UDA en cas de reprise des affrontements communautaires (5000 pour l’UDA et 7500 pour l’UVF).
4Ulster Defence Association (UDA) : c’est la principale organisation paramilitaire protestante loyaliste, créée en 1971, par la fusion des groupes paramilitaires loyalistes de l’époque. Elle a été une collaboratrice zélée et recherchée par l’Armée britannique dans son occupation de la province dans les années 1970, avant de mener son propre agenda terroriste pour lutter contre les Nationalistes et Républicains irlandais. Elle a ainsi infiltré l’armée et les renseignements britanniques, de grandes loges maçonniques écossaises et orangistes. Devenue illégale seulement en 1992, elle serait de près de la moitié des morts du conflit. Le parti politique qui lui servait de vitrine officielle l’Ulster Democratic Party (UDP, à ne pas confondre avec le DUP de Ian Paisley et Arlene Foster) est un des signataires du Good Friday Agreement. Depuis son désarmement progressif depuis 2007, l’UDA s’est souvent recyclé dans le contrôle d’actions mafieuses et notamment le trafic de drogue.
5Democratic Unionist Party : Parti unioniste fondé en 1971 par des dissidents du parti unioniste officiel de l’époque (Ulster Unionist Party) pour lutter contre le mouvement des droits civiques et représenter le point de vue des loyalistes les plus intransigeants dans le conflit nord-irlandais. Il a été dirigé par le pasteur presbytérien fondamentaliste Ian Paisley de 1971 à 2008. Bien que non signataire des « Accords du Vendredi Saint », c’est son acceptation finale en 2007 de participer et conduire le gouvernement multipartite de la province avec le Sinn Féin qui sortira l’Irlande du Nord de la crise qui avait conduit à la suspension pendant 5 ans des institutions autonomes. Ian Paisley allait même être premier ministre de mai 2007 à juin 2008, avec pour vice premier ministre Martin McGuinness, un des principaux anciens chefs militaires de l’IRA. Le DUP a toujours récupéré depuis le poste de premier ministre.
6Sinn Féin : « nous-mêmes » en Gaélique. C’est le parti politique actuel le plus ancien d’Irlande. Fondé en 1905, il a poursuivi le combat indépendantiste engagé depuis plus d’un siècle. Il engage la révolution irlandaise à Pâques 1916, date à laquelle est créée l’Irish Republican Army (IRA). L’actuel Sinn Féin est issu d’une scission de 1970 contre les dirigeants officiels de l’organisation qui voulaient l’orienter dans une réorientation marxiste-léniniste faisant passer le combat nationaliste au second plan ; ces derniers se sont transformés en Workers’ Party, qui a un temps représenté l’extrême gauche en République d’Irlande avant de devenir marginale. Sinn Féin a mené de front une action politique et paramilitaire, qui en ont fait un acteur incontournable du Good Friday Agreement et de la vie politique démocratique en Irlande du Nord. Depuis 1997, Sinn Féin a également réussi sa réimplantation politique en République d’Irlande passant de 1,5% à 25% des suffrages aujourd’hui, où il est à la fois le premier parti du Dáil, l’assemblée irlandaise, et l’opposition au gouvernement libéral-conservateur. Son idéologie est évidemment nationaliste, mais surtout républicaine et socialiste.
7Alliance Party : Le Parti de l’Alliance d’Irlande du Nord est un parti non confessionnel, fondé en 1970. C’est le 5ème plus grand parti d’Irlande du Nord avec 8 sièges au sein de l’assemblée provinciale et un siège à Westminster. À l’origine, le parti de l’Alliance défend un unionisme modéré et non confessionnel. Toutefois, avec le temps et notamment dans les années 1990, il devient plus neutre sur la question de l’Union et se tourne davantage vers le libéralisme et le non-confessionnalisme. Il est membre du Parti libéral démocrate européen.
8SDLP : Social-Democratic and Labour Party – Parti travailliste et social-démocrate d’Irlande du Nord. Ce parti a été fondé en 1970 par plusieurs parlementaires régionaux proches du mouvement des droits civiques et refusant « l’abstentionnisme » (le refus de participer aux institutions provinciales et britanniques) des leaders traditionnels du nationalisme irlandais en Irlande du Nord. John Hume en a été le dirigeant emblématique de 1979 à 2001 et a été l’un des principaux négociateurs du Good Friday Agreement, pour lequel il a reçu le Prix Nobel de la Paix avec David Trimble, président de l’Ulster Unionist Party. Longtemps premier parti représentant les intérêts nationalistes irlandais dans la province, il a été surpassé depuis 2003 par Sinn Féin.