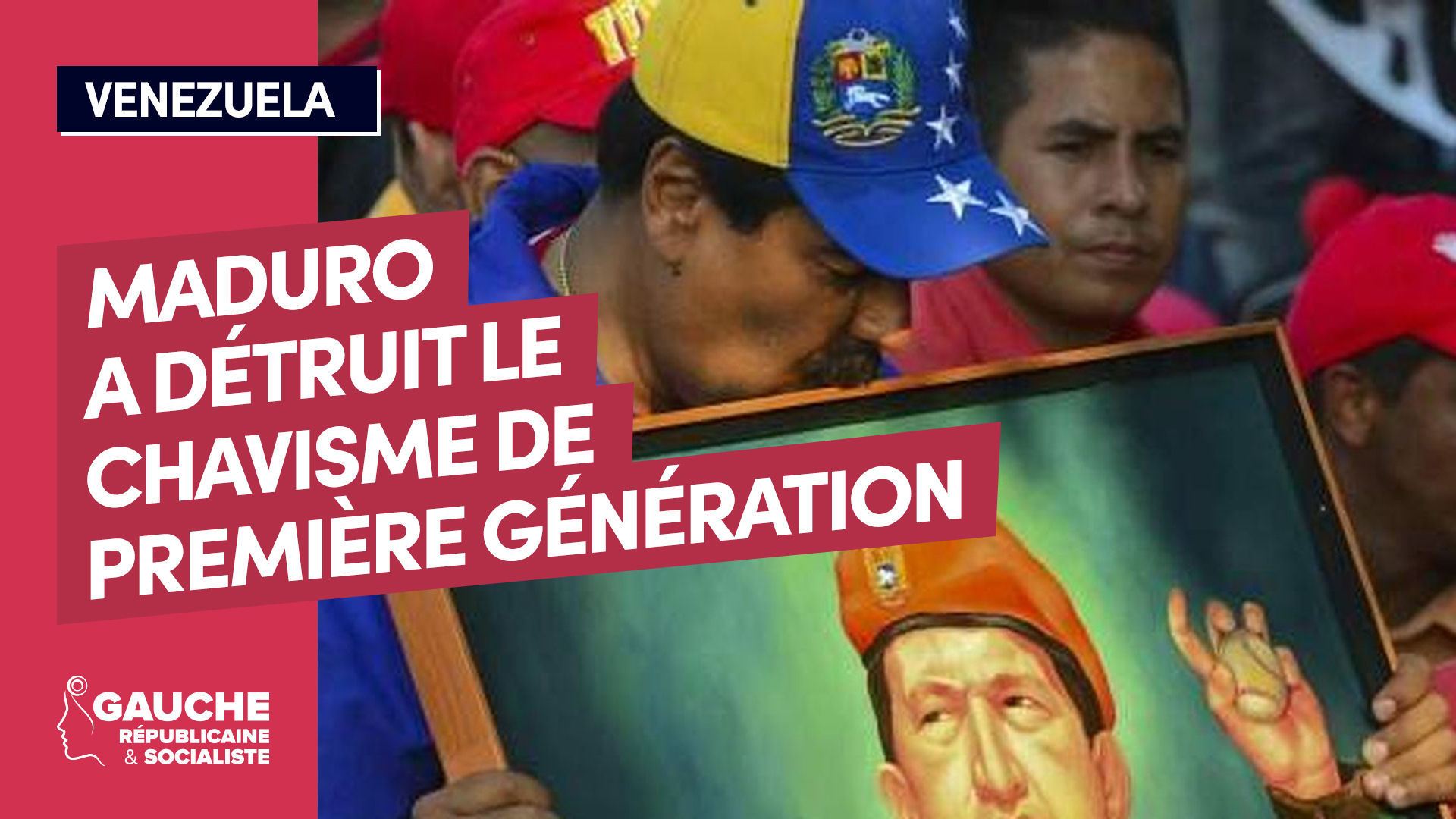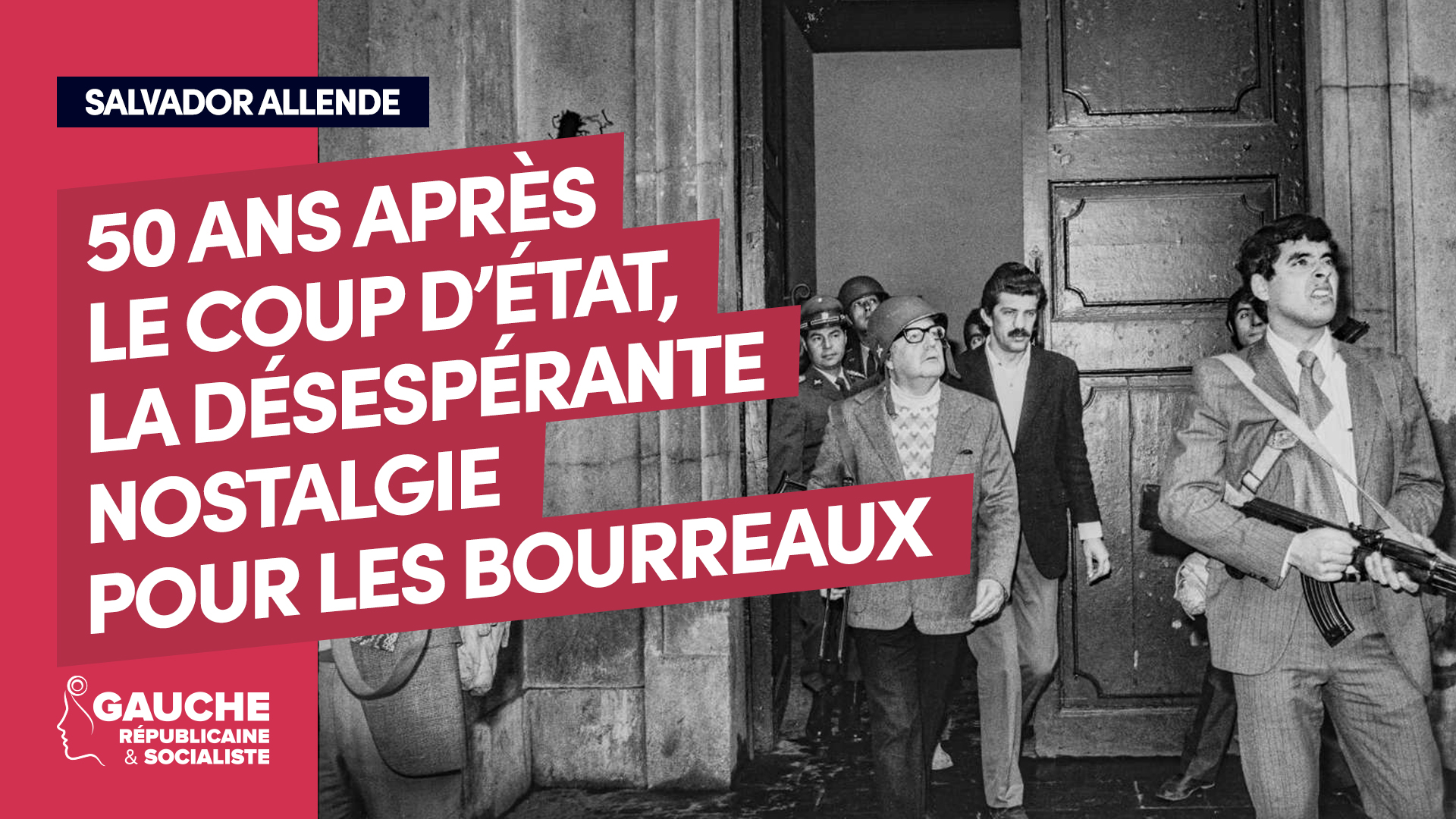Alors que le Venezuela est entré dans une nouvelle crise électorale et politique qui effraie l’Amérique du Sud (et accessoirement semble toujours diviser la gauche française), notre camarade Vincent Arpoulet, spécialiste de l’Amérique latine, décrypte la situation politique et présente les enjeux et les intérêts qui s’affrontent.
« Le principe fondamental de la souveraineté populaire doit être respecté par le biais de la vérification impartiale des résultats ». Voilà l’objectif prioritaire établi au sein du communiqué publié par les diplomaties brésilienne, colombienne et mexicaine en vue de trouver une issue pacifique à la crise politique qui fracture actuellement le Venezuela.
Si celle-ci ne cesse de s’aggraver depuis que Nicolas Maduro a succédé, en 2013, à Hugo Chavez à la tête de l’État vénézuélien, elle a récemment été exacerbée par les auto-proclamations successives, au soir du dernier scrutin présidentiel qui s’est tenu le 28 juillet, de Maduro ainsi que de son principal opposant de droite Edmundo Gonzalez, avant même la publication des procès-verbaux de l’intégralité des bureaux de vote par le Conseil National Électoral (CNE). Ce dernier prétend avoir été victime d’un piratage informatique l’empêchant, jusqu’à ce jour, de rendre publics l’ensemble des votes qui sont, au Venezuela, réalisés par voie électronique. Or, cette publication est particulièrement attendue en raison du fossé béant qui sépare les résultats nationaux proclamés par le CNE (selon lesquels le président sortant aurait été réélu dès le premier tour avec 52% des voix) et les premiers sondages de sortie des urnes qui plaçaient l’opposition largement en tête. C’est pourquoi, face à la difficulté de tirer le vrai du faux dans un tel contexte, les différents gouvernements de gauche latino-américains mettent l’accent sur la nécessité d’assurer une médiation entre les différentes forces en présence en vue d’aboutir à un audit public des votes, seule manière à leurs yeux de garantir la souveraineté du peuple vénézuélien. Et au vu de l’empressement d’un certain nombre de grandes puissances à reconnaître la victoire du camp le plus susceptible de sécuriser leurs intérêts stratégiques au sein de cet État pétrolier (à l’image de la Chine et de la Russie favorables à Maduro, mais également des États-Unis partisans de Gonzalez), difficile de leur donner tort.
Ces gouvernements prennent ainsi ouvertement leurs distances vis-à-vis d’un certain nombre de dirigeants conservateurs de la région qui, alignés diplomatiquement sur Washington, ont rapidement apporté leur soutien à Edmundo Gonzalez. C’est notamment le cas du président équatorien Daniel Noboa ou de son homologue argentin Javier Milei, qui ne sont par ailleurs pas particulièrement réputés pour leurs préoccupations démocratiques. Cependant, le Brésil, la Colombie et le Mexique s’éloignent tout autant du président vénézuélien sortant – fait particulièrement notable au vu de la proximité entre les rhétoriques anti-impérialistes de figures telles que le président brésilien Lula et celle du gouvernement maduriste.
Cette prise de position peut notamment s’expliquer par le fait qu’au-delà des suspicions de fraude lors du dépouillement, ce scrutin a été biaisé dès le départ par l’invalidation, sur la base de motifs plus ou moins fondés, de plusieurs candidatures d’opposition. Le cas le plus médiatisé est celui de Maria Corina Machado, figure conservatrice ayant largement remporté les primaires organisées au mois d’octobre 2023 par la Table de l’unité démocratique, principale coalition d’opposition au madurisme. Or, celle-ci est déclarée inéligible par la justice vénézuélienne pour avoir appuyé et tiré profit du gel d’un certain nombre d’actifs nationaux placés dans les institutions bancaires de plusieurs États reconnaissant la légitimité de Juan Guaido, l’un des fers de lance de l’opposition qui s’est autoproclamé président du pays entre 2019 et 2023. Si l’utilisation de ces actifs par un dirigeant dont la légitimité démocratique est plus que contestable s’inscrit effectivement dans une forme d’ingérence n’ayant fait qu’aggraver le délitement de l’économie, ainsi que de la société vénézuélienne, il ne s’agit que d’un argument parmi d’autres utilisés pour marginaliser du scrutin un certain nombre d’autres partis d’opposition bien moins suspects d’être à la botte de velléités impérialistes. C’est le cas des oppositions de gauche au madurisme, comme le démontre notamment le reportage réalisé par la politiste Yoletty Bracho pour la revue de critique communiste Contretemps1. L’un des représentants de la gauche vénézuélienne lui confie notamment : « Il est impressionnant de voir que la droite a pu avoir son candidat, mais que c’est nous à gauche qui n’avons pas le droit d’avoir de candidat. Nous n’avons pas de représentation lors de ces élections »2. Sous-entendu, le madurisme s’est détourné de la gauche du paysage politique. Un virage à droite confirmé par le fait que le Parti Communiste Vénézuélien (PCV) est récemment entré dans l’opposition, dénonçant la crise d’un « modèle de capitalisme dépendant (…) en contradiction avec les intérêts des travailleurs »3.
Alors qu’on présente une confrontation entre Madurisme et extrême droite, c’est la gauche vénézuélienne qui est en réalité écartée du débat politique et des solutions
Ce modèle de capitalisme dépendant repose quasi exclusivement, depuis le début du XXe siècle, sur les revenus générés par les abondantes réserves pétrolières dont dispose le pays. Les données publiées par la Commission économique pour l’Amérique latine (CEPAL) mettent en lumière le quasi-monopole occupé par les ressources pétrolières dans les exportations vénézuéliennes dans la mesure où elles représentent environ 85% des produits vendus par le pays sur la scène internationale4. Si cette structure économique n’est pas fondamentalement remise en cause par l’arrivée au pouvoir d’Hugo Chavez en 1999, celui-ci modifie en revanche radicalement les modalités d’allocation de ces ressources. En réaffirmant la prédominance de la puissance publique dans la gestion de l’intégralité du processus d’exploitation et de commercialisation des ressources pétrolières, il redirige une majorité des revenus issus de ces activités vers l’État qui est alors en mesure de développer un certain nombre de programmes de redistribution sociale. Cela conduit notamment à une diminution significative de l’extrême-pauvreté qui passe de 22,6% à 8,2% de la population entre 2002 et 2012. Cependant, le fait que ce modèle social repose quasi exclusivement sur les revenus générés par les exportations pétrolières le rend particulièrement dépendant aux variations du prix du baril à l’échelle internationale. Et s’il augmente globalement de manière continue au cours des années 2010, il chute subitement de 100 à 80€ entre 2013 et 2014, ce qui expose l’économie vénézuélienne à une dégradation des termes de l’échange. En effet, si la hausse considérable des exportations de ressources pétrolières provoque un afflux massif de devises en dollars, celles-ci doivent être converties en bolivar, la monnaie nationale vénézuélienne. Or, la contrepartie de la spécialisation dans la production pétrolière est que le Venezuela doit importer de nombreux biens manufacturés nécessaires à la satisfaction de la demande interne, de même que l’ensemble des équipements nécessaires à son industrialisation qui ne sont pas produits sur place. Il se trouve que les importateurs doivent directement régler ces importations en dollars, et non en devises nationales. Lorsque les importations deviennent plus importantes que les exportations, la demande de dollars sur le marché des changes devient plus importante, ce qui déprécie le prix de la monnaie nationale en comparaison du dollar. Le prix de toutes les importations augmente alors puisqu’il faut plus de devises nationales pour se procurer un dollar. C’est pour faire face à cette hémorragie de devises que, tout en conservant officiellement une rhétorique radicalement anti-impérialiste, le gouvernement vénézuélien laisse libre cours à la dollarisation officieuse de son économie. Or, la manière dont s’opère cette dollarisation ne fait qu’accroître la précarisation d’une part significative de la population. En effet, si la plupart des emplois restent rémunérés en bolivar – c’est notamment le cas de l’intégralité des travailleurs de la fonction publique –, la majorité des prix se calent désormais sur le cours du dollar. C’est ainsi que le prix moyen d’un déjeuner classique oscille autour de 10 dollars dans un pays dans lequel le salaire minimum équivaut à peine à 50 dollars par mois à l’heure actuelle.
Mettre l’accent sur la part de responsabilité du gouvernement dans cette crise économique ne doit pas pour autant conduire à occulter le poids tout aussi important des différentes sanctions internationales imposées depuis 2013, en particulier par les États-Unis. A titre d’exemple, le gel du paiement des ressources exportées aux États-Unis par l’entreprise pétrolière publique PDVSA en 2019 la prive de 7 milliards de dollars, ce qui ne fait qu’aggraver l’hémorragie de devises qui frappe le pays sud-américain. Ces sanctions ont récemment été allégées à la faveur du conflit russo-ukrainien – un certain nombre de pays étant désireux de diversifier leurs sources d’approvisionnement en ressources pétrolières en vue de faire face à l’arrêt des importations de pétrole russe – mais comme en Iran, comme à Cuba, elles produisent toujours les mêmes effets : elles ne frappent que les populations civiles, tout en renforçant le virage autoritaire du gouvernement (justifié officiellement par la nécessité de lutter contre un impérialisme étasunien dont on peut, tout en condamnant les dérives du madurisme, difficilement nier l’existence).
La mise en scène d’une confrontation entre des protagonistes incompétents qui se détournent des intérêts populaires, à leur profit et celui des États-Unis d’Amérique,
de la Chine et de la Russie
Un impérialisme étasunien par ailleurs ouvertement plébiscité par une opposition officielle qui semble tout autant incapable de répondre aux aspirations démocratiques exprimées par les mobilisations en cours. Sachant que les oppositions de gauche et/ou centristes au madurisme ont été marginalisées en amont du scrutin, le président sortant faisait en effet face à la frange la plus conservatrice lors de ce scrutin. Si Gonzalez semble relativement mesuré sur certains sujets tels que l’éducation publique qu’il affirme vouloir préserver, celui-ci ne cesse de s’afficher en compagnie de Maria Corina Machado qui incarne un courant politique dont l’objectif est de revenir purement et simplement au néolibéralisme radical en vigueur avant l’arrivée au pouvoir d’Hugo Chavez. Thomas Posado, maître de conférences en civilisation latino-américaine, met notamment l’accent sur le fort dogmatisme libéral de Machado qui se traduit par sa volonté affichée, et répétée à de nombreuses reprises, de privatiser PDVSA5. Dans un pays dans lequel cette société est vue comme un joyau de l’État, une telle proposition est particulièrement iconoclaste, y compris au sein de l’opposition au madurisme. Preuve que l’opposition semble à l’heure actuelle noyautée par sa frange la plus radicale. Et ce, d’autant plus que Machado a par ailleurs ouvertement fait appel à de nombreuses reprises à une intervention armée des États-Unis en vue de renverser le chavisme.
En somme, le drame de la situation vénézuélienne, c’est que ni Maduro, ni l’opposition majoritaire ultra conservatrice ne semblent à même de préserver les premiers acquis sociaux du chavisme « première génération » – qui se distingue du madurisme en de nombreux points. Si Chavez inaugure en effet sa première présidence par l’adoption d’une nouvelle Constitution destinée à démocratiser la société vénézuélienne, parallèlement à la réaffirmation de la prédominance du pouvoir politique sur l’armée – le défilé militaire accompagnant traditionnellement la mise en place d’une nouvelle Assemblée constituante n’ayant exceptionnellement pas eu lieu à cette occasion -, son successeur semble à l’inverse assumer de plus en plus ouvertement ses similarités avec les militaires ayant dirigé à plusieurs reprises le pays. En témoigne l’ouverture de centres pénitentiaires de haute sécurité dans lesquels les opposants seront soumis au travail forcé « comme à l’époque »6…
Vincent Arpoulet
1 BRACHO Yoletty, « « Tout le monde sait ce qu’il s’est passé. » Pour une approche de gauche des élections vénézuéliennes », Contretemps. Revue de critique communiste, 6 août 2024 ; https://www.contretemps.eu/gauche-internationaliste-elections-venezuela/
2 Ibid
3 BENOIT Cyril, « Venezuela : les communistes pour une alternative populaire à la crise », PCF, Secteur International ; https://www.pcf.fr/venezuela_les_communistes_pour_une_alternative_populaire_la_crise
4 https://statistics.cepal.org/portal/cepalstat/national-profile.html?theme=2&country=ven&lang=en
5 POSADO Thomas, « Venezuela : Maria Corina Machado, nouvelle figure du radicalisme de droite », France Culture, 26 octobre 2023 ; https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/les-enjeux-internationaux/venezuela-maria-corina-machado-nouvelle-figure-du-radicalisme-de-droite-7868137
6 BRACHO Yoletty, « « Tout le monde …, op. cit.
Retrouvez le communiqué commun de plusieurs partis de gauche français le 9 août 2024