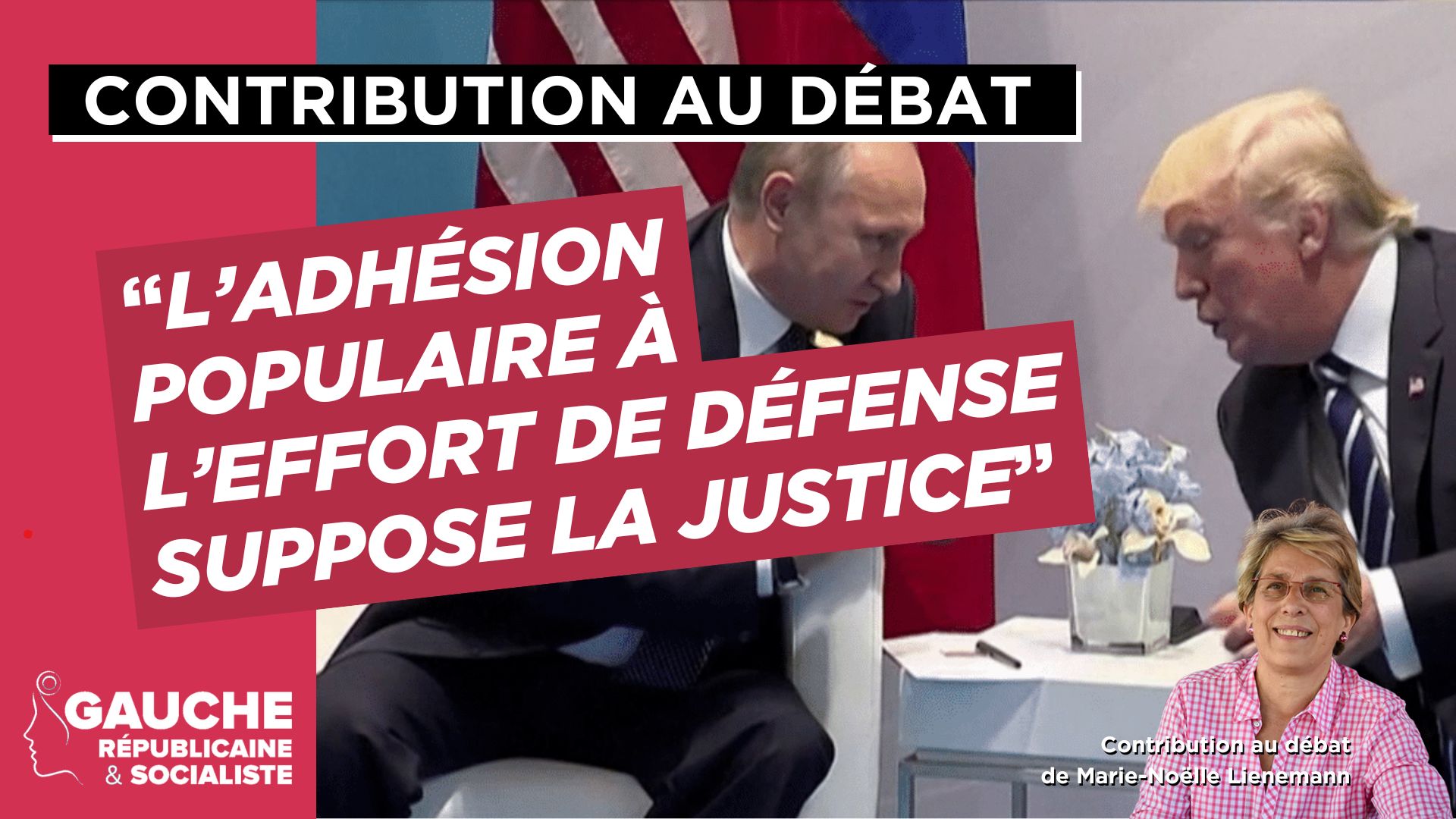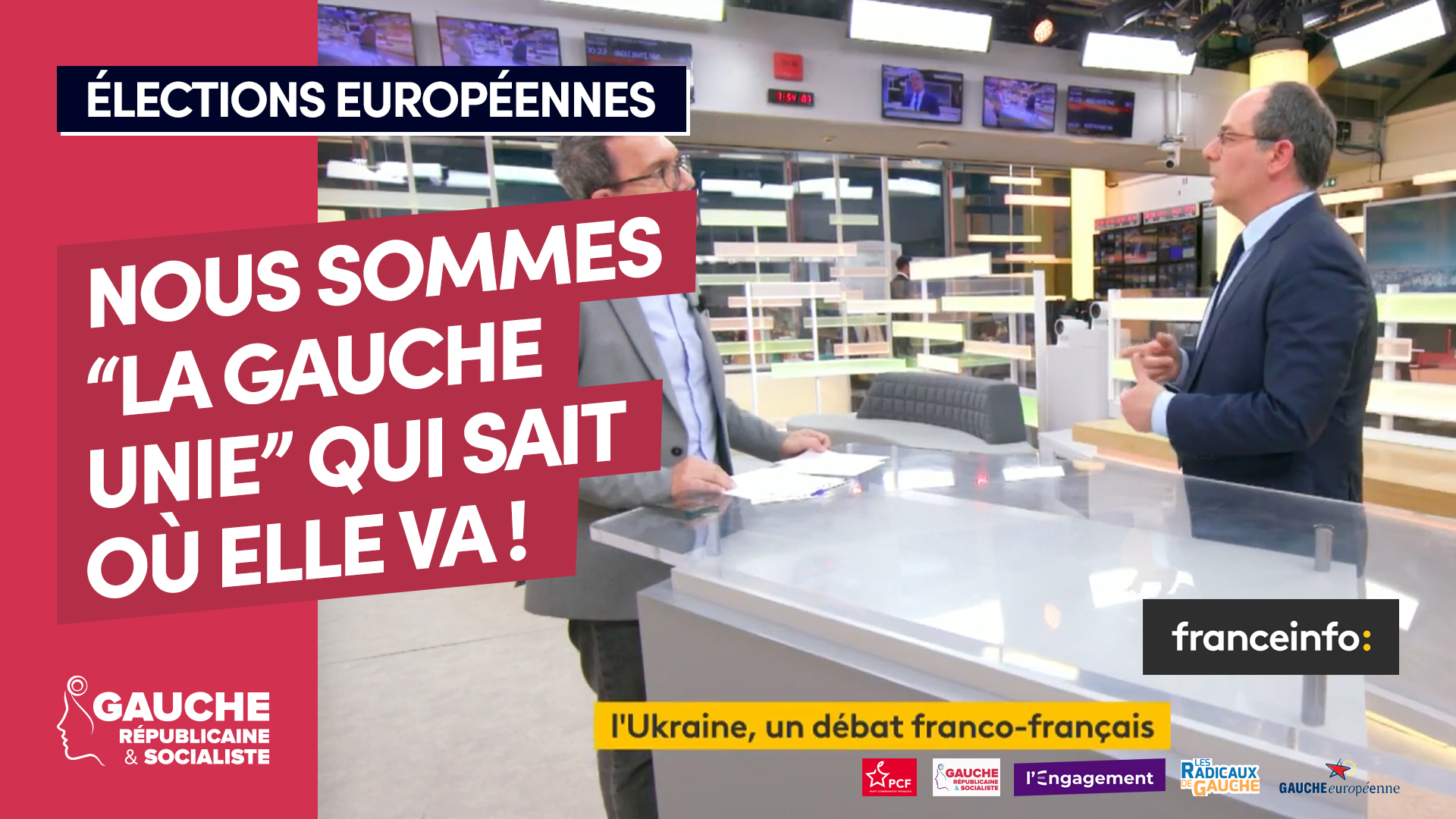article publié le mercredi 12 mars 2025 sur le site de Marie-Noëlle Lienemann
Promouvons une économie de défense et de souveraineté par des politiques de relance et de justice sociale
Nous entrons dans une nouvelle ère, mais réfléchissons sérieusement à ce qu’elle implique, définissons une stratégie à court et à moyen terme sans repartir dans de fausses directions qui s’avèreront des impasses !
La violence et la brutalité des annonces et du comportement de Donald Trump montrent une inflexion et une accélération d’une politique américaine qui avait relégué en seconde zone les enjeux européens pour concentrer son regard et ses actions en direction de l’Asie avec en ligne de mire la puissance chinoise. Déjà le soutien de l’administration de Biden à l’Ukraine était davantage calibré pour conjurer une avancée excessive de Poutine dans ce pays que pour lui infliger une cinglante défaite. Il est clair qu’elle ne souhaitait pas ouvrir un conflit majeur avec la Russie (ce que les dirigeants du Kremlin ont sans doute vite compris). Cela posait et pose encore la question majeure de la crédibilité du droit international. Ce n’est hélas pas le seul cas !
Mais là, il est vrai que l’inversion d’alliance ou pour le moins un rapprochement explicite des États-Unis d’Amérique avec la Russie constitue un fait nouveau. Trump face à la menace chinoise veut éviter un front Russie/Chine et, par ailleurs, compte bien poursuivre son impérialisme autour des USA (canal de Panama, Canada et Groenland).
Sans compter que se joue aussi l’accès aux terres rares, métaux et autres ressources indispensables au développement économique et technologique qui va constituer un point cardinal des relations internationales.
Dans cette perspective, l’Europe n’a aucune place sérieuse dans la logique trumpiste : ni assez de ressources naturelles, ni avancées technologiques majeures ! Et manifestement partager des idéaux démocratiques ne semble plus être une préoccupation prioritaire !
On nous annonce aujourd’hui un accord USA/Ukraine pour proposer à Moscou un cessez-le-feu. Tant mieux, et la France doit agir au-delà pour qu’une paix équilibrée et durable soit signée. Pour l’heure, tout ceci est encore aléatoire. Mais cela n’empêche pas un constat lucide sur le changement de cadre géopolitique.
Le lâchage actuel de l’Ukraine et la totale indifférence à l’égard de l’Europe sommée, d’une part, d’assumer seule sa défense ou en tout cas de payer pour la garantir (ce que les Américains préconisent et ils n’hésiteront pas à faire pression dans ce sens) et, d’autre part, de rééquilibrer ses échanges commerciaux avec les USA, en particulier s’agissant des biens industriels, exige de notre part des réactions à la hauteur des enjeux.
Il faut reconquérir notre indépendance militaire. C’est vrai pour la France qui a des atouts au sein de l’UE et ce devrait être vrai pour l’Europe. Et si nos voisins européens semblent découvrir cette exigence, rien n’est en fait aujourd’hui très clair, si ce n’est le besoin de réengager un réarmement de notre continent pour faire face aux menaces qui pèsent sur lui.
Attention dans des moments troublés, il faut être rigoureux sur les mots comme sur les faits et n’entretenir ni des peurs irrationnelles ni des illusions trompeuses.
1- La France n’a pas à entrer dans une économie de guerre, elle doit entrer dans une économie de défense et de reconquête de souveraineté. C’est la meilleure garantie pour notre paix !
La France ne se situe pas en posture de guerre et actuellement n’est en guerre avec personne.
Néanmoins, elle doit rentrer dans une économie de défense parce qu’elle doit, d’une part, se préparer à d’éventuelles menaces que l’on voit poindre à l’horizon et qui pour une part (mais pour une part seulement…) ont changé de nature, mais aussi parce qu’elle subit dès à présent des attaques de type variées, comme il se doit dans des guerres hybrides. On a pu voir comment la Russie a agi pour la déstabilisation en Afrique ou comme les cyber-attaques se multiplient.
Une économie de souveraineté ne signifie pas fermer nos échanges et collaborations, ni renoncer à des alliances et à la construction européenne. Mais il s’agit de se mettre en situation de maitriser au maximum notre avenir et faire face, si besoin, seuls à des lourds périls et de tous ordres.
Consacrer d’importants efforts pour renforcer nos capacités militaires et de défense est justifié car la seule dissuasion nucléaire ne saurait suffire, elle doit être l’ultime recours et suppose d’être appuyée sur des moyens conventionnels suffisants et consistants.
De fait, nos choix récents étaient davantage tournés vers la projection extérieure, la lutte contre le terrorisme et moins sur la défense de notre territoire national. Cela doit redevenir la priorité.
Il faut donc y consacrer des crédits importants et accompagner une montée en puissance de la production d’armements. Evidemment cette constatation exige des changements majeurs de politique économique et la gauche doit faire des propositions sérieuses et offensives et ne pas se laisser embarquer dans le durcissement de la politique austéritaire et de reculs sociaux qui n’a fait que nous affaiblir !
2- Ne partons pas tête baissée dans l’idée d’une défense européenne ! Parlons de la défense de l’Europe et de la défense de la France ! Engageons de premiers jalons et réarmons notre pays.
Ne théorisons pas notre incapacité dans ce monde nouveau à pouvoir être maître de notre destin, avec cette formule rabâchée à l’envie : nous ne pouvons plus agir seuls, on ne peut le faire qu’avec l’Europe !
Certes, il est mieux agir de concert avec nos voisins européens et consolider nos liens pour ensemble être plus forts, et nous devons faire le maximum pour cela. Mais en aucune façon, nous ne devons accepter de nous trouver affaiblis ou incapables de faire prévaloir nos choix, nos intérêts, nos valeurs, de garantir notre indépendance ! brefs partenaires oui, vassaux – de fait – jamais !
Certes, nous devons très vite avec les Européens (et il y a déjà un problème de définition et de périmètre, puisque, d’une part, le Royaume-Uni est hors de l’UE et, d’autre part, certains pays comme la Hongrie ne sont pas nécessairement très fiables) agir de concert en particulier en soutien à l’Ukraine, trouver les moyens de relancer la production militaire dans nos pays et consacrer les sommes qui s’imposent pour la défense. Mais faut-il encore être au clair sur ce que ce changement radical de paradigme impose.
Nous devons favoriser la création d’une plateforme opérationnelle de défense entre Européens et eux seuls, ainsi que renforcer la production d’armement en Europe. Mais il est extrêmement prématuré de parler de défense européenne.
Oui il faut rapidement prendre des décisions pour produire des armes sur notre continent et la France doit engager des mesures d’urgence pour sa réindustrialisation.
Nous devons être extrêmement fermes avec nos voisins européens : nous ne pouvons pas continuer à financer les budgets européens pour que les autres pays achètent des armes aux Américains ou hors UE. Certes, il va falloir un certain temps pour que cela ne soit plus nécessaire du tout, mais au moins veillons à ce qu’ils n’achètent plus des armements qui ne peuvent être produits en Europe. Le cas des F35 est un bon exemple.
Par ailleurs, sous l’effet de l’émotion, les dirigeants allemands semblent davantage décidés à avancer dans la direction de la coopération européenne. Seuls les actes comptent et ne négligeons pas leur vulnérabilité aux pressions américaines sur leurs exportations outre-Atlantique et le chantage qui leur sera fait concernant l’achat de matériel américain. Ce ne serait hélas pas la première fois ! On a vu comment le Bundestag a tout fait pour faire capoter le projet européen d’hélicoptère Tigre III, ce qu’au final il a obtenu, et la Bundeswehr a acheté des hélicoptères à dominante américaine ! Trump ne va pas se gêner.
Mais de surcroit, il est fort probable que les Allemands mettent les énormes sommes annoncées pour son réarmement au service de productions nationales, parfois concurrentes aux entreprises françaises et il faut être attentifs car le passé récent exige notre vigilance : les coopérations franco-allemandes se sont souvent achevées par une prédation par les acteurs d’outre-Rhin de nos entreprises avec leurs avancées technologiques que de fait nous perdions !
Et en tout cas, s’agissant de l’armement français, il ne faudra pas compter uniquement sur les débouchés européens et il faudra continuer à travailler, voire intensifier la coopération, avec d’autres pays non alignés qui ne veulent pas être soumis aux diktat américains, russes ou chinois ! C’est d’ailleurs un point majeur de notre politique internationale : nouer des alliances avec les pays qui ne veulent pas entrer dans l’orbite des trois blocs impérialistes.
Rappelons que la défense doit demeurer une stratégie, une mise en œuvre souveraine de la Nation. Évidemment c’est particulièrement vrai de la dissuasion nucléaire qui ne saurait être partagée, même s’il revient à notre pays de définir librement les conditions de son utilisation.
3- Surtout pas de saut fédéraliste, mais des exigences immédiates de réorientation de l’UE !
D’abord fort heureusement, nous n’avons pas cédé aux sirènes fédéralistes car, sur de nombreux dossiers, la France était ultra-minoritaire. Si nous l’avions fait, nous serions encore davantage en hyper fragilité aujourd’hui, ne serait-ce que sur la poursuite de la production électrique nucléaire, mais aussi sur ses dépenses militaires.
La France, en tout cas souvent, avait eu raison. Mais trop souvent aussi, elle n’a pas suffisamment créé un rapport de force pour exiger des réorientations majeures de l’Union Européenne et ce sont souvent ceux qui, aujourd’hui, nous pressent au fédéralisme qui, hier, nous poussaient à accepter la logique néolibérale et malthusienne, la thèse des autres, au nom de l’UE à tout prix. Et cela nous a conduit dans les impasses actuelles.
Ce fut vrai lors de l’acceptation des dogmes budgétaires inscrits dans le marbre des traités dans le traité d’Amsterdam. Nous disions alors que cette logique économique induirait structurellement un affaiblissement de la croissance ! Cela s’est hélas confirmé avec un décrochage massif en termes de PIB entre l’Europe et les USA mais avec quasiment toutes les autres régions du monde. Même dans ce cadre, nous plaidions pour que soit sorties des critères de dépenses publiques, les dépenses de défense !! Que nenni et alors que notre pays poursuivait un certain effort en ce sens, d’autres comme l’Allemagne nous montraient du doigt comme de mauvais élèves. Quand nous contestions la concurrence libre et non faussée, qui entretiendrait le dumping social et fiscal, on nous promettait un grand marché porteur de prospérité. Nous n’avons eu ni la prospérité ni le renforcement du sentiment européen, mais l’aggravation des inégalités, de la pauvreté, des tensions sociales qui nourrissent l’extrême droite et les populistes.
D’ailleurs le basculement fédéral dans ces circonstances serait d’autant plus dangereux.
On pourrait parler de la pongée aveugle dans la mondialisation libérale et le refus de sérieusement soutenir la production européenne et de prévoir des barrières aux frontières de l’UE. On pourrait citer les conditions du grand marché de l’électricité qui a renchéri le prix de l’énergie … bref la liste est longue.
Plus que jamais ce qu’il faut faire en Europe, c’est privilégier des coopérations intergouvernementales équilibrées, desserrer l’étau de l’austérité budgétaire et engager une nouvelle politique économique européenne, fondée sur la relance, une relance de reconstruction tant des investissements productifs, de recherche, d’innovation, d’éducation, que d’un modèle social où les salariés peuvent vivre dignement de leur salaire, avec une protection sociale élevée et d’un plus juste équilibre capital travail. Car l’atonie de la demande intérieure européenne pèse lourd sur nos industries et freine notre réindustrialisation.
Il n’y a pas d’exemple de réarmement sérieux d’un pays sans relance économique.
Cela suppose aussi de permettre à chaque État de retrouver sérieusement les moyens de sa compétitivité en dehors de cette logique destructrice de dumping social et en l’occurrence de faire baisser sérieusement notre prix de l’énergie. Donc avant de remettre en cause l’actuel marché de l’énergie (on notera qu’aujourd’hui l’Espagne qui s’est mis hors ce dernier est le pays où l’électricité est la moins chère !), nous devons exiger comme le suggère Olivier Lluansi dans son excellent livre Réindustrialiser, le défi d’une génération que 15% de la production nucléaire française puisse être vendue aux industriels à prix coûtant ! Nous avons des moyens de pressions si les résistances à ces dérogations étaient trop fortes. Agissons vite car il n’est pas exclu que rapidement soient rouverts les échanges de gaz avec la Russie à bas prix sous la bénédiction des Américains et qui à nouveau seront un avantage pour nos voisins outre-Rhin.
Au-delà, on ne peut plus tergiverser sur la mise en place de protections à nos frontières et des règles favorables à la consommation de proximité notamment pour les appels d’offre publics. Hélas nous avons à travers les traités (rappelons que les Français l’avaient rejeté) confié l’ensemble de la politique commerciale de l’UE à la commission européenne. On en voit tous les jours les tristes conséquences, récemment encore avec le Mercosur, ou dans l’affaire des panneaux solaires chinois. Mais cela risque d’être particulièrement douloureux pour la riposte aux attaques de Trump !
4- Une réaction effective et dissuasive à la hausse des droits de douanes annoncés par Trump !
Poutine et Trump n’ont en commun que de prendre en compte la force ! Alors face à sa hausse des droits de douanes, nous ne pouvons pas, comme la fois dernière, nous contenter de mesures limitées et ciblées, accompagnées d’un verbe haut. Mais la réalité était que rien de significatif ne touchait fortement les USA.
Si l’on veut frapper un grand coup, annonçons que nous allons taxer les armes américaines ou au moins un panel significatif dans les domaines où l’Europe est capable de prendre le relais ! Peut-être que cela amènera l’administration américaine à réduire ses prétentions et à discuter sérieusement. On le voit dès à présent dans la liste des « rétorsions » de la commission face à la hausse des taxes US sur l’acier et l’aluminium très limitée et juste ajustée à des sommes équivalentes à celle imposées par Trump. Bref c’est une position qui n’est en rien dissuasive !
Il est à craindre que la commission européenne comme d’habitude s’enlise dans des recherches de vains compromis sans avoir auparavant créé l’indispensable rapport de force ! Pire que Madame Von der Leyen négocie un fois de plus avec le prisme des intérêt allemands !
5- Pour mettre en œuvre une économie de défense et de souveraineté, en France aussi il faut changer d’orientations économiques et budgétaires et engager une politique de relance ! Relance par des investissements productifs (dont l’armement mais pas seulement) et par la consolidation de notre modèle social.
Relancer une économie de défense doit aller de pair avec un esprit de défense. Car face aux dangers, un peuple ne gagne pas seulement avec des moyens militaires (il en faut et les utiliser à bon escient) mais aussi un esprit de défense et cela exige plus de cohésion sociale, plus de justice, et autant que faire se peut la défense d’un idéal commun. Pour la France, c’est la République.
De surcroit, pour financer ces nouvelles dépenses, il est impératif de soutenir une politique de croissance qui, seule, garantit des ressources nouvelles et importantes. Il nous faut un grand plan de relance d’investissements productifs au sein desquels la recherche doit avoir une place significative car notre pays est très très loin derrière les autres pays développés. Il faut urgemment rattraper notre retard.
Mais une économie de défense et de souveraineté ne peut se contenter de soutenir les investissements militaires, elle doit concerner de très nombreux secteurs civils. D’ailleurs il est essentiel de bien mettre en synergie les deux dimensions civiles et militaires ! Insistons sur la reconquête d’une souveraineté numérique et technologique.
Face aux menaces chacun doit participer à proportion de ses facultés.
Emmanuel Macron a eu grand tort, a fait une grave erreur lorsqu’à peine disait-il que nous avions à faire face à une menace existentielle qu’il se précipitait à dire qu’il n’y aurait pas de hausses d’impôts, en clair que les plus riches ne seraient pas mis à contribution. Quelle honte !
Hélas, l’histoire a montré qu’une large part du patronat a souvent privilégié son portefeuille à la défense de la Nation et rares sont ceux qui ont fait œuvre de patriotisme et de résistance (il y en a eu néanmoins).
En tout cas faire porter l’effort de réarmement sur les salariés, sur la dégradation de notre modèle social serait une énorme erreur et serait voué à l’échec !
L’adhésion du peuple suppose la justice, l’effort d’abord demandé aux plus riches, au plus forts, une meilleure redistribution des richesses au service de l’intérêt national !
Je le répète c’est un impératif pour réussir !
Ni va-t’en guerre, ni tentés par une sous-estimations des menaces venant de Russie ou d’ailleurs, nous ne devons pas tarder à nous préparer à ce monde nouveau qu’il nous faut affronter avec lucidité, courage (en particulier de sortir des voies suivies jusqu’alors et qui nous ont affaiblies) avec chevillée au corps l’ambition d’être un peuple maître de son destin et de concourir à un monde qui ne saurait être partagé entre des empires dominants !
Bien d’autres questions et choix vont se poser à nous dans les mois qui viennent. C’est toute la noblesse d’une démocratie d’en débattre. Faisons-le sans tarder, sans esquiver les difficultés, avec sérieux en sortant des postures de communication ou des invectives et déclarations réductrices. Dans ces temps difficiles, soyons plus que jamais pleinement citoyens.
Marie-Noëlle Lienemann
ancienne ministre,
coordinatrice nationale de la GRS,
membre du conseil économique, social et environnemental