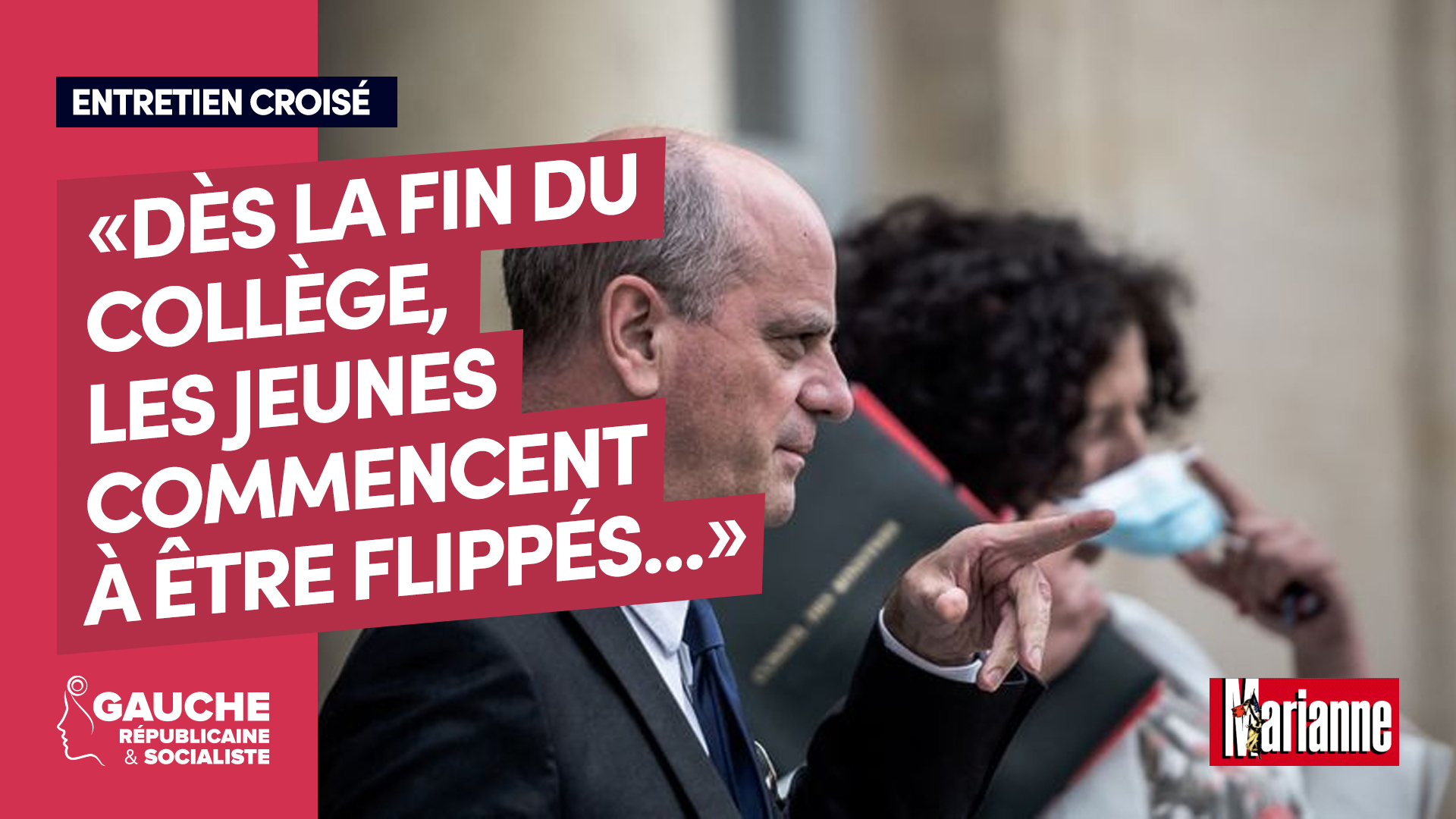tribune de Rémi Lefebvre publiée le 7 juillet 2021 dans la Revue Esprit
Élu à gauche en 2017, Emmanuel Macron a progressivement réorienté sa ligne politique, que ce soit sur le terrain économique ou régalien. Aujourd’hui, il vise explicitement une réélection à droite, favorisée par l’affaiblissement des identités politiques traditionnelles.
À quelques mois de l’élection présidentielle, il est temps d’analyser la cohérence et la consistance du macronisme. Existe-t-il d’ailleurs ? Il est permis d’en douter. Le président de la République n’a produit, hormis quelques longs entretiens dans la presse, aucune réflexion d’ampleur qui pourrait s’apparenter à un travail doctrinal. Son mouvement, La République en marche, a vite renoncé à remplir la fonction idéologique qu’on pourrait attendre d’un parti, surtout quand celui-ci a surgi de nulle part. David Amiel et Ismaël Emelien, deux proches conseillers du président, ont bien publié en mars 2019 un « manifeste », Le progrès ne tombe pas du ciel 1, qui esquisse une définition du macronisme comme « maximisation des possibles ». Mais la pensée ou le positionnement politique d’Emmanuel Macron ont surtout été définis de l’extérieur 2.
Pour analyser le macronisme, on peut alors s’appuyer sur ce que nous en dit l’exercice du pouvoir depuis 2017. Élu par effraction, Emmanuel Macron s’est construit sur la disruption (rappelons le titre de son ouvrage d’entrée en campagne, Révolution 3). À l’épreuve de cinq ans de présidence, que reste-t-il du projet de bousculer le « système » et de subvertir les codes et règles de la politique 4 ? À bien des égards, le « nouveau monde » reste très proche de l’ancien.
L’irrésistible droitisation du macronisme
Sur le terrain économique, le « en même temps » (et de gauche et de droite) de la campagne électorale de 2017 a été de courte durée. Le macronisme de 2017 pouvait encore être lu comme une entreprise de modernisation de la gauche. Il s’est rapidement révélé comme un néolibéralisme continué et exacerbé. Le dessein du président ne souffre pas l’ambiguïté : l’approfondissement du programme néolibéral et l’adaptation du modèle social français à la mondialisation. Rhétorique du « ruissellement », loi travail, suppression de l’impôt de solidarité sur la fortune, instauration de la flat tax sur les dividendes, réforme des retraites (quoique suspendue) : les grands marqueurs socio-économiques du quinquennat ne trompent pas. Les emblèmes ou « flotteurs » de gauche sont quant à eux peu nombreux : dédoublement des classes en CP en zone de Réseaux d’éducation prioritaire, « zéro reste à charge » pour le remboursement de lunettes et de prothèses auditives ou dentaires… Dans bien des domaines, comme le logement ou la santé, l’action publique s’inscrit dans la continuité des politiques antérieures.
Cette droitisation sur le terrain économique était prévisible, si l’on se souvient que le président de la République avait été l’artisan du Crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE) sous François Hollande. L’évolution sur la question des libertés ou du régalien est plus étonnante. Emmanuel Macron s’était construit à gauche en 2016-2017 contre le républicanisme aux accents sécuritaires de Manuel Valls. Il louait alors en matière d’immigration la politique d’Angela Merkel dont il saluait le mélange « de lucidité, de courage et d’humanité admirable ». Le glissement à droite est très net. Restriction sans précédent des libertés publiques qui indigne jusqu’aux soutiens libéraux de la première heure comme les avocats François Sureau ou Jean-Pierre Mignard, répression des Gilets jaunes, tournant sécuritaire aux accents sarkozystes avec Gérald Darmanin : le macronisme aujourd’hui est aussi une forme d’illibéralisme. On lisait dans Révolution : « Nous devons nous désintoxiquer du recours à la loi et de la modification incessante de notre droit criminel. » Les lois sur la sécurité se sont pourtant multipliées, les dernières en date concernant le « séparatisme » ou la « sécurité globale ». Quatre lois sur l’antiterrorisme ont été votées depuis 2017. Est-ce vraiment une surprise ? La trajectoire du macronisme pose une question plus générale : le néolibéralisme ne peut sans doute conduire qu’à une forme d’autoritarisme avec lequel il fait système.
La base électorale d’En marche s’en est trouvée modifiée. L’électorat de 2017 était, selon le politiste Pierre Bréchon, « un précipité composite à l’avenir incertain ». Dès les élections européennes (et même législatives), il s’est droitisé. Élu à gauche en 2017, Emmanuel Macron vise sans ambiguïtés, cinq ans plus tard, une réélection à droite. Agile, il a utilisé les politiques publiques pour fabriquer un nouveau socle électoral.
Le macronisme est aussi un pragmatisme. Confronté à deux crises majeures, sociale et sanitaire (les Gilets jaunes et la pandémie), le pouvoir a d’ailleurs démontré une certaine capacité d’adaptation. En 2020, Emmanuel Macron a su imposer aux « budgétaires » de Bercy un « quoi qu’il en coûte » en rupture avec l’orthodoxie dont il était pourtant un gardien. La crise sanitaire a certes quelque peu brouillé son image de réformateur, mais le cap est tenu : le gouvernement a maintenu la réforme du régime de l’assurance chômage en mars 2021.
Entre présidentialisme et proximité
La pratique du pouvoir institutionnel ne marque pas non plus de rupture. Emmanuel Macron s’inscrit pleinement dans le présidentialisme de la Ve République qu’il a poussé encore d’un cran. L’horizontalité de la campagne de 2017 a fait long feu. La concentration des pouvoirs s’est accentuée. Rarement une majorité parlementaire n’aura été aussi docile et disciplinée (malgré le départ de 29 députés entre 2017 et février 2021). Les corps intermédiaires ont été méthodiquement court-circuités. Si la démocratie participative a été mobilisée (débat public post-Gilets jaunes, convention citoyenne sur le climat), elle a été largement instrumentalisée. Pendant la crise sanitaire, le conseil de défense réuni à l’Élysée a supplanté le conseil des ministres 5.
Au fil du quinquennat, le président en exercice a compensé sa verticalité et ce surplomb « jupitérien » par une symbolique et une mise en scène de la proximité et du « terrain » qui renvoie, là encore, à un répertoire de légitimation politique traditionnelle 6. Une forme de conversion aux territoires s’est opérée. Sans expérience locale, à la différence des présidents de la République qui l’ont précédé, Emmanuel Macron a d’abord cultivé une certaine distance, voire condescendance, à l’égard des élus locaux. À partir de la crise des Gilets jaunes, qui révèle le caractère hors sol de La République en marche, il multiplie les signes d’attention à la France des territoires. En bras de chemise, des heures durant, il est au milieu des maires dans les « débats publics ». En 2017, La République en marche était « dégagiste » et opposée à la professionnalisation de la politique : lors des élections municipales de 2020, elle soutient largement des maires de droite installés. Le choix de nommer Jean Castex à Matignon équilibre ainsi la légitimité technocratique d’un commis de l’État avec la légitimité provinciale d’un petit maire rural.
En juin 2021, le président entame dans le Lot un tour de France pour « prendre le pouls du pays ». Ce retour au peuple s’inscrit également dans une pratique très ancienne et enracinée dans la République 7. Emmanuel Macron a peu à peu adopté les codes du métier politique. Le style transgressif du début de mandat n’est plus de mise, un polissage sémantique s’est opéré : finis les mots blessants et les outrances verbales, le « pognon de dingue », l’idée qu’il suffit de « traverser la rue » pour trouver du travail, ou l’interpellation des « fainéants et [des] cyniques ». Tout se passe comme si le président autrefois inexpérimenté avait appris la maîtrise de soi et la langue de bois constitutive du métier politique.
« La poutre travaille encore »
Si le macronisme s’est banalisé et normalisé, les conditions « disruptives » qui ont assuré son succès sont toujours réunies. Emmanuel Macron est toujours fort des faiblesses de ses adversaires. Les partis traditionnels continuent à se désagréger malgré la résilience (essentiellement territoriale) des Républicains et du Parti socialiste. La gauche ne s’est pas relevée ; à bien des égards, ses contradictions et divisions se sont même exacerbées. Emmanuel Macron peut d’autant plus assumer sa droitisation que la gauche ne représente pas une menace réelle : il n’y a toujours pas de débouché crédible pour l’électorat de gauche modéré. La droite connaît aussi une crise identitaire, renforcée par une absence de leadership clair. Son espace politique est asséché, elle est déchirée entre la tentation de rejoindre l’extrême droite et l’attraction idéologique de La République en marche. La fusion des listes LR et LREM en région PACA en avril dernier a donné à voir cet écartèlement. Emmanuel Macron s’emploie toujours à jouer de la décomposition des identités politiques et à poursuivre le « dépassement » engagé en 2017. Loin d’être affaibli, le Rassemblement national est en passe de devenir la principale opposition au pouvoir en place. Malgré les dénégations, le couple Macron-Le Pen est autant un duo qu’un duel.
Il n’y a toujours pas de débouché crédible pour l’électorat de gauche modéré.
C’est tout le paradoxe du macronisme. Alors qu’il présente de nombreuses faiblesses, ses chances de l’emporter en 2022 sont réelles. Jamais une entreprise politique sous la Ve République ne s’était appuyée sur des ressources aussi faibles et sur la personnalité exclusive d’un homme. Le président dispose d’une base électorale fidèle mais étroite, et il concentre une forte défiance sur sa personne. Aucune réelle personnalité n’a émergé depuis 2017 à LREM ou dans le gouvernement (à l’exception peut-être d’Édouard Philippe, à qui le président ne renouvelle pas sa confiance en juillet 2020). La majorité parlementaire n’a été qu’une chambre d’enregistrement. Le « parti-mouvement » du président est fantomatique ou inexistant. Il n’a gagné aucune région en 2021 comme il n’avait gagné aucune grande ville en 2020. Au terme du quinquennat, Emmanuel Macron est un président aussi faible qu’omnipotent. Il était une réponse possible à la crise démocratique en 2017. Depuis lors, elle s’est encore approfondie.
- 1.David Amiel et Ismaël Emelien, Le progrès ne tombe pas du ciel. Manifeste, Paris, Fayard, 2019.
- 2.Voir Myriam Revault d’Allonnes, L’Esprit du macronisme ou l’art de dévoyer les concepts, Paris, Seuil, 2021.
- 3.Emmanuel Macron, Révolution, Paris, XO éditions, 2016.
- 4.Voir Bernard Dolez, Julien Fretel et Rémi Lefebvre (sous la dir. de), L’Entreprise Macron, Grenoble, Presses universitaires de Grenoble, 2019.
- 5.Voir Brigitte Gaiti, « La décision dans la crise sanitaire ou la logique du désordre », The Conversation, 21 avril 2021.
- 6.Voir Christian Le Bart et Rémi Lefebvre (sous la dir. de), La Proximité en politique. Usages, rhétoriques, pratiques, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2009.
- 7.Voir Nicolas Mariot, Bains de foule. Les voyages présidentiels en province, 1888-2002, Paris, Belin, 2006.