entre égoïsmes contraints et quête de dignité
La publication quasi simultanée de Le Triomphe des égoïsmes1 de Camille Peugny et de C’était pas gagné !2 de Marwan Mohammed intervient à un moment charnière pour la gauche française. Ces deux ouvrages, l’un par son analyse macro-sociologique du basculement néolibéral, l’autre par son récit incarné des mécanismes de l’ascension sociale, offrent une grille de lecture indispensable pour comprendre pourquoi les valeurs de solidarité reculent, pourquoi les inégalités se creusent, et surtout, comment repenser l’action politique dans un contexte marqué par la défiance et le sentiment de déclassement. Leur force réside dans leur complémentarité : Camille Peugny dissèque les structures qui produisent l’égoïsme comme norme sociale, tandis que Marwan Mohammed, par son « auto-sociologie », rappelle que l’émancipation reste possible – mais à condition de restaurer les collectifs et les protections méthodiquement démantelés.
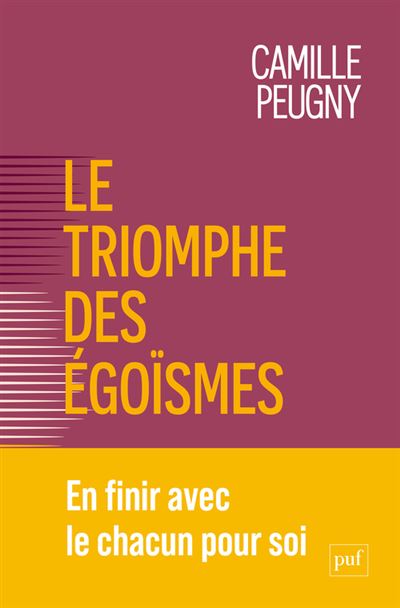
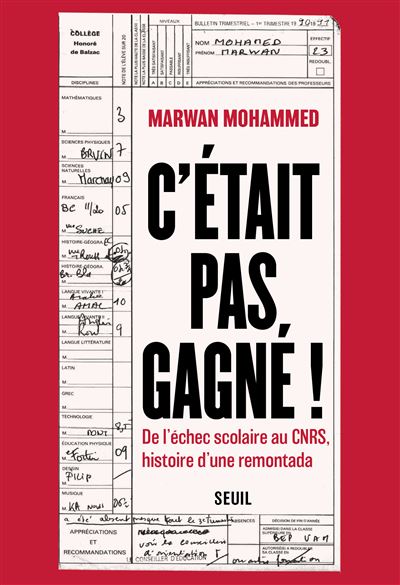
Ce qui frappe, à la lecture de ces travaux, c’est l’ampleur du décalage entre les aspirations à la dignité et à la justice sociale qui traversent la société française et l’incapacité de la gauche et du mouvement social à y répondre. La gauche politique, en particulier, semble prisonnière de ses propres catégories, incapables de saisir que la question sociale ne se réduit ni à la redistribution ni à l’égalité des chances, mais exige une prise en compte des réalités socio-culturelles, une refonte en profondeur des rapports de pouvoir et des rapports de production des inégalités. Pour sortir de cette impasse, les deux ouvrages pourraient nous aider à comprendre comment l’égoïsme s’est imposé comme une contrainte structurelle, puis mesurer l’ampleur des dégâts causés par le recul de l’État social, avant d’envisager les voies d’une reconstruction politique.
L’égoïsme comme produit d’un système : quand la compétition devient la norme
L’apport majeur du livre de Camille Peugny réside dans sa démonstration selon laquelle l’égoïsme n’est pas un trait psychologique, mais le résultat d’un système qui a fait de la concurrence généralisée son principe organisateur. Pour le sociologue pas-de-calaisien, il faut revenir à notre histoire : l’État social, construit après 1945 pour protéger les individus contre les aléas de la vie (chômage, maladie, vieillesse), a progressivement reculé sous l’effet des politiques néolibérales. Ce recul n’a pas signifié la disparition pure et simple des protections sociales – la France reste l’un des pays où les dépenses sociales sont les plus élevées de l’OCDE –, mais leur transformation en un filet de sécurité de plus en plus troué, laissant les individus livrés à eux-mêmes.
Ce qui change, dans ce contexte, c’est la nature des rapports sociaux. Là où l’État-providence agissait comme une assurance collective, son affaiblissement jette les individus dans une « lutte des places » où chacun doit maximiser ses ressources pour préserver sa position. Peugny reprend ici la prophétie inquiète de Robert Castel, qui, dès 19953, craignait que le retrait de l’État ne laisse place à une société où la vie sociale se réduirait à une struggle for life, une lutte pour la survie. 30 ans plus tard, le diagnostic est sans appel : cette logique de compétition s’est imposée dans tous les domaines, de l’école au travail, en passant par l’accès au logement ou aux services publics. L’égoïsme n’est plus une déviance, mais une rationalité imposée par un système qui récompense l’individualisme et pénalise la solidarité.
L’école, laboratoire de la compétition sociale
L’école est sans doute le terrain où cette dynamique est la plus visible. La massification scolaire, souvent célébrée comme un progrès, a en réalité déplacé les inégalités plutôt que de les réduire. Dans les années 1960, la moitié d’une classe d’âge quittait le système éducatif sans diplôme ; aujourd’hui, près de trois millions d’étudiants (apprentis inclus) fréquentent l’enseignement supérieur. Pourtant, cette ouverture n’a pas conduit à une démocratisation réelle. Les filières se sont hiérarchisées (bacs généraux vs professionnels, grandes écoles vs universités), et les stratégies de contournement – recours au privé, optimisation des options, déménagements pour accéder aux « bons » établissements – se sont généralisées parmi les classes favorisées.
Les données du ministère de l’Éducation nationale, analysées par Camille Peugny, révèlent une segmentation sociale croissante : en 15 ans, la part d’élèves issus de milieux favorisés a augmenté de 15 à 20 points dans les collèges et lycées privés, tandis qu’elle stagnait dans le public. Ce mouvement n’est pas neutre : il reflète une logique d’« entre-soi » où les familles aisées cherchent à protéger leurs enfants de la mixité sociale, perçue comme une menace pour leur réussite. Le choix du privé, souvent justifié par la recherche d’une « meilleure qualité pédagogique », obéis en réalité à une forme de rationalité, mais une rationalité égoïste : en retirant leurs enfants du système public, ces familles contribuent à affaiblir les établissements fréquentés par les classes populaires, aggravant ainsi les inégalités.
Ce phénomène s’inscrit dans une tendance plus large : la marchandisation de l’éducation. Comme le note Nora Hamadi dans La Maison des rêves4, les activités autrefois portées par l’éducation populaire (clubs sportifs, centres aérés, colonies de vacances) avec le soutien des municipalités ont été remplacées par des offres privées (salles de sport, stages payants) individualisantes, réservées à ceux qui en ont les moyens. Résultat : les enfants des quartiers populaires, déjà pénalisés par les inégalités scolaires, voient aussi se réduire les espaces où ils pourraient compenser ces handicaps par des expériences collectives.
Le travail, terrain de l’individualisation forcée
Le monde du travail offre un autre exemple frappant de cette dynamique. Les transformations du capitalisme – précarisation, ubérisation, individualisation des carrières – ont fragilisé les collectifs qui structuraient autrefois les classes populaires. Les ouvriers d’hier, intégrés dans de grandes entreprises et protégés par des syndicats puissants, ont cédé la place à une myriade de statuts précaires : aides à domicile, livreurs, intérimaires, auto-entrepreneurs. Ces travailleurs, souvent isolés, n’ont plus accès aux solidarités qui permettaient autrefois de résister à l’exploitation.
Peugny illustre cette réalité par une enquête menée auprès de femmes de ménage employées par une grande entreprise de services à la personne5. Ces salariées, bien que techniquement protégées par un contrat, sont en réalité livrées à elles-mêmes : ceux qu’elles considèrent comme leurs véritables employeurs sont les clients particuliers chez qui elles interviennent, et leur temps de travail est morcelé entre plusieurs statuts (salariée de l’entreprise, employée directe d’un particulier, travail au noir). Leur stratégie ? Une forme d’« auto-assurance » : elles enchaînent les petits boulots, cumulent les employeurs, et tentent de tirer parti des failles du système (allocations chômage, travail non déclaré) pour survivre. Mais cette logique, rationnelle à court terme, les conduit droit vers la précarité à long terme : arrivées à l’âge de la retraite, beaucoup se retrouvent au niveau du minimum vieillesse, ayant cotisé trop peu pour bénéficier d’une pension décente.
Ce que révèle cette enquête, c’est l’absence de choix réel. Ces femmes ne sont pas des « profiteurs » du système, comme le suggère le discours d’un Retailleau ou d’un Wauquiez sur l’« assistanat », mais des victimes d’un modèle qui les contraint à bricoler leur survie faute de protections collectives. Leur « égoïsme » – si tant est que le terme soit approprié – est une réponse à un environnement hostile, où les solidarités traditionnelles (syndicats, mutuelles) ont été démantelées.
L’État social et l’éducation populaire : des leviers d’émancipation aujourd’hui sabotés
Le récit de Marwan Mohammed dans C’était pas gagné ! offre un contrepoint précieux à l’analyse de Peugny. Son parcours, de l’échec scolaire au CNRS, est emblématique d’une époque où l’ascenseur social fonctionnait encore, non grâce à une mystérieuse « méritocratie », mais grâce à des collectifs et des institutions aujourd’hui affaiblis. Ce qui frappe, dans son histoire, c’est le rôle décisif joué par l’éducation populaire et les politiques sociales : le BAFA, les animateurs de quartier, les dispositifs d’équivalence de bac, et surtout, la présence d’adultes engagés qui ont su repérer son potentiel et l’orienter vers des voies auxquelles il n’aurait jamais eu accès autrement étant un « mauvais élève ».
L’éducation populaire, un héritage en voie de disparition
Les années 1980-1990, période où Marwan Mohammed grandit, étaient encore marquées par la vitalité des centres sociaux, des MJC et des associations de quartier. Ces espaces, financés par les municipalités et les caisses d’allocations familiales, offraient aux jeunes des quartiers populaires des activités gratuites ou à moindre coût (sport, théâtre, soutien scolaire), mais surtout, une socialisation à la citoyenneté. Nora Hamadi présente ces lieux comme des « petits bouts de République » où se forgeaient des solidarités transcendant les origines sociales. Leur déclin, accéléré par les politiques d’austérité et la marchandisation des loisirs, a laissé un vide que comblent désormais la précarité et, dans certains cas, la délinquance.
M. Mohammed insiste sur un point crucial : il refuse d’être assimilé à un « transfuge de classe », prétendant être resté ancré dans son milieu. Contrairement à une certaine conception de l’idéologie méritocratique, qui célèbre les parcours individuels, son histoire montre que la réussite dépend de collectifs – famille, éducateurs, syndicats. Or, ces collectifs se délitent. Les classes populaires, autrefois structurées par le salariat industriel et ses solidarités (syndicats, mutuelles), sont aujourd’hui fragmentées en une myriade de statuts précaires : aides à domicile, livreurs, intérimaires. Comme le décrit Camille Peugny, ces travailleurs, souvent isolés, deviennent des « auto-entrepreneurs de leur précarité ».
L’école, entre promesse d’émancipation et machine à reproduire les inégalités
L’école, elle aussi, aurait perdu sa fonction émancipatrice. L’échec scolaire initial de M. Mohammed n’a pas été compensé par une institution capable de le « rattraper », mais par des rencontres (un animateur, un livre de Bourdieu) dans un environnement socio-culturel organisé. Pourtant, comme le montre Peugny, l’école reste le principal vecteur de légitimation des inégalités : en France, le diplôme détermine le destin social. Mais lorsque la massification scolaire se traduit par une filiarisation des parcours, et que les inégalités territoriales (comme l’écart d’une année de cours entre la Seine-Saint-Denis et Paris) ne sont pas corrigées, l’école devient un outil de reproduction plutôt que de mobilité.
Le problème n’est pas seulement que l’école ne réduit pas assez les inégalités, mais qu’elle les naturalise. En faisant du diplôme le sésame unique pour l’accès aux positions sociales, la société française donne l’illusion que les inégalités sont le résultat d’un processus « méritocratique », où chacun aurait eu les mêmes chances. Or, comme le montrent les travaux de Peugny, les inégalités scolaires sont d’abord des inégalités sociales : un enfant de cadre a toujours dix fois plus de chances d’accéder aux grandes écoles qu’un enfant d’ouvrier. La massification a simplement déplacé le problème : les inégalités ne sont plus quantitatives (accès ou non au secondaire ou au supérieur), mais qualitatives (accès à quelle filière, quel diplôme, quel réseau).
La disparition des collectifs : un appauvrissement politique
Ce qui ressort des deux ouvrages, c’est l’appauvrissement des espaces de solidarité. Que ce soit les syndicats, les associations de quartier, les partis politiques ou même les familles élargies, les collectifs qui permettaient autrefois de résister à l’individualisation forcée se sont affaiblis. Cet affaiblissement n’est pas un hasard : il résulte de politiques délibérées de démantèlement des protections sociales, de précarisation du travail et de marchandisation des services publics.
Prenons l’exemple des « embrouilles » entre quartiers, analysées en 2023 par Marwan Mohammed dans Y’a embrouille (Stock). Ces violences, souvent réduites à des « rixes » ou à de la « délinquance », s’inscriraient en réalité dans un contexte où les jeunes des quartiers popilaires, exclus des voies traditionnelles de reconnaissance (école, emploi stable), trouvent dans la rue un substitut de statut social. Les bandes, les rivalités territoriales, les « descentes » ne sont pas des phénomènes irrationnels, mais des réponses à un environnement où la dignité est niée par ailleurs. Comme l’écrit Mohammed, « l’embrouille » offre une forme de reconnaissance là où l’école et le travail échouent.
Ce qui est frappant, c’est que ces dynamiques ne sont pas nouvelles. Les travaux de Jean-Claude Monod (Les Barjots, 1968) ou de David Lepoutre (Cœur de banlieue, 2001) montraient déjà comment les bandes de jeunes compensaient l’absence de perspectives par des logiques d’honneur et de territoire. Mais ce qui a changé, c’est l’absence de contrepoids : là où les centres sociaux, les éducateurs de rue ou les syndicats pouvaient autrefois offrir des alternatives, ils ont aujourd’hui disparu ou été marginalisés.
La gauche face à ses impensés : égalité des chances ou égalité des droits ?
Le diagnostic posé par Peugny et Mohammed révèle un paradoxe : alors que les inégalités n’ont jamais été aussi visibles (80% des cadres reconnaissent leur réalité et prédisent leur aggravation), les discours et actes politiques peinent à les combattre. La gauche, en particulier, est prisonnière de ses propres contradictions. D’un côté, la plus grande partie de ses organisations politiques défend l’égalité des chances, un concept qui, comme le rappelle Peugny, légitime la compétition tant qu’elle est « juste ». De l’autre, elle néglige l’égalité des conditions, c’est-à-dire la garantie d’une vie digne pour tous, indépendamment des verdicts de la compétition scolaire ou professionnelle.
Cette tension explique en partie son déclin électoral. Les classes moyennes supérieures, qui avec les classes moyennes avaient la victoire de 1981, gagnées aux valeurs néolibérales, ne trouvent plus dans la gauche un projet mobilisateur. Quant aux classes populaires, elles se tournent vers l’abstention ou l’extrême droite, lasse d’un discours qui célèbre l’émancipation sans proposer de solutions concrètes à leur précarité. Pour Nora Hamadi, la gauche a souvent lâché les services publics au nom de la rationalité budgétaire, abandonnant les territoires (quartiers comme zones rurales) où se joue la dignité quotidienne.
Le piège de l’égalité des chances
L’égalité des chances est un concept piégé. En apparence progressiste – qui pourrait être contre le fait que chacun ait les mêmes opportunités ? –, il légitime en réalité un système où les inégalités de départ sont naturalisées. Pour Peugny, « même si l’on parvenait à construire une école parfaite où chaque enfant aurait les mêmes chances de réussir, cela ne réglerait pas le sort des ‘perdants’ de la compétition ». Autrement dit, tant que la société continuera à hiérarchiser les positions sociales (cadres vs ouvriers, diplômés vs non-diplômés), l’égalité des chances ne fera que reproduire les inégalités sous une forme plus acceptable.
Prenons l’exemple des politiques éducatives. Les dispositifs comme les « cordées de la réussite » ou les internats d’excellence visent à donner à quelques élèves issus de milieux défavorisés les moyens de rivaliser avec les enfants des classes favorisées. Mais ils ne remettent pas en cause la structure même du système, qui réserve les meilleures places à une élite. Pire : en se concentrant sur une poignée de « méritants », on laisse entendre que ceux qui n’y sont pas n’ont qu’à s’en prendre à eux-mêmes.
La dignité comme horizon politique
Face à cette impasse, Peugny propose de faire de la dignité le socle d’un nouveau contrat social. Ce concept, plus large que celui d’égalité, permet d’articuler des revendications apparemment disjointes : salaires décents, lutte contre les discriminations, accès aux services publics, égalité réelle femmes-hommes. La dignité, c’est le droit à ne pas être traité comme un citoyen de seconde zone, qu’on soit caissière, ouvrier ou jeune de banlieue.
Cette approche rejoint les analyses de Marwann Mohammed sur l’importance des collectifs. Pour lui, la dignité passe par la restauration des espaces où les individus peuvent se reconnaître comme égaux : centres sociaux, syndicats, associations. Elle implique aussi de rompre avec l’illusion selon laquelle la croissance suffira à résoudre les tensions.
Repenser l’action publique : trois pistes concrètes
1. La pré-distribution plutôt que la redistribution
La France excelle dans la redistribution a posteriori (via les prestations sociales), mais échoue à réduire les inégalités a priori. Des mesures comme le dédoublement des classes en ZEP, efficaces mais limitées, montrent que l’école peut être un levier – à condition d’y investir massivement. De même, la formation professionnelle tout au long de la vie pourrait atténuer le déterminisme des diplômes initiaux. L’enjeu est de passer d’une logique de compensation (aider ceux qui ont échoué) à une logique de prévention (éviter que l’échec ne se produise).
2. Réinvestir les collectifs et l’éducation populaire
Le déclin des centres sociaux, des MJC ou des clubs sportifs associatifs a privé les classes populaires d’espaces de solidarité. Leur relance réelle, couplée à un soutien aux « personnalités-ponts » (élus, militants, intellectuels issus de ces milieux), pourrait recréer du lien. Comme le suggère M. Mohammed, une « sociologie populaire », alliant recherche et engagement, pourrait aider à concevoir des politiques plus ancrées dans les réalités vécues.
3. Lutter contre la patrimonialisation de la société
La transmission des 9 000 milliards d’euros du baby-boom d’ici 2040 risque d’accentuer les inégalités6. Des outils comme l’impôt sur la succession ou le plafonnement des héritages pourraient limiter cette dynamique. Plus largement, il s’agit de rompre avec l’illusion selon laquelle la croissance suffira à résoudre les tensions.
Une gauche à réinventer, entre réalisme et radicalité
Les travaux de Peugny et Mohammed offrent une boussole pour une gauche en quête de renouveau. Leur force réside dans leur refus des fausses oppositions : entre « sociétal » et « social », entre mérites individuels et déterminismes collectifs, entre classes populaires et classes moyennes. Leur message est clair : l’égoïsme n’est pas une fatalité, mais le résultat sociologique de choix politiques. Pour le combattre, il faut restaurer des protections collectives, réinvestir dans les services publics et, surtout, cesser de penser la justice sociale en termes de « chances » pour la concevoir en termes de droits.
Ce projet exige de rompre avec plusieurs illusions. D’abord, l’illusion selon laquelle il suffirait de « mieux redistribuer » pour résoudre les inégalités. Comme le montre Peugny, le problème n’est pas seulement la taille du gâteau, mais sa répartition et les règles du jeu qui la déterminent. Ensuite, l’illusion selon laquelle la gauche pourrait se contenter de « gérer l’existant » sans proposer une alternative crédible au néolibéralisme et à la situation de production actuelle. Enfin, l’illusion selon laquelle les luttes culturelles (contre le racisme, le sexisme) et les luttes sociales (pour les salaires, les services publics) seraient séparées. Au contraire, comme le montrent les « embrouilles » des quartiers, les conflits sociaux à bas bruit dans les entreprises ou le burn-out des cadres, ces combats sont indissociables.
En somme, la sociologie politique de Peugny et Mohammed rappelle que la gauche ne manquera pas d’idées à condition qu’elle sache écouter la société. Son défi ? Transformer ces diagnostics en un projet capable de redonner espoir à ceux que le néolibéralisme a laissés sur le bord de la route. Cela passe par un retour à l’État stratège, capable de pré-distribuer les ressources plutôt que de se contenter de redistribuer les miettes. Cela implique aussi de réconcilier les luttes pour la dignité, qu’elles soient culturelles, sociales ou économiques. Enfin, cela exige de rompre avec l’illusion technocratique selon laquelle des réformes marginales suffiraient, alors que la crise est systémique.
La gauche a aujourd’hui le choix : soit elle continue à naviguer à vue, prisonnière de ses propres catégories, soit elle saisit l’opportunité offerte par ces travaux et d’autres pour repenser radicalement son projet. Dans un contexte marqué par la montée de l’extrême droite, qui profite parfaitement de cette société de l’égoïsme généralisé, et la défiance envers les institutions, cette refondation n’est pas un luxe, mais une nécessité vitale.
Frédéric Faravel
1 Camille Peugny – Le triomphe des égoïsmes, Une nouvelle contrainte sociale – Presses universitaires de France, 13 janvier 2026
2 Marwan Mohammed – C’était pas gagné ! De l’échec scolaire au CNRS, histoire d’une remontada – Le Seuil, 16 janvier 2026
3 Robert Castel, né le 27 mars 1933 à Saint-Pierre-Quilbignon et mort le 12 mars 2013 à Paris 15e, est un sociologue et philosophe français, spécialiste de sociologie du travail et des questions relatives à l’exclusion sociale. L’ouvrage auquel Peugny fait référence est Les métamorphoses de la question sociale : une chronique du salariat, Fayard, Paris, 1995
4 Nora Hamadi – La Maison des Rêves. Une histoire des banlieues française, Flammarion, septembre 2025
5 Dans l’émission La Suite dans les idées sur France Culture le 22 janvier dernier, Camille Peugny revient ainsi sur l’impulsion de cette enquête : « C’est une commande syndicale de la CFDT via l’IRES : comment s’implanter donc, face aux difficultés, comment pouvoir s’implanter dans ces entreprises de services à la personne. Je me rends dans une ville de l’ouest de la France, qui est également le siège social de l’entreprise, là où il y a d’autres salariés, de la comptabilité, de la paie, etc. Je fais un certain nombre d’entretiens avec ces femmes de ménage. La commande syndicale, c’est en fait, elles sont toujours seuls, il n’y a pas de collègues, pas de collectif de travail, on ne peut pas les voi, leur parler, les rencontrer, et c’est pour ça qu’on ne parvient pas à les mobiliser. C’est vrai, bien sûr. Mais ce qu’a révélé l’enquête, c’est aussi que, finalement, ces syndicats résonnent dans le cadre du salariat, comme si l’aspiration à un contrat de travail en CDI, 35 heures par semaine, était le cadre de pensée et l’ambition, le souhait de ces femmes de ménage. »
6 Face à la « grande transmission », l’impôt sur les grandes successions – Fondation Jean-Jaurès, 27 novembre 2024 : https://www.jean-jaures.org/publication/face-a-la-grande-transmission-limpot-sur-les-grandes-successions/










