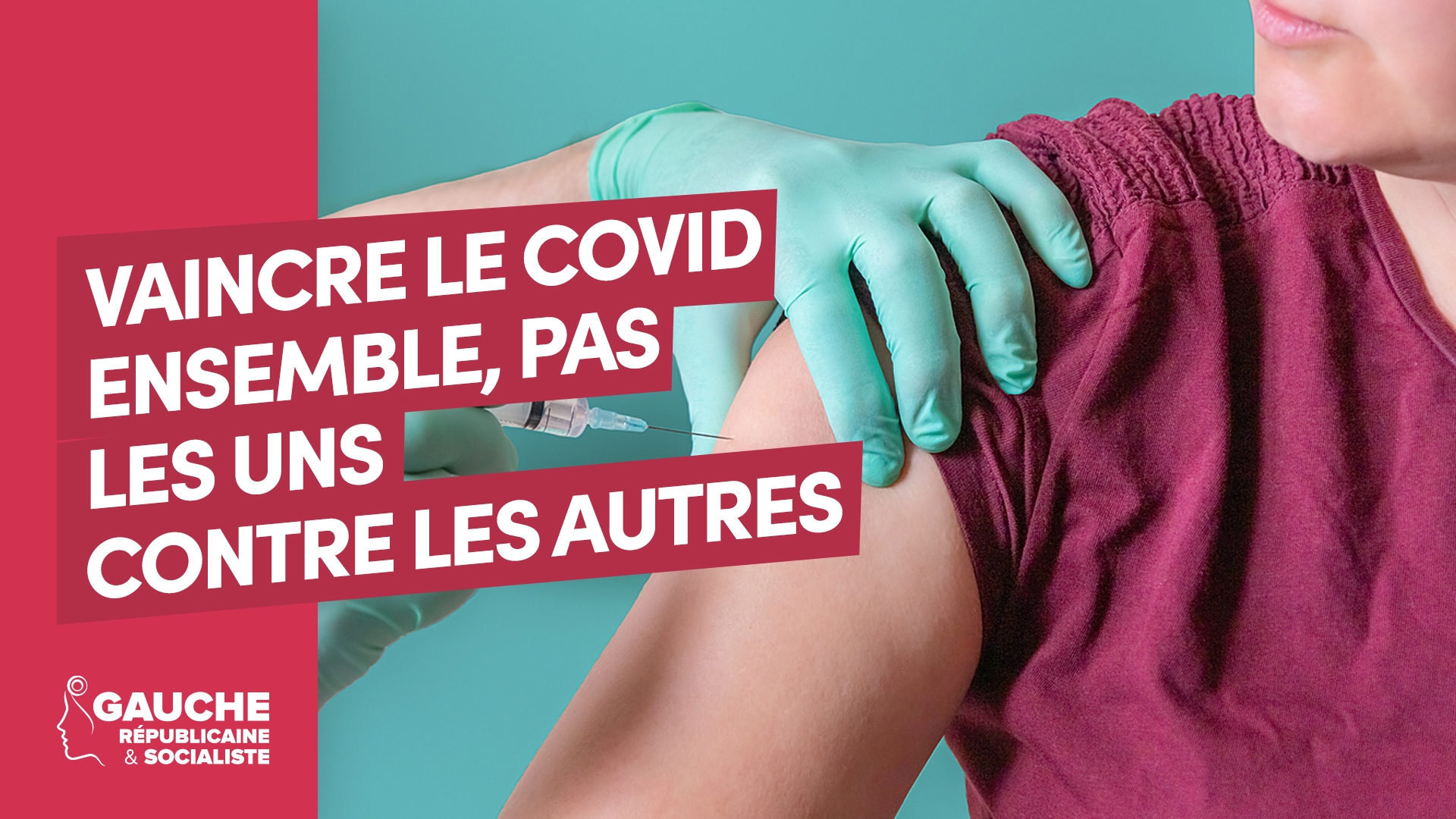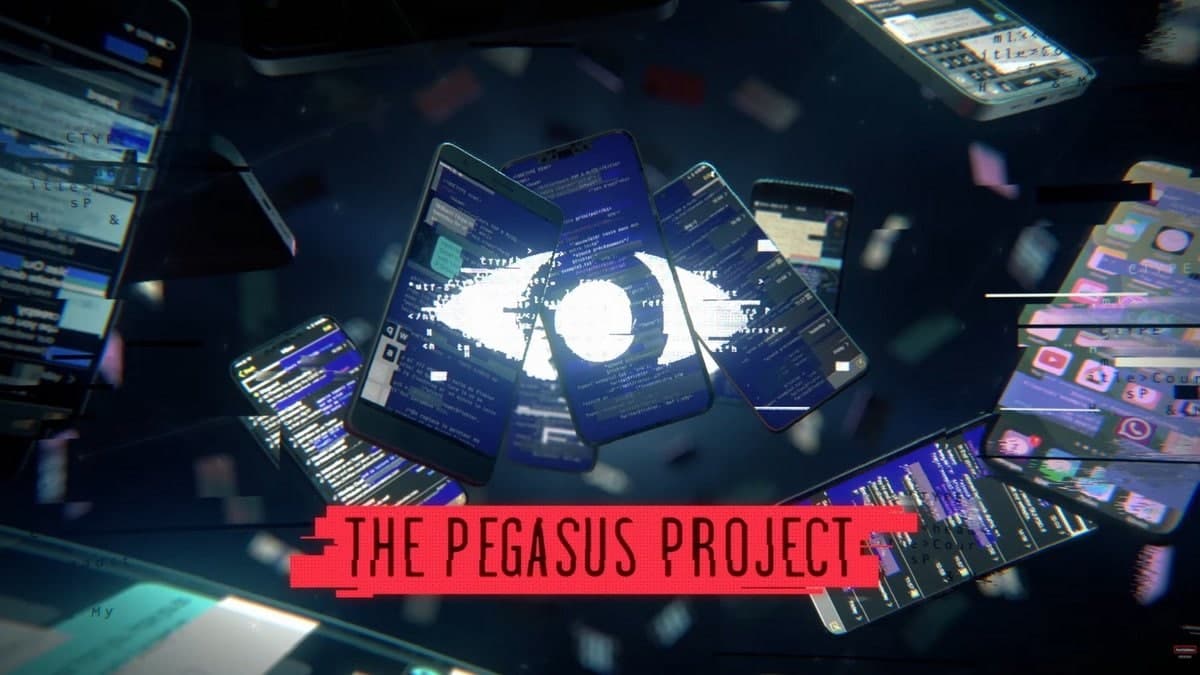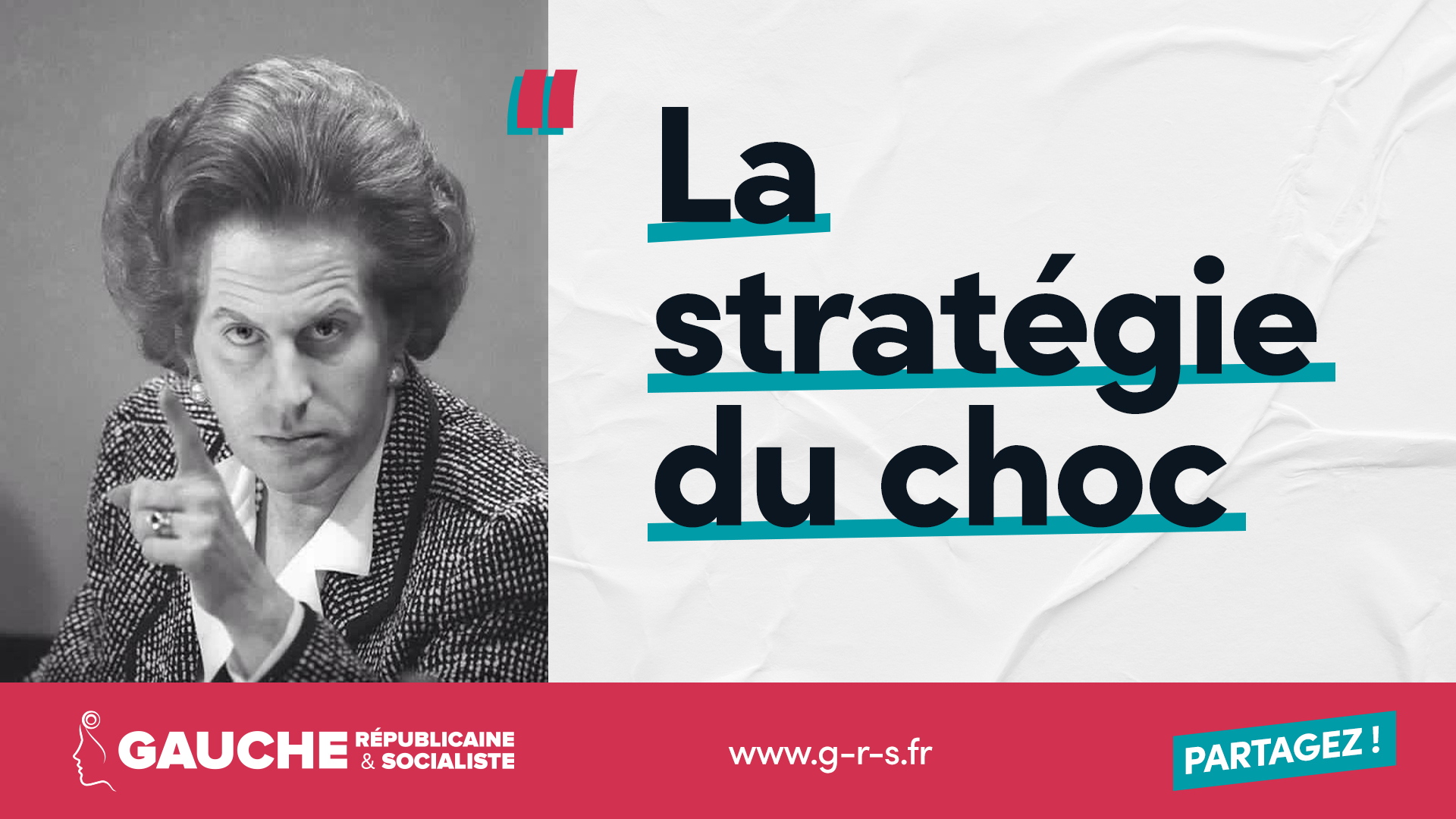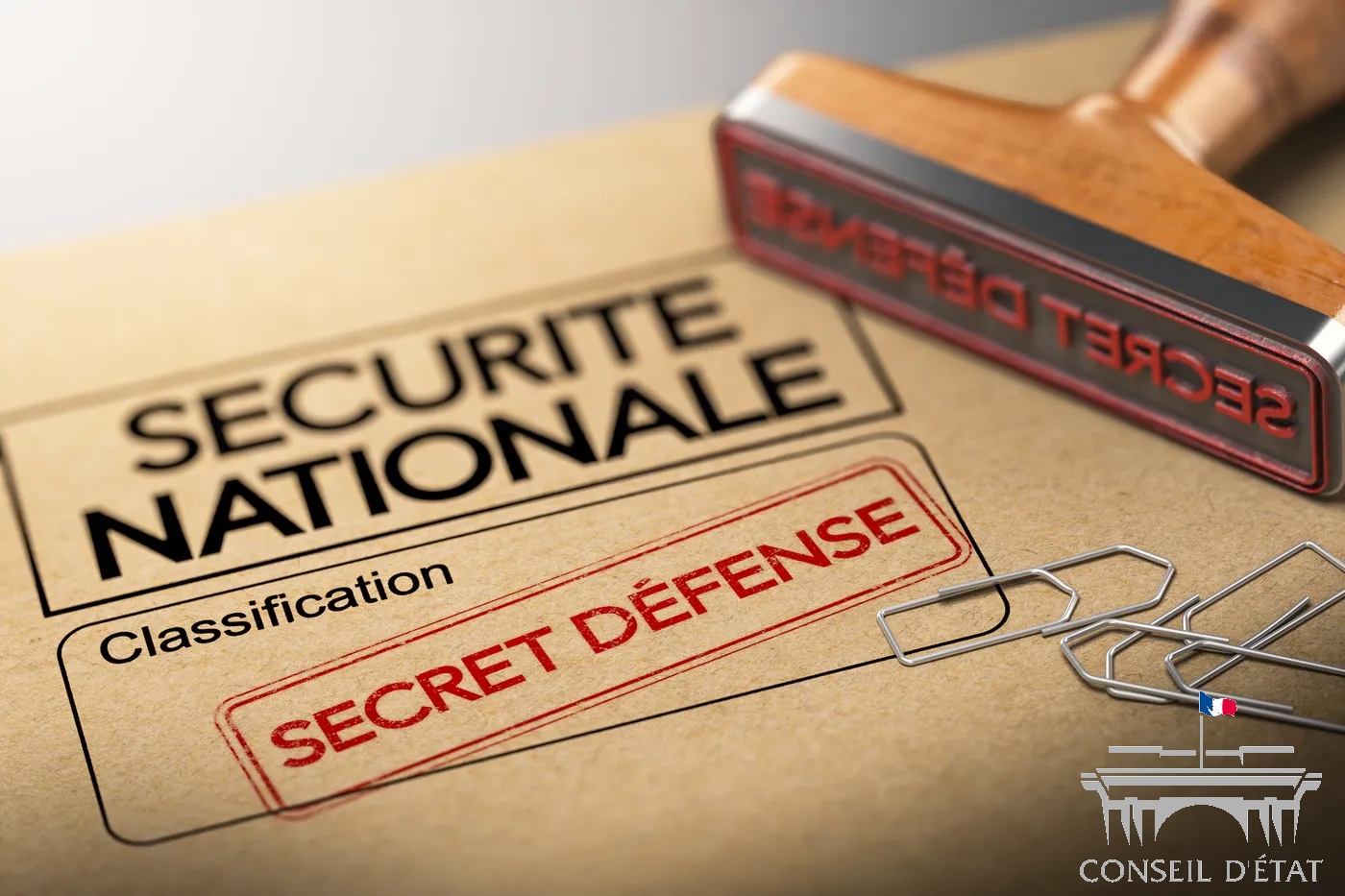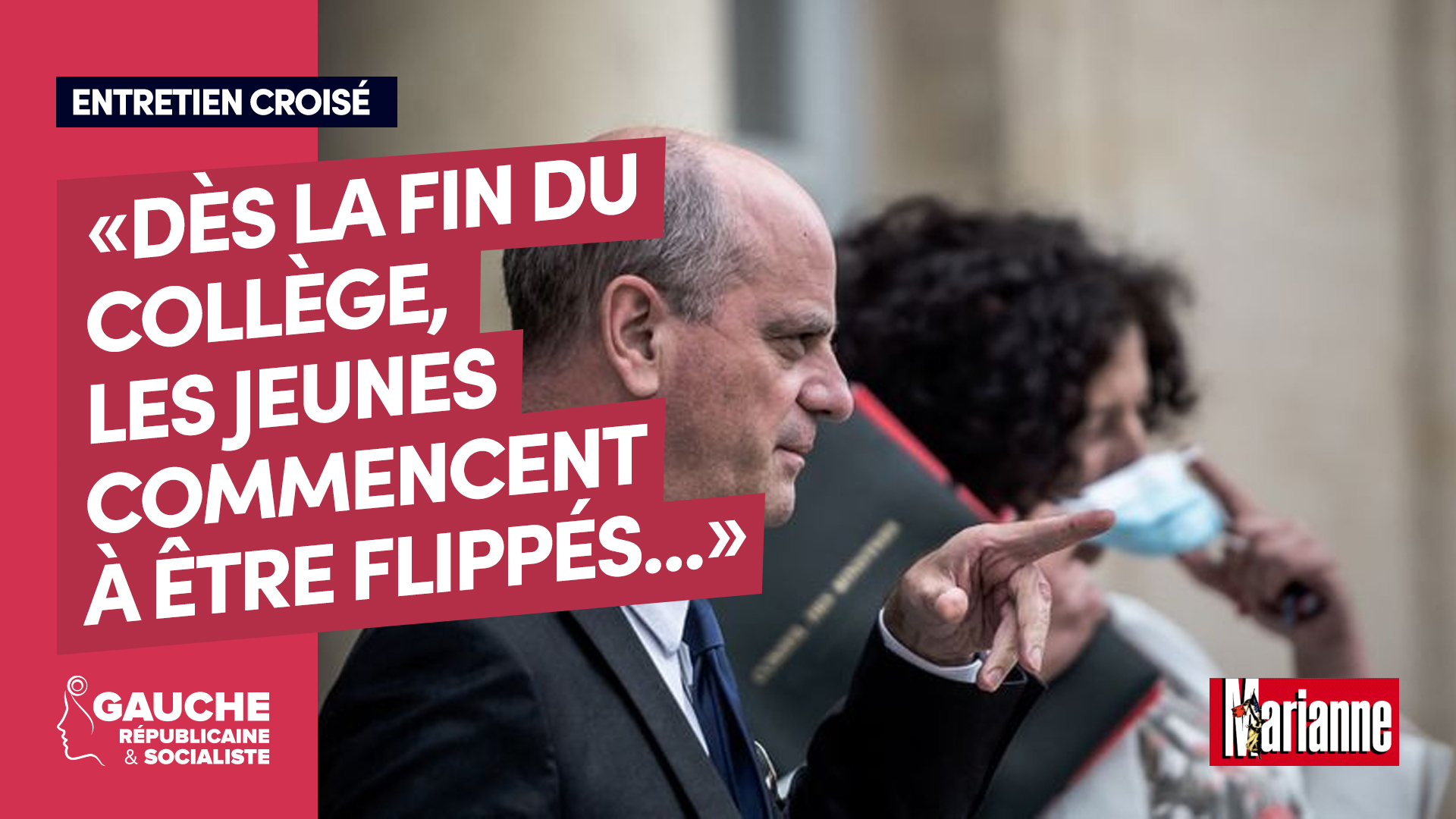1️⃣ La Gauche Républicaine et Socialiste est favorable à la vaccination la plus large possible contre le COVID 19. La vaccination est l’outil le plus efficace pour prévenir les cas graves de la maladie et ralentir la diffusion du virus.
2️⃣ La Gauche Républicaine et Socialiste demande que soit enfin mis en œuvre une véritable campagne d’information et de sensibilisation sur la vaccination, afin de faire reculer l’inquiétude d’une partie de nos concitoyens et les fausses informations qui ont par défaut un écho disproportionné. Nous constatons avec amertume que ce n’est toujours pas la voie prise par le gouvernement et que rien n’a été fait sérieusement en ce sens depuis le début de la campagne de vaccination.
3️⃣ La Gauche Républicaine et Socialiste demande que des efforts plus importants soient faits pour toucher les publics les plus éloignés de la vaccination, pour multiplier les lieux – au plus près de nos concitoyens – où elle est proposée et sur les plages horaires les plus larges possibles. Quoi qu’il en coûte ! Un effort particulier doit être fait en direction des quartiers populaires et de l’ensemble de nos territoires que l’on peut qualifier de « déserts médicaux », qui sont aujourd’hui de fait privés d’accès correct au vaccin.
4️⃣ Nous sommes opposés à un Pass Sanitaire qui ne serait pas strictement encadré dans le temps et qui ne serait pas limité à certaines activités, comme celles qui étaient prévues initialement par la loi du 18 mai 2021 (évènements de plus de 50 personnes, etc.). Ce n’est pas le choix qui a été fait par le gouvernement, qui non seulement se contredit lui même en quelques semaines mais qui, de surcroît, met en place des mesures clairement disproportionnées par rapport au but recherché.
5️⃣ Nous sommes particulièrement opposés aux mesures qui créent un précédent dangereux dans le code du travail en faisant de la détention d’une preuve de test négatif ou d’un schéma vaccinal complet le début d’une justification de licenciement. L’état de santé d’un salarié ne doit pas être connu de son employeur et ne saurait jamais être un motif de licenciement.
6️⃣ Nous sommes opposés à la présentation d’un Pass Sanitaire pour accéder à l’hôpital public et aux établissements de santé : nul ne doit être empêché de se soigner, d’accompagner un proche souffrant qui a besoin de soins et ne peut rester seul, de saluer la dépouille d’un proche décédé.
7️⃣ Nous demandons que soit enfin mis en œuvre et de toute urgence un plan de sécurisation des lieux clos : Filtres HEPA et capteurs de CO2 sont des moyens identifiés et documentés d’amélioration et de mesure de la qualité de l’air. C’est notamment un investissements prioritaires à réaliser dans les établissements scolaires et universitaires qui doit être couplé avec une préparation de la rentrée qui n’a à ce stade pas pris en compte l’évolution de la situation. Nous refusons que les insuffisances constatées lors des précédentes et l’abandon des étudiants se reproduisent.
8️⃣ Nous dénonçons l’absurdité qui amènerait à exiger dans les TGV ou intercités un Pass Sanitaire, quand pour des raisons évidentes de praticabilité celui-ci ne le sera pas dans les réseaux de transports en commun des grandes agglomérations, qui ne sont pas moins exposés. La cohérence gouvernementale s’effondre quand la justification sanitaire fait place à des considérations opportunistes.
9️⃣ Nous refusons que les adolescents se voient opposés la détention d’un Pass Sanitaire, dont l’absence signifierait une entrave à leur épanouissement et bon développement.
🔟 Nous exigeons enfin que les tests PCR continuent d’être remboursés par l’assurance maladie. Leur déremboursement constituerait une erreur terrible qui empêcherait la mesure et le contrôle de l’épidémie et donc irait à l’encontre des intérêts sanitaires du peuple français.
Pegasus : une réaction forte de la France est indispensable
La Gauche Républicaine et Socialiste appelle à une réaction forte de la France suite aux révélations sur le « Projet Pegasus ».
Les révélations du consortium de journalistes à l’initiative de Forbidden Stories et d’Amnesty International sur le « Projet Pegasus » sont choquantes. Prévu à l’origine, selon l’entreprise NSO le commercialisant, pour combattre le terrorisme et la criminalité organisée, le logiciel « Pegasus » a totalement été détourné de cet objectif. Ces informations illustrent de manière très concrète la guerre souterraine que mènent de nombreux régimes à l’encontre de journalistes, de militants des droits humains et de personnalités politiques. Infiltré sur le téléphone des personnalités visées, sans même avoir besoin de recourir à des techniques d’hameçonnage, cet outil met directement en danger leur sécurité ainsi que leur liberté d’informer et d’agir.
Un nombre important de responsables politiques français, dont le Président de la République et plusieurs membres des gouvernements Philippe et Castex, ainsi que des journalistes de médias nationaux ont aussi été placés sur la liste de cibles potentielles de ce logiciel. Ces révélations appellent à une réaction forte de l’exécutif. Car ce n’est pas la première fois que la France est victime d’une telle entreprise. On se souvient de l’affaire Snowden et des écoutes réalisées par la National Security Agency américaine contre la France, l’Allemagne et d’autres partenaires qui n’avaient engendré à l’époque qu’une réponse timorée de la part du gouvernement français.
Des plaintes ont déjà été déposées. Nous espérons qu’elles permettront de faire toute la lumière sur la responsabilité de gouvernements étrangers, ou de certaines de leurs agences, dans la mise en place de ce système qui a visé la tête de l’Etat mais aussi de nombreux lanceurs d’alerte à l’étranger. La France doit rappeler à ses voisins et partenaires que de telles pratiques ne peuvent avoir cours pour préserver des liens de confiance.
Néolibéralisme et crise sanitaire : La stratégie du choc
En regardant Emmanuel Macron ce lundi 12 juillet, on peut fortement penser au remarquable ouvrage de l’intellectuelle canadienne Naomi Klein.
Elle montrait dans ce livre non pas que les catastrophes naissaient de complots, mais plutôt la manière dont le pouvoir exploitait chacune d’elles. Comment le tsunami de 2004 avait été exploité au Sri Lanka pour procéder à des juteuses opérations immobilières au détriment des pécheurs locaux ou comment Milton Friedman, l’un des maîtres à penser des libéraux, avait vu l’ouragan Katrina comme une opportunité pour réformer le système d’éducation en Nouvelle-Orléans en privatisant les écoles publiques à reconstruire, chose qui n’aurait jamais été acceptée par la population en temps normal. On pourrait rajouter la manière dont la guerre des Malouines avait porté Margareth Thatcher vers sa réélection alors que juste avant sa politique était massivement condamnée par la population britannique.
On a souvent comparé la brutalité de la politique d’Emmanuel Macron à celle de Margareth Thatcher et il est maintenant à souhaiter que la guerre contre la COVID ne soit pas pour Macron ce que les Malouines ont été pour la dame de fer. En tout cas, dans son allocution du 12 juillet, Emmanuel Macron a fait un mélange des genres qui a montré sa volonté d’utiliser les mesures d’urgence contre la COVID et la menace d’une quatrième vague pour vendre 2 mesures scélérates et purement idéologiques : la réforme des retraites et celle de l’assurance chômage. La ficelle est un peu grosse, mais ne surprendra certainement pas Naomi Klein qui a démontré que la méthode avait déjà fait ses preuves ailleurs.
Annoncer la mise en place de l’assurance chômage le 1er octobre est un véritable scandale démocratique. En effet, le Conseil d’État doit se prononcer sur cette réforme en novembre et la mettre en place avant cet avis est un moyen de mettre une énorme pression sur cette instance. Il faudra beaucoup de courage au Conseil d’État pour retoquer cette réforme d’amateurs, unanimement condamnée par tous les partenaires sociaux autant par les syndicats de salariés que par le MEDEF. Mais les travailleurs sans emploi sont une cible facile, peu organisés collectivement, ils sombreront dans la misère en silence et c’est tout ce qui intéresse ce gouvernement. Emmanuel Macron a justifié sa désastreuse réforme par cet argument : « Actuellement, il faudrait qu’on gagne mieux sa vie en travaillant qu’en restant au chômage ». C’est un bel hommage à la réforme actuelle avec laquelle on ne pouvait pas perdre d’argent en allant travailler. Il a trouvé une autre méthode consistant à plonger les travailleurs sans emploi dans la misère pour qu’ils puissent accepter n’importe quoi. Dans une période où près de 6 millions de personnes sont inscrites à Pôle-Emploi toute catégorie confondue, cette nouvelle assurance chômage plutôt adaptée a une société de plein emploi va plonger des centaines de milliers de personnes sous le seuil de pauvreté.
Le recul de l’âge légal de la retraite est un non-sens dans une société plombée par le chômage de masse. Même Emmanuel Macron en convenait il y a peu. Mais la période est propice pour oser les pires projets. Les économies réalisées par cette réforme seront reportées et sur l’assurance santé, qui sera plombée par le vieillissement de la population active, et sur l’assurance chômage. Mais on l’a vu, les travailleurs sans emploi sont des coupables parfaits pour ce pouvoir et il sera toujours possible de les faire repasser à la caisse plus tard…
Naomi Klein concluait par cette phrase : voilà en quoi consiste la stratégie du choc : des raids systématiques contre la sphère publique au lendemain de catastrophes, quand les gens sont trop focalisés sur l’urgence, sur leur survie pour protéger leurs intérêts. La manière dont Emmanuel Macron a lié lors d’une même allocution mesures d’urgence et attaques ciblées contre des conquis sociaux en est la triste illustration.
Alors à l’automne, mobilisons-nous pour nos retraites, mais aussi pour les travailleurs sans emploi. Tous les syndicats doivent se mobiliser, une union de tous les travailleurs, avec ou sans emploi doit être massive pour défendre nos conquis sociaux face à ces fossoyeurs du modèle social français.
14 Juillet, la République sans cesse recommencée
Aujourd’hui 14 juillet 2021, nous célébrons la fête nationale de la République Française.
En ce jour, nous commémorons la fête de la Fédération, le 14 juillet 1790, qui marque l’unité de la Nation, ainsi que la prise de la Bastille le 14 juillet 1789, qui symbolise dans la mémoire collective le début de la Révolution Française. Les deux projets essentiels de la République sont rassemblés dans une seule et même date.
Le 14 juillet, c’est la République une et indivisible. Dans tous les départements, dans toutes les villes, dans toute la France, nous célébrons notre pays et son unité. Henri Martin rapportait ainsi pour le Sénat à propos de la proposition de loi du député Benjamin Raspail visant à instituer le 14 juillet comme Fête Nationale : « Cette seconde journée du 14 juillet, qui n’a coûté ni une goutte de sang ni une larme, cette journée de la Grande Fédération, nous espérons qu’aucun de vous ne refusera de se joindre à nous pour la renouveler et la perpétuer, comme le symbole de l’union fraternelle de toutes les parties de la France et de tous les citoyens français dans la liberté et l’égalité. Le 14 juillet 1790 est le plus beau jour de l’histoire de France, et peut-être de toute l’histoire. C’est en ce jour qu’a été enfin accomplie l’unité nationale, préparée par les efforts de tant de générations et de tant de grands hommes, auxquels la postérité garde un souvenir reconnaissant. Fédération, ce jour-là, a signifié unité volontaire. »
Mais le 14 juillet, c’est aussi la prise de la Bastille, c’est la lutte contre la tyrannie, pour la liberté, l’égalité et la fraternité. C’est le souvenir du peuple français révolutionnaire renversant les injustices, triomphant des tyrans et de leurs armées coalisées.
La République est non seulement un régime politique d’unité des citoyens égaux en droit, sans qu’il ne soit fait de différence entre eux, mais c’est aussi un projet politique, celui de sa devise, liberté, égalité, fraternité.
Les bals populaires du 14 juillet, les feux d’artifice, la Marseillaise, le drapeau tricolore sont autant de célébrations, mythes et symboles de notre République Française. Ils ne sont pas les souvenirs aseptisés d’une époque révolue, mais ce qui donne corps à l’esprit républicain, ce qui nous fédère en tant que peuple.
Sans cesse renouvelée, la République, pour être elle-même, doit être conquérante. L’émancipation individuelle et collective en est l’aboutissement. C’est par l’entremise de la laïcité, de la sécurité sociale, du droit de manifester, dusuffrage universel, de la politique sociale du logement, de l’hôpital public, des monopoles d’Etat, des ateliers nationaux, que nous progressons vers cet idéal. La République sociale ne se satisfait pas de l’égalité des droits. Elle est une aspiration à la réduction des inégalités sociales pour gagner l’égalité républicaine.
Unité de la Nation, conquête de l’émancipation, voilà la République que nous chérissons et que nous défendons. La Gauche Républicaine et Socialiste souhaite à tous les citoyens de la République Française une joyeuse fête nationale. Vive la République, vive la France !
Les archives publiques sont un patrimoine commun à défendre
Le gouvernement, dans le cadre du projet de loi relatif à la prévention des actes terroristes et au renseignement, met en péril l’accès démocratique aux archives du renseignement.
Le droit d’accéder aux archives n’est pas un sujet anecdotique. C’est une composante majeure de la réalisation du travail scientifique et historique. C’est par la consultation des archives nationales, locales, militaires, que les historiens parviennent à produire des travaux documentés et légitimes. Ce travail est indispensable pour participer à l’élaboration d’une Histoire commune, donc au sentiment d’appartenance à la communauté nationale. À l’ère du relativisme généralisé, où la distinction entre faits établis et opinions arrangeantes semble avoir été abolie, la nécessité de disposer de sources fiables n’a jamais été si importante.
La pente des restrictions des libertés publiques est glissante. Fermer les archives du renseignement sans limite de durée, ainsi que le prévoit le projet gouvernemental, est un recul inacceptable de l’État de droit. La transparence de la République sur les missions qu’elle mène pour la défense des citoyens est un élément essentiel de notre démocratie. Il garantit le contrôle citoyen des opérations de défense en permettant d’avoir les moyens de les évaluer a posteriori.
La lutte contre le terrorisme est une priorité politique. Les ennemis de la France, de la République et de la démocratie doivent être combattus par l’État, au nom de la défense des libertés publiques et de la sécurité de nos concitoyens. Il est donc impensable que la lutte contre le terrorisme aboutisse au recul de celles-ci.
Alors que le Conseil d’État a jugé le 2 juillet dernier illégale la classification automatique de ces archives en catégorie « secret défense » pour plus de 50 ans, le gouvernement a l’obligation morale et politique de revenir sur l’article 19 de ce projet de loi.
De la politique répressive des manifestations au fiasco lors de l’organisation des élections locales, en passant par certaines mesures de l’état d’urgence sanitaire (notamment les moyens donnés à l’exécutif pour se débarrasser d’un contrôle parlementaire sérieux), la présidence d’Emmanuel Macron a été un moment de recul inédit de recul des libertés publiques en période démocratique. Du fait de ces lois dangereuses, des répressions inacceptables et de l’incompétence généralisée des ministres de l’intérieur successifs, la confiance des Français envers nos institutions républicaines est plus faible que jamais. Il est urgent de la reconstruire.
La Gauche Républicaine et Socialiste appelle donc le Parlement à rejeter l’article 19 du projet de loi terrorisme-renseignement. Nous rappelons notre attachement sans faille à l’accessibilité universelle des archives, nécessité scientifique et démocratique.
La GRS soutient le référendum d’initiative partagée (RIP) pour sauver l’hôpital public et appelle à la constitution de collectifs citoyens
Le 7 juillet, le RIP pour sauver l’hôpital public a été déposé au Conseil constitutionnel par les parlementaires signataires. Les parlementaires de la GRS, Caroline Fiat (députée) et Marie-Noëlle Lienemann (sénatrice) l’ont signé. Ce RIP lancé par le collectif « Notre Hôpital c’est vous » entend être un des moyens pour garantir une offre de soins universelle de qualité, également accessible à tous. L’égalité d’accès à des soins de qualité est en effet un des fondements de notre république sociale et de l’État providence.
Pourtant l’hôpital public connaît trois crises profondes : une crise de financement, une crise humaine et une crise démocratique.
Une crise de financement causée par une logique gouvernementale de diminution des dépenses publiques et d’austérité. Depuis sa création par ordonnance en 1996, l’Objectif national des dépenses d’assurance maladie (ONDAM) pour l’hôpital a été voté tous les ans en dessous des dépenses et des charges nécessaires pour assurer les soins. Cela conduit les hôpitaux soit à s’endetter, soit à diminuer le nombre ou la qualité des soins et c’est inacceptable ! De plus, nous assistons à une privatisation à bas bruit d’activités médicales considérées comme lucratives par les chaines de cliniques privées dont la chirurgie : cela doit cesser !
Une crise humaine aggravée par la gestion erratique de la pandémie. Les pressions à l’économie sur les soins, les difficultés de recrutement, le faible niveau de rémunération, les objectifs de performance imposés par les directions administratives conduisent au développement d’un crise humaine chez les personnels qu’il nous faut régler pour eux et pour les soignés.
Une crise démocratique les différentes cartes sanitaires, les redéploiements de spécialités, les conséquences des numerus clausus dans les diverses formations créent des déserts médicaux ou hospitaliers. Ces décisions prises dans une logique d’économie d’échelle prennent peu ou pas en considération les besoins sanitaires des populations. Il est indispensable de procéder à une définition loyale, partagée, concertée et territoriale des besoins. L’organisation hospitalière doit avant tout, répondre aux besoins en santé des populations.
La crise sanitaire du Covid-19 a amplifié ces phénomènes et le gouvernement n’en a pas tiré de conséquences, pire il a continué sa politique de fermeture de lits- ce qui est une faute !
L’objectif de ce RIP est de répondre à ces trois crises. C’est pourquoi la GRS participera activement aux mobilisations en faveur de ce RIP et appelle à la constitution de collectifs locaux pour faire signer nos concitoyens.
Pour lire la proposition de loi du RIP : https://www.notrehopital.org/la-proposition-de-loi
Réaction suite à l’assassinat du Président de la République d’Haïti
La Gauche Républicaine et Socialiste condamne l’assassinat du président haïtien Jovenel Moïse, qui a eu lieu aux petites heures du matin, dans sa résidence, par un commando. Cet acte arrive dans un contexte où des bandes armées contrôlent une majeure partie de la capitale, Port-au-Prince, et alors qu’Haïti est le pays est le plus pauvre du continent américain et de la Caraïbes.
Investi en 2017 et vivement contesté par la population Haïtienne depuis plusieurs mois, le Président Moïse avait déjà échappé à une précédente tentative d’assassinat en février dernier. Il lui était d’ailleurs reproché de ne pas agir face à la crise que connait le pays et de gouverner seul, sans parlement, et par décret depuis le début de l’année 2020.
Ce pays voisin de la France connaissait déjà de graves problématiques sécuritaires, structurelles, économiques, sociales et politiques depuis plusieurs années, notamment depuis le séisme de 2010.
Nous espérons vivement que cet assassinat ne viendra pas amplifier le climat de violence qui y règne déjà et créer une éventuelle déstabilisation dans le bassin caribéen avec des conséquences néfastes pour nos territoires ultramarins.
Climat : Jeu de dupes entre le Président, le Sénat et la « convention citoyenne »
Comme prévu, le premier ministre, Jean Castex, a annoncé mardi 6 juillet 2021 l’abandon du projet de loi visant à inscrire à l’article 1er de la Constitution la préservation de l’environnement et la lutte contre le dérèglement climatique. En effet, la veille, la majorité sénatoriale conservatrice avait rejeté pour la seconde fois la formulation du texte proposée par l’Assemblée nationale et « issue » des 149 propositions de la convention citoyenne pour le climat. L’utilisation du terme « garantir » était le principal point d’achoppement entre les deux Chambres. Tout cela était mis en musique dès le départ car l’exécutif connaissait dès l’origine, et dès l’annonce par Emmanuel Macron lui-même aux « conventionnels » de la reprise de cette proposition, que les sénateurs LR et centristes bloqueraient le processus. C’est donc de manière théâtrale que Jean Castex a exposé la situation créée de toute pièce devant sa majorité de droite libérale à l’Assemblée nationale : « Cette main tendue en faveur de la protection du climat n’a pas été saisie par le Sénat. Ce vote met hélas un terme au processus de révision constitutionnelle ».
Évidemment, la navette sur cette procédure aurait pu continuer indéfiniment entre l’Assemblée nationale et le Sénat. Emmanuel Macron a choisi d’y mettre un terme car la démonstration qu’il attendait était faite : la méchante droite conservatrice avait bloqué la concession « sublime » que la gentille droite libérale avait accordé aux membres de la convention citoyenne pour le climat. Démonstration faite alors que le débat parlementaire sur le projet de loi climat-résilience avait mis en évidence le mépris politique de l’exécutif à l’égard des rares propositions de la convention reprises dans ce texte ; mais démonstration faite alors que l’ouest canadien, le nord-ouest états-uniens, l’Arctique et la Scandinavie subissent des températures caniculaires… l’équation politique voulue par Emmanuel Macron lui paraît ainsi suffisante : alors que le dérèglement climatique nous saute à la figure, j’ai fait ce que j’ai pu pour agir, mais l’archaïque Sénat m’en a empêché. Le Président peut aller se laver les mains.
Évidemment, la majorité de droite sénatoriale a rejeté le projet de loi référendaire pour de mauvaises raisons. Elle a cherché un prétexte « idéologique » pour asseoir son argumentation politique, justifier son rejet et envoyer un message à son électorat : les sénateurs LR rejetaient ainsi la formulation selon laquelle la République française « garantit la préservation de l’environnement et de la diversité biologique et agit contre le dérèglement climatique » ; par là, ils prétendaient infliger un échec aux « tenants de la décroissance ». S’il est effectivement juridiquement hasardeux d’insérer le verbe « garantir » sur un tel sujet, la réalité des conséquences juridiques et constitutionnelles étaient peu mesurables et vraisemblablement faibles. L’important pour la droite conservatrice était de démontrer qu’elle s’opposait à une décroissance fantasmée ; l’important pour le macronisme était de donner des gages aux électeurs écologistes centristes et de démontrer que LR était conservateur.
Peu de gens rappellent les faits : cette réforme constitutionnelle morte-née était inutile. Depuis le second mandat présidentiel de Jacques Chirac, la Charte de l’environnement est annexée à la constitution de la République ; elle a valeur constitutionnelle et porte les mêmes effets que ceux qu’espéraient les membres de la convention citoyenne sur le climat. Et c’est là qu’il faut tordre le coup à un autre jeu de dupe : l’idée selon laquelle le tirage au sort des citoyens – jusqu’à utiliser cette méthode pour remplacer les chambres représentatives (proposition de Thomas Guénolé à nouveau ce mercredi 7 juillet 2021) – serait l’avenir et la renaissance de notre démocratie. Selon le « politologue », une assemblée tirée au sort aurait adopté le projet de loi référendaire contrairement à la chambre haute actuelle. Peut-être… mais est-ce bien le sujet ? En réalité, le fait que les « conventionnels » tirés au sort aient fait de cette proposition constitutionnelle un des axes marquant du débouché de leurs débats démontre malheureusement que – malgré des heures et des semaines de travail, malgré l’audition forcenée d’experts variés – ces « citoyens » remplis de bons sentiments ont éludé la réalité juridique et constitutionnelle du pays pour aboutir à une proposition inutile. Pire, ils sont tombés dans le piège de la manipulation et de l’instrumentalisation voulu par le Prince Président qui dispose de pouvoirs excessifs dans le régime actuel. Le tirage au sort n’est pas préférable à la démocratie représentative. Sachons nous en souvenir !
Rupture d’égalité ou revalorisation : le contrôle continu menace-t-il le bac ?
Entretien croisé accordé à Marianne par Emmanuel Maurel, député européen GRS, et Pierre Mathiot, politologue – Propos recueillis par Hadrien Brachet – Publié le 03/07/2021
Jean-Michel Blanquer souhaite renforcer la part dans le bac du contrôle continu issu du bulletin scolaire. Menace sur l’égalité républicaine ou outil pour revaloriser l’examen totem ? « Marianne » en débat avec le politologue Pierre Mathiot et le député européen Emmanuel Maurel.
Un pas de plus vers la fin d’un monument national ? Ou la voie du salut pour lui redonner du sens ? Jean-Michel Blanquer a annoncé son intention de renforcer le contrôle continu issu du bulletin scolaire au baccalauréat. Si l’équilibre du nouveau bac entre épreuves terminales (60 %) et contrôle continu (40 %) serait préservé, les évaluations communes mises en place en 2018 pour les matières du tronc commun seraient supprimées, au profit d’un « seul paquet de contrôle continu ». Et la proposition, qui doit encore être débattue avec les syndicats, divise.
Le contrôle continu « permet de faire travailler toute l’année les élèves » et « le caractère national et fort du baccalauréat sort renforcé de cette réforme » a soutenu le ministre de l’Éducation nationale à l’Assemblée. Quand d’autres se sont inquiétés des inégalités que susciteraient les nouvelles modalités du bac, du fait de l’hétérogénéité de la notation d’un établissement à l’autre. « L’égalité républicaine ? À terre », a lancé la députée Clémentine Autain sur Twitter. « Jean-Michel Blanquer est en train d’enterrer le baccalauréat » s’est insurgé l’eurodéputé François-Xavier Bellamy sur Sud Radio.
Alors, faut-il craindre le contrôle continu ? Marianne en débat avec Pierre Mathiot, politologue, auteur du rapport commandé par Jean-Michel Blanquer qui a inspiré la réforme du bac, et Emmanuel Maurel, député européen, vivement opposé au renforcement du contrôle continu.
Marianne : Renforcer le contrôle continu, est-ce abandonner une promesse d’égalité républicaine à travers un examen national, commun à tous quelle que soit son origine sociale ?
Emmanuel Maurel : C’est évident. Jean-Michel Blanquer accomplit un travail de sape. Il y a déjà eu le fiasco de Parcoursup et la réforme des filières du lycée que personne ne comprend. Le voilà qui entreprend désormais d’enterrer le bac, et de le remplacer par un diplôme local. Ce ministre n’a eu de cesse de s’autoproclamer le premier des républicains mais il piétine ici le principe sacré d’égalité. La réforme du bac, c’est la fin de l’égalité. L’entrée dans l’enseignement supérieur se fera en fonction du lycée d’origine.
Pierre Mathiot : D’abord, il y avait dans le bac précédent des conditions qui faisaient que cette égalité républicaine n’était pas autant respectée que ça. Le sport était évalué en contrôle continu et les langues étrangères à l’oral de manière non anonyme. La notation n’était également pas équivalente d’une académie à l’autre. Les mêmes qui ont vivement critiqué le bac organisé jusqu’en 2019 lui trouvent maintenant des vertus formidables.
Ensuite, le poids accordé au contrôle continu depuis le lancement de ce nouveau bac ne change pas. Il reste à 40 %. Il s’agit simplement de faire évoluer la manière dont ces 40 % sont constitués en renforçant le contrôle continu issu de la notation au sein de l’établissement mais bien entendu sur la base d’un cadrage national et de consignes de notation. Il n’est pas question de laisser les enseignants livrés à eux-mêmes. Nous supprimons les épreuves communes qui étaient des sortes de partiels nationaux et remettaient dans le système de la lourdeur alors même que l’objectif de la réforme était d’alléger le fonctionnement des lycées.
Le contrôle continu est-il source d’inégalités ?
Emmanuel Maurel : Bien sûr. D’abord car tout le monde sait qu’une note de 15/20 dans un lycée lambda ou dans un lycée prestigieux, ce n’est pas la même chose. En renforçant le contrôle continu, on renforce la position du lycée prestigieux et on enfonce un peu plus le lycée lambda. On suscite aussi du stress pour tout le monde, à partir du moment où le contrôle continu compte pour avoir son bac. On instaure une tension toute l’année entre professeurs, élèves et parents.
« Même quand on n’était pas un très bon élève, on avait sa chance à l’examen et on avait la garantie que la notation au bac serait de la pure égalité. »
J’étais aussi attaché à la formule « doit faire ses preuves à l’examen ». Même quand on n’était pas un très bon élève, on avait sa chance à l’examen et on avait la garantie que la notation au bac serait de la pure égalité. Cela me paraissait très important dans sa dimension symbolique.
Pierre Mathiot : Toute notation, toute manière de noter est source d’inégalités. Toute évaluation qu’elle soit locale ou nationale, anonyme ou pas, est source d’inégalités. Il ne s’agit pas d’opposer de manière caricaturale des manières de noter qui seraient totalement égalitaires et d’autres inégalitaires. Une part minoritaire de contrôle continu a du sens dans la mesure où cela permet d’évaluer le travail sur la longueur.
Le contrôle continu n’est-il pas un moyen de mieux refléter le niveau des élèves pour leur entrée dans l’enseignement supérieur, qu’un bac fait après les candidatures sur Parcoursup et très largement accordé ?
Emmanuel Maurel : On entérine ce que Parcoursup était déjà en train d’entériner, c’est-à-dire le fait qu’il faut absolument protéger les enfants de bourgeois en les mettant dans des lycées bourgeois. S’agissant de refléter le niveau, rien n’empêche de faire des contrôles tout au long de l’année. Et rappelons que la notation au bac prend en compte le niveau général à travers les consignes de correction, le livret scolaire, le jury qui décide ou non d’accorder les mentions. L’examen final était déjà un reflet du niveau.
Pierre Mathiot : Pour faire en sorte que les élèves soient mieux préparés à l’enseignement supérieur, il me semble que prendre en compte une grande diversité de types d’exercices et de conditions de passage, en mixant des épreuves terminales et du contrôle continu, a du sens.
La simplification du bac voulue par Jean-Michel Blanquer obéit-elle à une logique marchande et économique ?
Emmanuel Maurel : Évidemment. C’est la gestion par le stress comme dans des entreprises classiques. Au lieu de placer l’élève dans une logique de préparation de l’épreuve, on le soumet à un stress permanent, de type managérial. On présente Jean-Michel Blanquer comme héros du républicanisme, mais en fait il se comporte comme un manager. Son modèle, ce ne sont pas les hussards noirs mais le fonctionnement anglo-saxon.
Pierre Mathiot : Dans la lettre de mission qui avait été la mienne en novembre 2017, il y avait cet impératif de simplification pour alléger le fonctionnement des établissements. On était arrivés en 2019 à une situation d’embolisation du lycée. Or, les épreuves communes avaient pour conséquence paradoxale de remettre une couche de complexité organisationnelle : il fallait neutraliser le fonctionnement des établissements, convoquer les surveillants., etc.
« Qu’il y ait quelques effets pervers, je ne le nie pas. Mais ce qui est en jeu est que tout cela soit plus facile à organiser. »
Simplifier ne veut pas dire individualiser. C’est trop facile dans ces débats de dire que c’est une réforme néolibérale. Qu’il y ait quelques effets pervers, je ne le nie pas. Mais ce qui est en jeu est que tout cela soit plus facile à organiser.
Le bac doit-il être un certificat de fin d’études ou le premier grade de l’enseignement supérieur ? Ou les deux comme il l’est officiellement actuellement ?
Emmanuel Maurel : Les deux, évidemment. Surtout, il fait partie de ces rites de passage de la nation. On concluait à la fois un cycle d’études et en même temps, on permettait d’accéder à l’enseignement supérieur. Il ne faut pas négliger l’impact symbolique de ce qui est en train de se passer. On substitue à ce rite une logique de stress. Et à la fin, ce sont les classes aisées qui sont gagnantes.
Pierre Mathiot : La manière que l’on a de réorganiser le bac qui a commencé en 2018 est justement le moyen de combiner ces deux exigences, notamment par rapport au calendrier de Parcoursup qui s’impose à nous. Pour qu’au 20 juillet, la quasi-intégralité des jeunes ait une place dans l’enseignement supérieur, il faut du temps pour faire tourner Parcoursup et avant, examiner les dossiers. Cela suppose au moins dix semaines. Si vous faites des épreuves en juin comme avant et que vous voulez prendre en compte les notes du bac, vous ne pouvez enclencher Parcoursup qu’en août voire en septembre. On ne peut donc pas faire autrement, me semble-t-il, que de faire une combinaison de contrôle continu et d’épreuves terminales.
« L’objectif est de tourner le lycée et le bac vers l’enseignement supérieur. »
On recherche un équilibre entre les contraintes calendaires de Parcoursup et la nécessité de continuer à organiser un bac qui joue une place importante. Bien entendu, il sera essentiel d’accompagner les enseignants dans ce travail. Des pressions peuvent s’exercer de la part des familles mais en réalité elles existent déjà du fait de Parcoursup. Cette décision initie une évolution historique, le fait que la communauté s’interroge sur les façons de noter et définisse une stratégie collégiale par le contrôle continu.
Au-delà du bac, la véritable problématique n’est-elle pas celle du lien entre le lycée et l’enseignement supérieur ? Concentrer ses critiques sur la forme du bac, n’est-ce pas hypocrite alors que depuis longtemps on sélectionne déjà sur le contrôle continu ?
Emmanuel Maurel : La situation s’est dégradée réformes après réformes, en particulier avec Parcoursup. Je vois bien que dès la fin du collège, les jeunes commencent à être flippés. On leur demande de plus en plus tôt de savoir qu’ils veulent faire plus tard.
Pierre Mathiot : Depuis APB puis Parcoursup l’affectation des élèves dans l’enseignement supérieur se faisait absolument sur la base du contrôle continu. L’objectif est de tourner le lycée et le bac vers l’enseignement supérieur. Ce qui n’est pas encore bien mis en place, en partie à cause du Covid, c’est l’enjeu formidable des 54 heures d’orientation en première et terminale pour qu’au moment où ils affrontent Parcoursup, les élèves le fassent de manière informée. Si on n’arrive pas à faire cela, évidemment la réforme va perdre en route sa dimension d’équité. Si on y arrive, je pense que c’est une réforme qui réussira.
La relance est-elle suffisante pour surmonter la crise du COVID ?
Lundi 28 juin 2021, David Cayla, Maître de Conférences en économie à l’université d’Angers, membre des Économistes atterrés et de la GRS, répondait aux question des journalistes du 28 minutes d’arte.
Face à Elie Cohen et Natacha Valla, il explique que le retour a une situation économique équivalente à notre niveau de 2019 ne sera pas atteint fin 2021. Alors que nous faisons face à une augmentation des prix générés par le redémarrage de l’économie et l’achat des matières premières par la Chine et les USA, les plans de relance français et européen sont largement sous-dimensionnés, par comparaison à celui des Etats-Unis d’Amérique. La France par exemple pourraient être amenée à rembourser plus qu’elle reçoit de l’Union européenne, par la garantie qu’elle a accordée, si l’UE ne trouve pas d’autres ressources. Il faut également mesurer si la relocalisation des activités de production et la diminution de notre dépendance économique à l’extérieur vont réellement devenir des priorités.