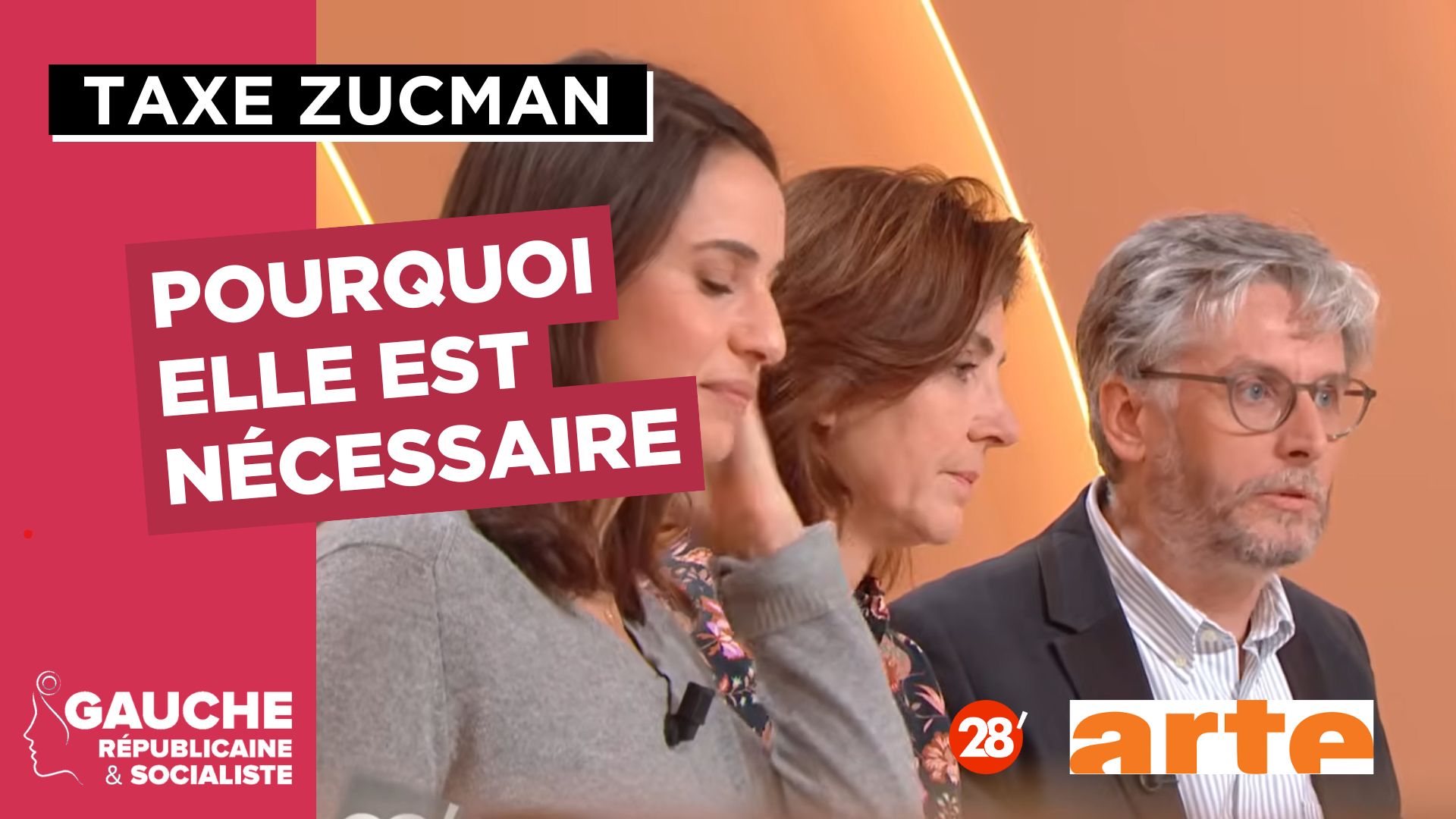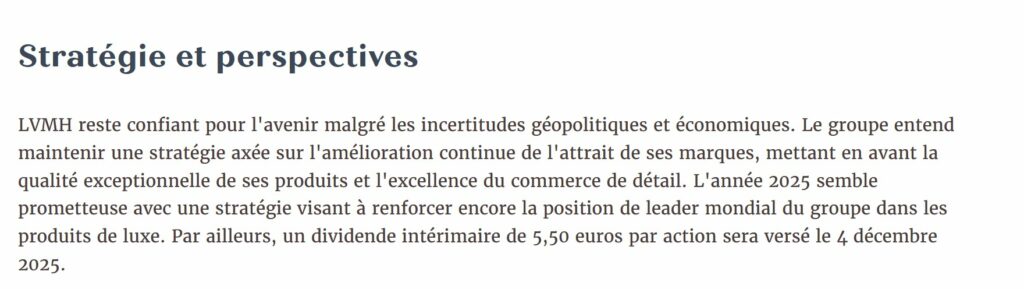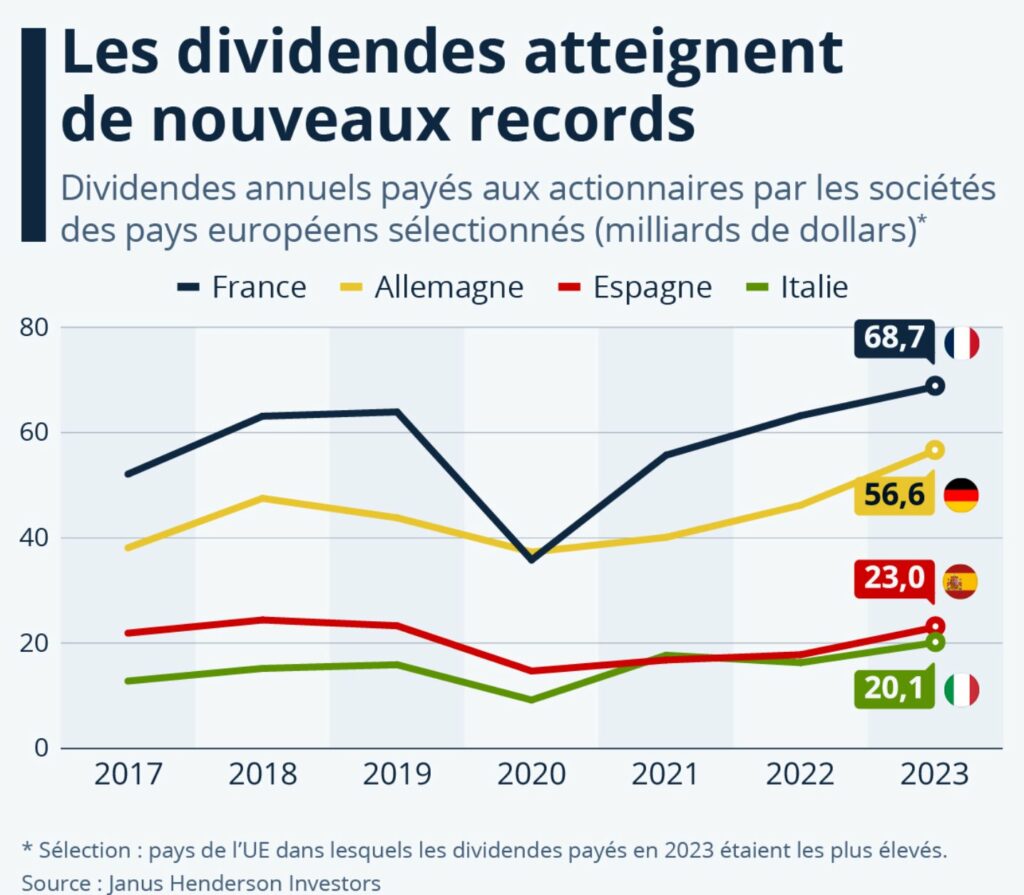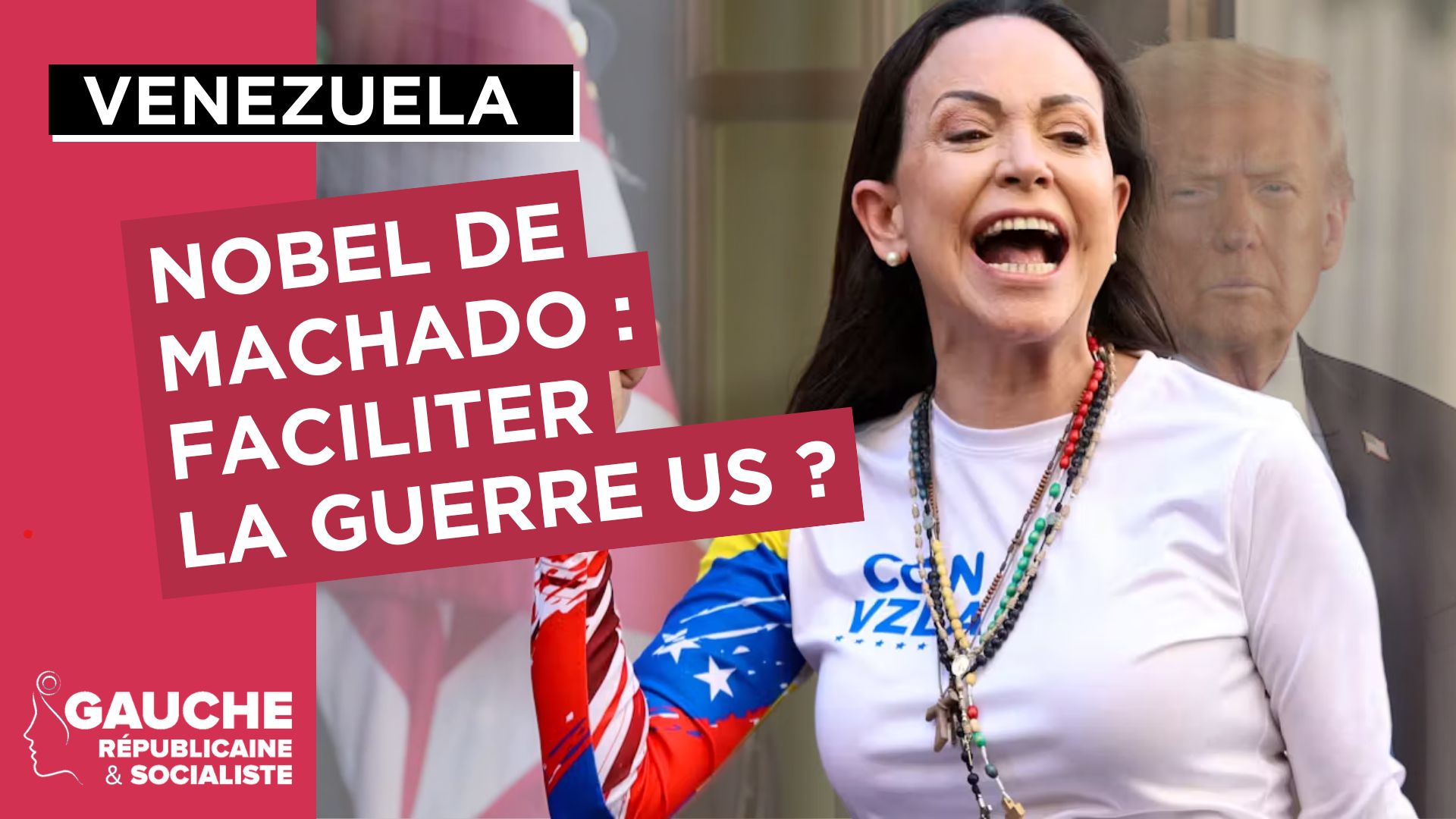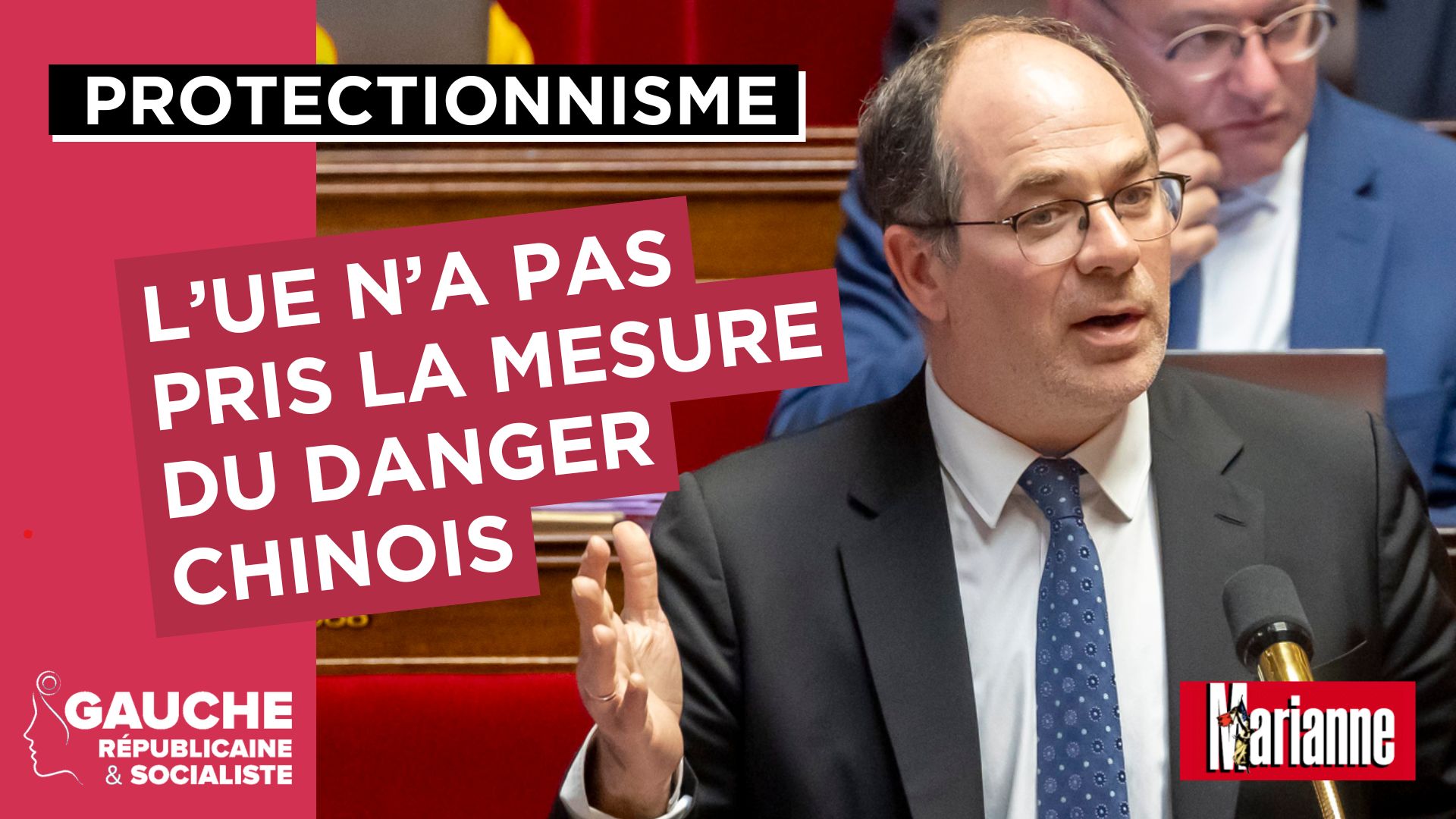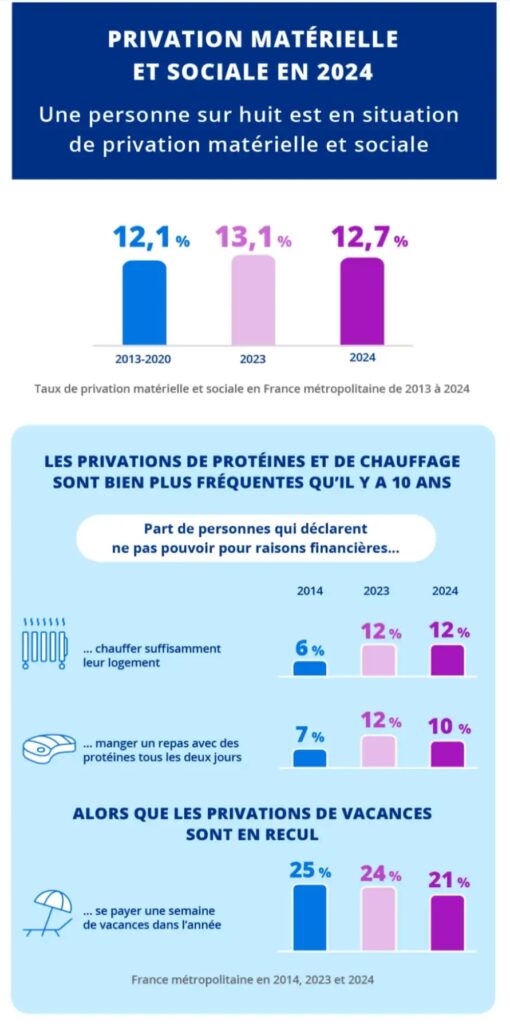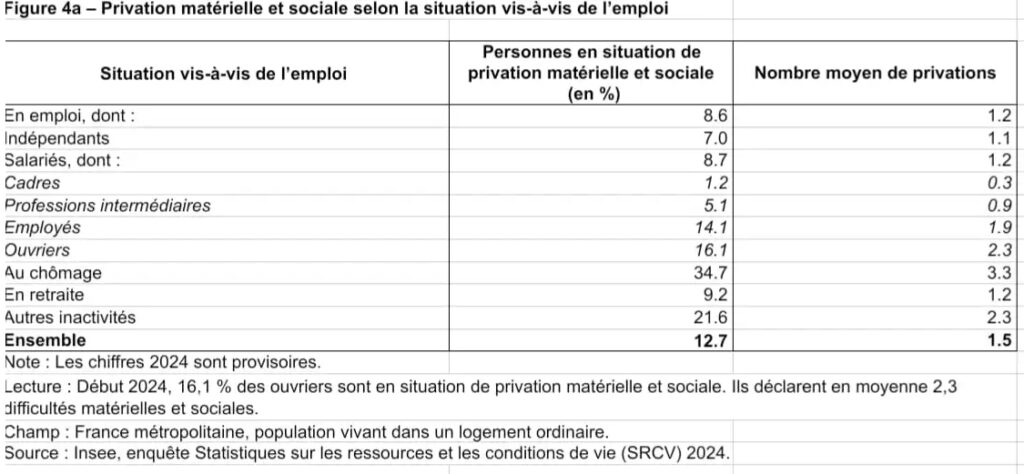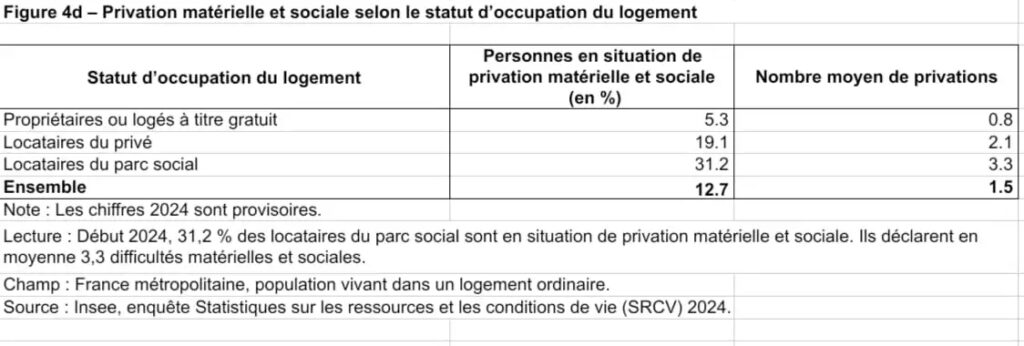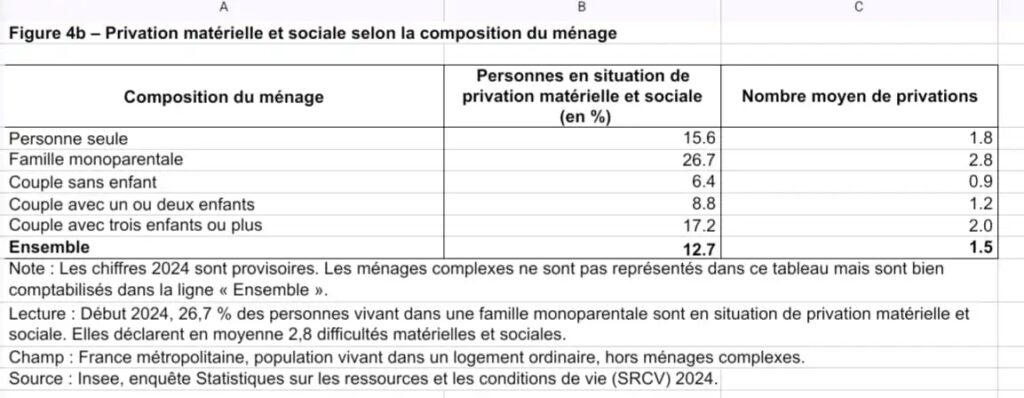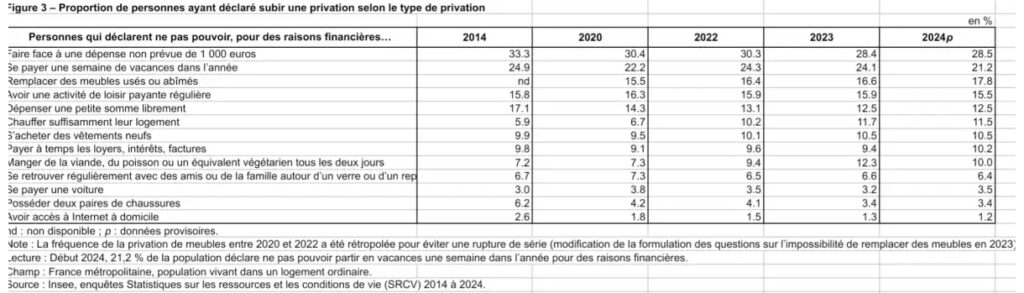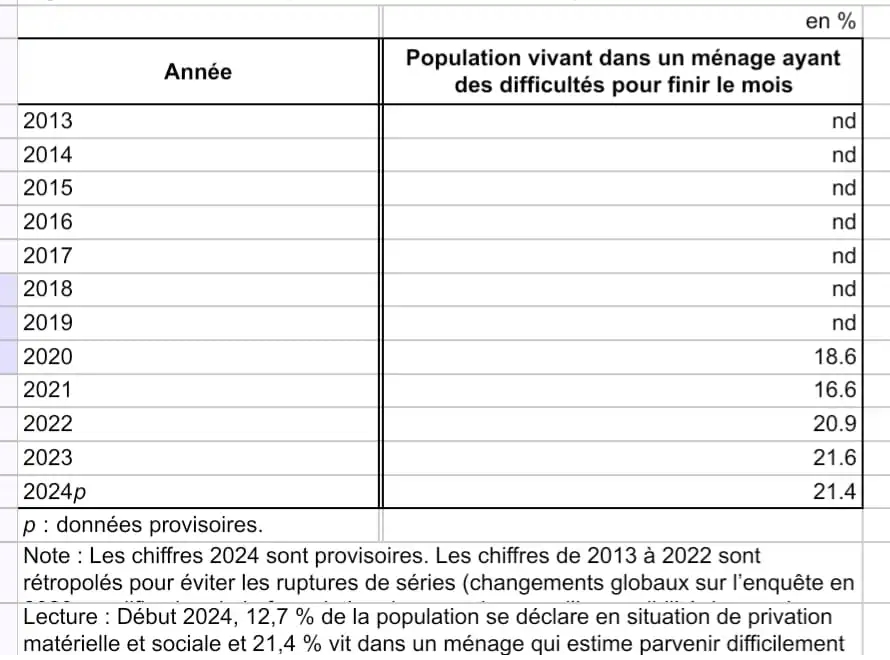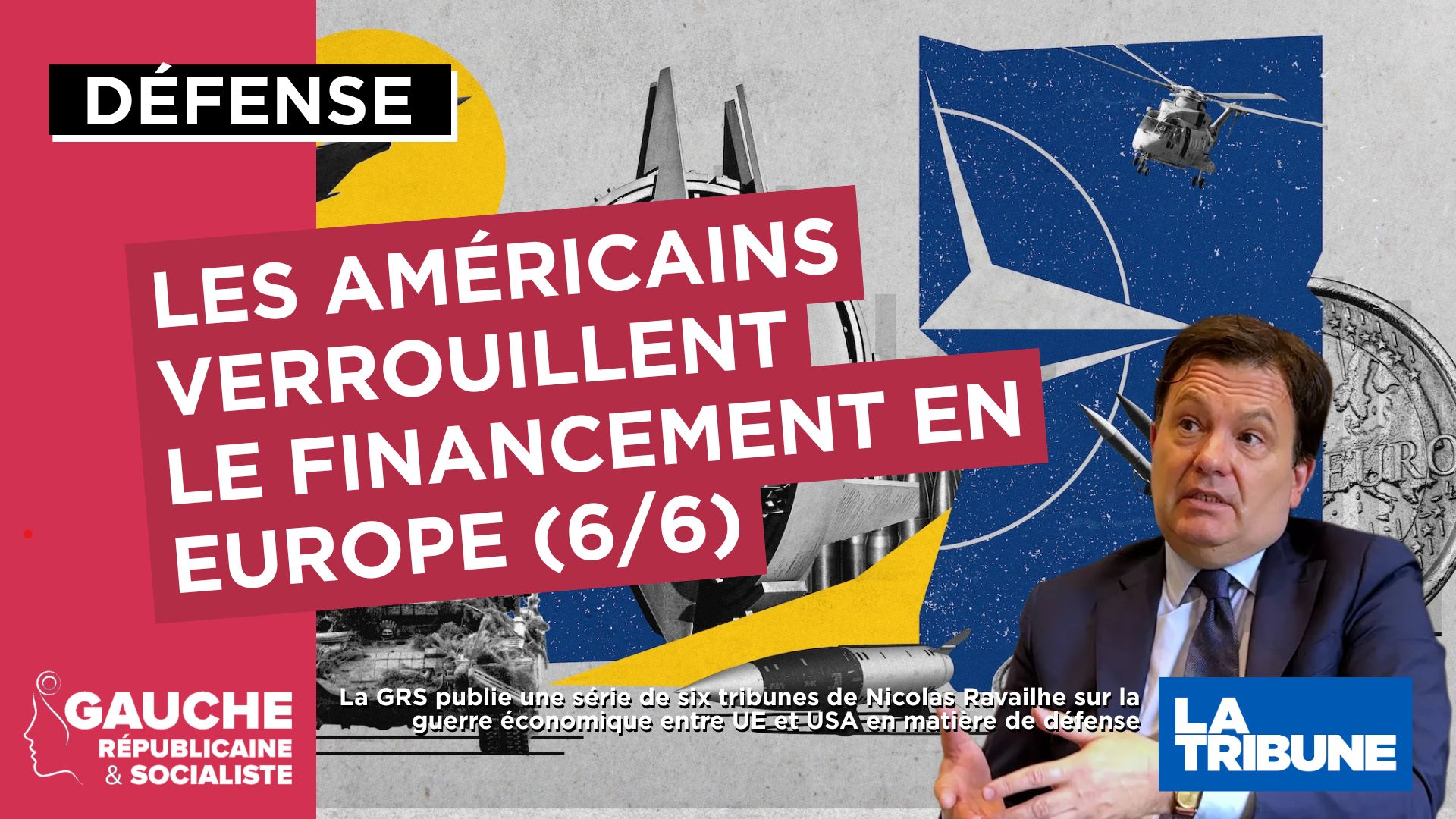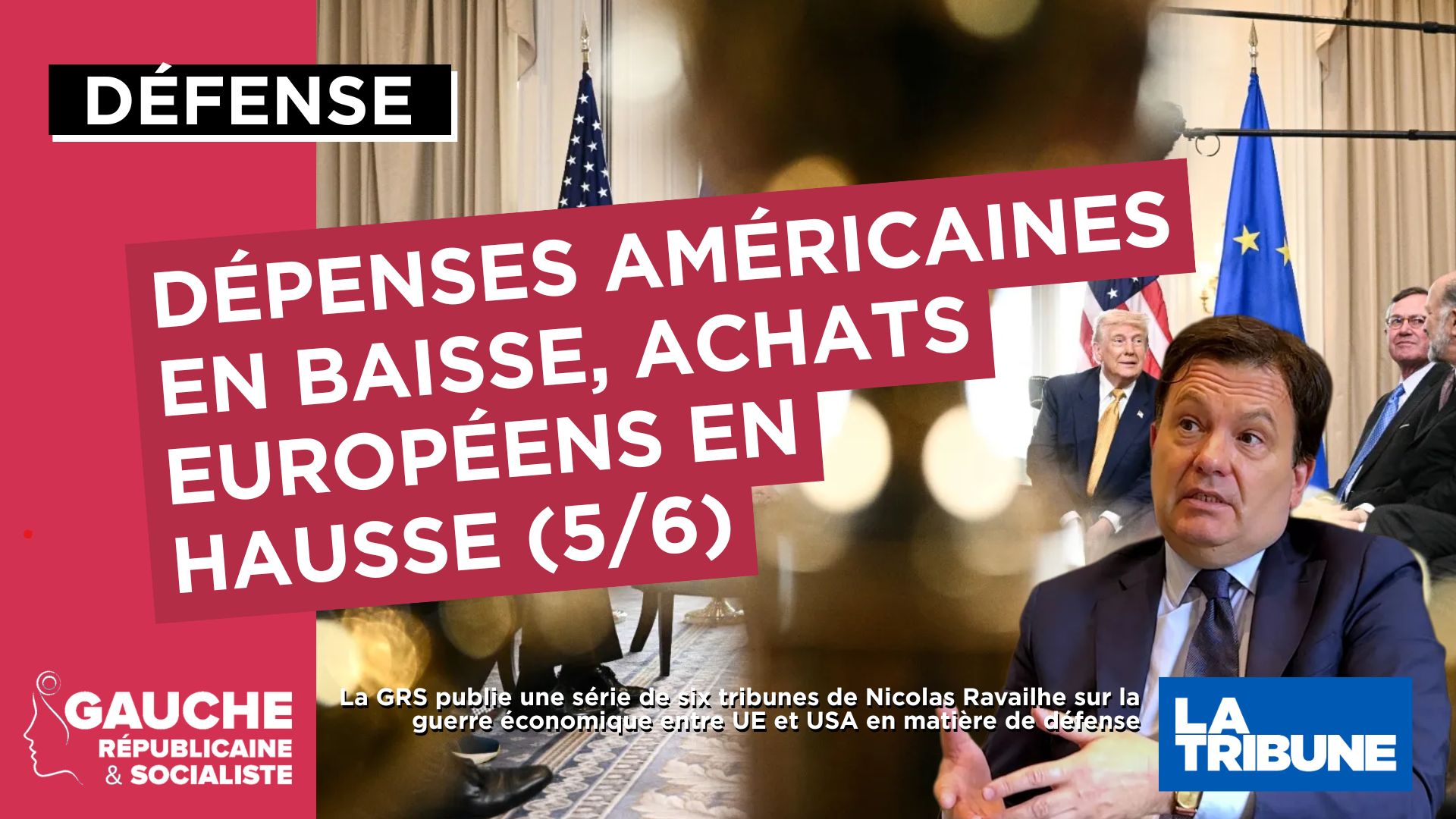La soirée du mardi 4 novembre a marqué une défaite flagrante pour les Républicains et les candidats soutenus par le Président des Etats-Unis d’Amérique : référendum californien, mairie de New York, élections des Gouverneures et des chambres en Virginie et au New Jersey… Le camp républicain et MAGA ont été sèchement battus. Mais il est encore tôt pour dire que le camp démocrate est sorti d’affaire et surtout sur quelle orientation politique il reconstruira l’alternative.
Tous les ans, le premier mardi de novembre marque la journée électorale annuelle américaine. Les années bissextiles, cela correspond à l’élection présidentielle, les années paires, au renouvellement de la Chambre des représentants et le tiers du Sénat. L’année précédant la présidentielle, la plupart des États élisent leur gouverneur. L’année suivant la présidentielle, la plupart des villes leur conseil municipal. Les chambres locales sont généralement renouvelées en même temps que le gouverneur de l’État, et divers référendums locaux peuvent avoir lieu.
Mardi 4 novembre se sont donc tenues les élections annuelles de cette année N+1 de la présidentielle. Si l’élection à la mairie de New York a fait couler beaucoup d’encre, elle n’était néanmoins pas la seule élection avec beaucoup d’enjeu.
Un socialiste élu maire de New York
Commençons tout de même par cette élection qui a tant passionné la classe politique et journalistique mondiale. Zohran Mamdani, candidat de l’aile gauche du Parti Démocrate qui en avait remporté la primaire, a devancé l’ancien gouverneur de l’État, Andrew Cuomo, positionné à l’aile droite du parti, qui s’était présenté en dissident. Le candidat républicain, Curtis Sliwa, s’effondre par rapport à il y a quatre ans, son électorat ayant massivement voté pour faire barrage à un democratic socialist.
L’élection de M. Mamdani a soulevé autant d’angoisse que d’enthousiasme. Doté d’un programme très à gauche pour les États-Unis, reposant sur le gel des loyers, la gratuité des transports et des écoles, et le partage des richesses, il a été dépeint par ses adversaires comme un bolchévique le couteau entre les dents.
On en oublierait presque cette donnée, tant le discours dominant, de la droite raciste à la gauche sociétale, semble ne retenir que son origine, indo-ougandaise, et sa religion, musulmane. Certains s’en enthousiasment, d’autres s’en horrifient, mais peu essayent d’aller plus loin qu’une lecture identitaire de cette élection.
Il faut dire que la culture politique américaine, très communautarisée, laisse la part belle aux envolées lyriques sur la fierté des origines, sur l’exaltation de la spiritualité, et le débat actuel sur la politique migratoire américaine a forcément eu un écho important dans cette campagne. Ainsi, le récit médiatique, et par conséquence les analyses politiques qui en ont été tirées en Europe, s’est concentré sur cet aspect de la campagne, pourtant banal et classique aux États-Unis. Donald Trump parle allègrement de ses origines écossaises, JD Vance parle constamment de sa foi catholique, les campagnes de Barack Obama, Hillary Clinton et Kamala Harris rappelaient sans cesse leur identité afro-américaine, féminine, ou les deux. Rien que de très communs, et peu différenciant.
La victoire de M. Mamdani, c’est celle des idées sociales contre la tentative d’enfermement communautaire qu’ont tentée ses opposants. Bien sûr, ses opinions controversées sur le conflit israélo-palestiniens ou d’anciens propos tenus sur twitter relativisant un attentat terroriste en Grande-Bretagne devraient tempérer l’enthousiasme de son élection. Tout cela étant dit, il convient tout de même de souligner que ces propos sont anciens et qu’il a tout fait pour s’en tenir éloigné toute la campagne, préférant débattre de sujets socio-économiques. La campagne de M. Cuomo a au contraire tenté de faire de cette élection un référendum identitaire : c’est donc elle qui a péché par excès de communautarisme, ne répondant pas aux attentes essentielles des New-yorkais sur leur quotidien.
Carton plein pour les Démocrates
Cette tendance ne s’est pas annoncée qu’à New York. L’élection municipale de Minneapolis en a été la démonstration inverse. L’opposant de l’aile gauche du Parti Démocrate a tenté de doubler le maire sortant par un discours fortement marqué par les questions identitaires et il a perdu. Les élections gouvernatoriales du New Jersey et de Virginie, et le renouvellement de la chambre basse de ce dernier État, marquent un triomphe des démocrates et un effondrement des républicains.
En plein shutdown de l’État central, les administrations fédérales sont fermées. Les Démocrates ont activement fait campagne pour le dénoncer, tandis que les Républicains vantaient la politique migratoire et identitaire du président. Ces derniers sont en déroute. Ils s’effondrent en Virginie, perdent la majorité qualifiée dans le Mississippi, une élection en Géorgie, et surtout le référendum sur la carte électorale en Californie, qui favorisera les Démocrates aux élections de mi-mandat de l’an prochain. Ce vote, en représailles d’une loi spéciale au Texas qui avantageait les républicains, poursuit la guerre totale que se sont lancés Démocrates et Républicains sur tous les plans politiques, juridiques et identitaires. Mais au-delà de ce récit, si M. Trump a gagné en 2024, c’était à cause de l’inflation, si son parti perd aujourd’hui, c’est à cause des fermetures d’administration. Le réel social cogne toujours.
La victoire de M. Mamdani en particulier et des Démocrates en général mardi a été celle d’une gauche qui parle du quotidien, contre la droite qui s’embarque dans des polémiques identitaires. Car si Mamdani apparaît comme une émergence social-démocrate, les candidates élues dans le New Jersey et en Virginie, bien plus libérales que lui, ont choisi pourtant la même stratégie : parler du concret et du social. Voilà ce que nous retenons de cette séquence politique américaine, ni plus, ni moins.
Pourquoi la gauche française se trouve en pamoison devant une élection locale américaine ?
L’élection du démocrate socialiste Zohran Mamdani à la mairie de New York a suscité un véritable engouement au sein d’une gauche française en quête d’exemples et de renouveau. Pour La France insoumise, cette victoire symbolise la réussite d’une « gauche de rupture », authentique et combative, capable, comme elle le revendique, de triompher de l’extrême droite. Mathilde Panot y voit une « leçon », tandis que Sophia Chikirou appelle à suivre ce modèle à Paris. Pourtant, le parallèle entre Mamdani et Mélenchon, séduisant en apparence, se révèle trompeur et réducteur.
On l’a dit plus haut, le contexte américain est très particulier : New York reste une ville majoritairement démocrate, une enclave progressiste sans équivalent dans le paysage politique français. Mamdani a été parfois qualifié de « communiste » par ses adversaires républicains et le président Trump. Le nouveau maire de New York est-il radicalement de gauche ? Pour l’Amérique trumpiste, clintonienne ou obamienne, oui ; avec nos critères, non. S’il défend la cause palestinienne et accuse le gouvernement Netanyahu de commettre un génocide, il n’a pas fondé sa campagne sur le Proche-Orient, mais sur des sujets concrets du quotidien : la flambée du coût de la vie, l’explosion des loyers et la difficulté croissante à se loger. Sa promesse phare, renforcer l’encadrement des loyers, illustre une approche pragmatique centrée sur la justice sociale : cette mesure existe déjà en France depuis 2014, portée par le gouvernement de Jean-Marc Ayrault et sa ministre Cécile Duflot … une des mesures consensuelles à gauche d’un mandat présidentiel qui a divisé la gauche.
Mamdani a mené une campagne patiente, de terrain, proche des habitants, attentive à leurs problèmes réels. La gauche française peine à incarner cette proximité avec les Français et leurs attentes : selon le Cevipof, 23% seulement des Français jugent que LFI répond à leurs préoccupations, contre 34% pour le PS et 42% pour le RN. Dramatique ! La victoire new-yorkaise rappelle que la reconquête passe par le concret : parler logement, santé, transports, sécurité, pouvoir d’achat. Retisser le lien avec la population, renouer avec le réel, voilà le défi de la gauche française qui, pour avancer, doit moins rêver d’Amérique que se réancrer dans la vie quotidienne des Français. En tout cas, Mamdani et les autres candidats démocrates (libéraux ou socialistes) des partielles de mardi ont fait preuve d’une lucidité qui manque cruellement à beaucoup de nos camarades.
Augustin Belloc (avec le soutien de Frédéric Faravel)