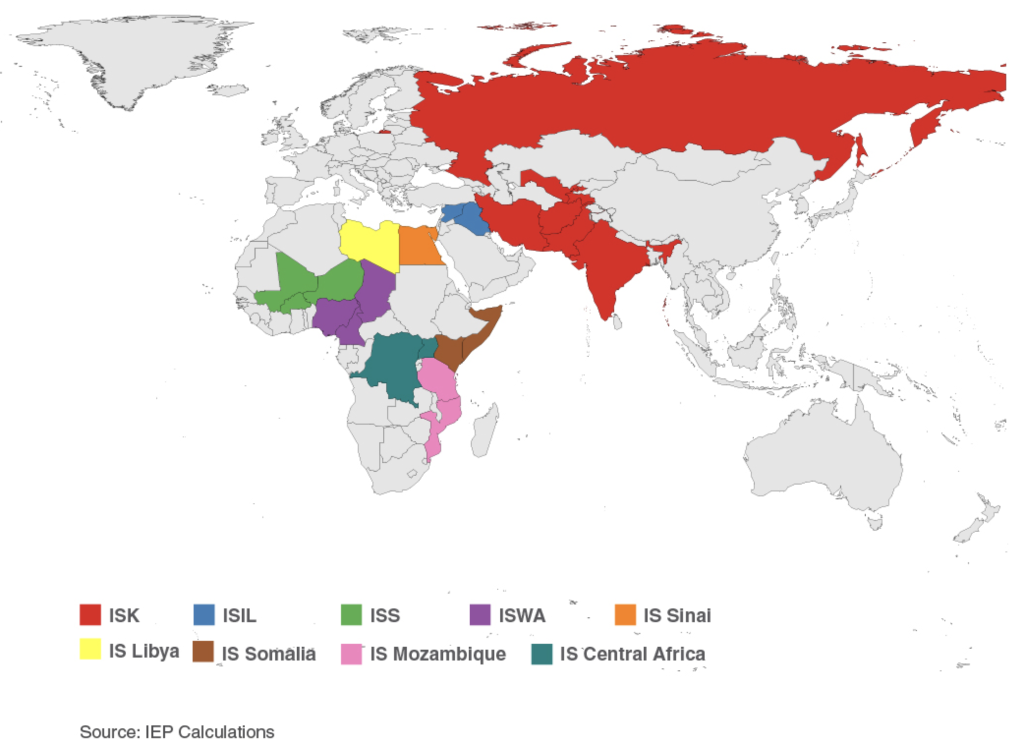Depuis le départ de l’armée française, qui a symbolisé la fin de la Françafrique, l’Afrique occidentale est en pleine impasse politique et sécuritaire sous tutelle russe.
Le premier semestre de l’année 2025 a été marqué par de nouveaux retraits de l’armée française en Afrique occidentale, un reflux qui devrait se poursuivre en Côte-d’Ivoire, au Gabon et au Sénégal, d’un commun accord avec les autorités de ses pays francophones.
On se souvient que les précédents retraits du Mali (août 2022), du Burkina Faso (février 2023), du Niger et plus récemment du Tchad (décembre 2024 – janvier 2025) s’étaient opérés sous la contrainte et dans la tension (particulièrement au Niger, avec le psychodrame autour de l’ambassadeur de France au second semestre 2023), sur fond d’offensive diplomatico-militaire russe et diplomatico-commerciale chinoise.
Quel est le résultat de ce désengagement militaire français en Afrique de l’Ouest chez les pays concernés et sur leurs voisins ? Nous vous proposons de passer en revue la situation politique et sécuritaire au Mali au Burkina Faso et au Togo.
Mali : dictature, jihadisme, emprise et échec
Les témoignages de rescapés de prisons secrètes du groupe Wagner émergent progressivement du silence dans lequel la junte au pouvoir à Bamako aurait voulu qu’ils restent. La presse y est effectivement particulièrement muselée. C’est donc en Mauritanie, où sont réfugiés près de 300 000 Maliens dans le Sahara, que les journalistes du collectif forbidden stories ont pu recueillir ces paroles rares des victimes.
Des témoins qui révèlent les arrestations arbitraires et les tortures opérées par les mercenaires russes du groupe Wagner avec la complicité des forces armées maliennes, dans leur camp ou sur d’anciennes bases de l’ONU. Ainsi un ancien humanitaire malien Wangrin a expliqué avoir subi des simulacres de noyade, la tête plongée dans une bassine d’eau jusqu’à ne plus pouvoir respirer, avant d’être frappé à la tête, au ventre, des coups de bâton, de câbles électriques. Les mercenaires russes et l’armée malienne cherchaient à savoir à qui pouvait bien appartenir un talkie-walkie utilisé par des djihadistes. Dix mois après s’être exilé en mauritanie, il est toujours hanté par la musique russe qui résonnait dans le camp militaire de Nampala.
Autre témoignage, autres séquelles physiques et psychologiques avec Nawma, un boutiquier peul brûlé au ventre et « attaché dans une douche, complètement nu, pendant sa détention ». Quant à Ismaïl, il a passé près de 40 jours dans un conteneur, sous un soleil de plomb : « ils ont brûlé les mains de certains prisonniers, d’autres sont devenus infirmes des jambes. Ils n’ont pas de limites » ; les mains d’Ismaïl portent encore les traces de cette torture : « Le plus dur pour nous, c’était de creuser dans le gravier – du travail forcé –, le genre de gravier qui est utilisé pour faire l’asphalte, c’est ce que nous devions creuser ». L’enquête du collectif forbidden stories est accessible en ligne1.
A la tête du Mali, le général Assimi Goïta vient d’obtenir de ses ministres, sans élection, un mandat de chef de l’État de 5 ans « renouvelable ». Le chef de la junte s’était pourtant engagé à remettre le pouvoir aux civils au plus tard en mars 2024. Une vision « osée et assumée » de la transition, selon le journal malien Le Pays2, manière très particulière d’évoquer la récente dissolution des partis politiques pour « établir un nouvel environnement politique assaini, plus organisé. » On croirait lire du Pinochet dans le texte. Le même quotidien saluait également le bilan sécuritaire contre les terroristes, au Mali.
Sauf qu’en réalité, la situation ne s’est pas améliorée, ainsi que le rappelle depuis l’Algérie voisine le média TSA3, ou un spécialiste de la défense, explique le contrecoup de la stratégie Wagner. les mercenaires russes « ont agi avec tellement de brutalité que la majorité des Maliens du nord aujourd’hui ont basculé dans le camp séparatiste ». Aujourd’hui, les mercenaires du groupe Wagner « quittent le Mali sans victoire » : « des attaques contre les bases de l’armée malienne, au nord, sont quotidiennes et Wagner a échoué par deux fois à prendre Tinzaouatène », à la frontière avec l’Algérie. Pire, plus au sud, « Bamako est encerclée par la Katiba Macina », une unité djihadiste. Le départ de Wagner constitue un « aveu d’un échec, ou du moins de la nécessité de réadapter le dispositif russe face à un ennemi devenu plus redoutable », avec la recrudescence des attaques menées notamment les djihadistes du JNIM, écrit de son côté le site d’information guinéen Le Djély4.
Or si Wagner quitte le Mali sur un échec cuisant, la Russie reste : la milice privée est remplacée par le groupe Africa Corps, une structure contrôlée par le ministère de la défense russe, qui pourrait réduire les marges de manœuvre de la junte malienne et accroître l’emprise du Kremlin sur les affaires maliennes. C’est en tout cas les conclusions auxquelles aboutit Le Djély qui remet donc en cause la rhétorique souverainiste des militaires de Bamako et de ses relais comme le quotidien malien Info-Matin qui salue la « révolution » menée par l’Alliance des États du Sahel, avec le Mali, le Burkina Faso et le Niger qui ont « fait trembler les fondations du système néocolonial de la France ».
Les quelques observateurs démocrates de la situation déplorent l’absence de véritables choix stratégiques offerts aux peuples africains. Si la seule option reste de choisir entre l’Est et l’Ouest pour désigner le « maître » des peuples africains du Sahel, cela en dit long sur l’impasse politique et institutionnelle dans laquelle ils se trouvent.
Culte de la personnalité et déni de réalité au Burkina Faso
L’autre pilier de cette l’Alliance des États du Sahel, c’est Ibrahim Traoré, le chef de la junte militaire au pouvoir au Burkina Faso. Depuis plusieurs semaines, son visage inonde les réseaux sociaux, notamment sur tiktok, où il est souvent érigé en véritable héros, en grande partie grâce à des images générées par intelligence artificielle. Ce succès numérique participe à répandre son influence dans le monde entier, avec une attraction qui s’exerce non seulement sur une partie de la jeunesse africaine mais également chez certains afro-américains et afro-britanniques.
Qui est ce dirigeant autoritaire de 37 ans et pourquoi est-il si populaire sur internet ? Il a fait toute sa carrière dans l’armée burkinabè jusqu’à obtenir, en 2023, le grade de capitaine. Sa carrière politique débute en septembre 2022 lorsqu’il renverse par un coup d’État le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, lui-même arrivé au pouvoir par la force 8 mois plus tôt (en renversant le président Roch Marc Christian Kaboré, qui avait été démocratiquement élu dès le 1er tour avec 53,5 % des voix et réélu en 2020, toujours au 1er tour avec 57,9%, lors de la seule véritable expérience démocratique du pays). Ibrahim traoré deviendra quelques semaines plus tard président de la transition, alors le plus jeune dirigeant au monde (34 ans). Il se retrouve à la tête d’un pays particulièrement instable, marqué depuis près de dix ans par des violences djihadistes qui ont fait des milliers de morts et causé le déplacement de plus de deux millions de personnes.
En prenant le pouvoir, Traoré avait promis de faire de la lutte contre le terrorisme sa priorité, lançant immédiatement des campagnes de recrutement massive auprès de volontaires, mais aussi de nombreuses opérations militaires. Selon la BBC, cette posture offensive contre les groupes armés lui vaudra le soutien initial d’une grande partie de la population.
Mais sa popularité au Burkina Faso s’accroît lorsqu’il se met à adopter un discours anti-impérialiste critiquant fortement l’ingérence des puissances occidentales, et notamment celle de la France, dont il ordonna le départ des troupes en 2023. Grâce à de nombreuses mesures souverainistes, comme le retrait de certains permis d’exploitation accordés à des entreprises étrangères, et à ses discours mobilisateur, traoré s’est peu à peu construit l’image d’un leader panafricaniste largement inspiré de l’ancien révolutionnaire anti-impérialiste et progressistes Thomas Sankara. Les deux hommes partagent d’ailleurs le même béret et le même grade militaire. C’est cet engagement affiché envers l’unité africaine et contre le néocolonialisme occidental qui séduit une partie de la jeunesse burkinabè et permet à ces discours de résonner dans toute l’Afrique et au-delà.
Mais le béret rouge et le grade de capitaine sont en réalité les seules choses que partagent Traoré avec Sankara, car au-delà des discours le dictateur burkinabè s’est lui-même placé sous la tutelle russe. Depuis fin 2023, les militaires et paramilitaires russes participent, entre autres, à la formation de soldats et coopèrent avec les services de renseignement. Cependant une organisation paramilitaire privée russe n’a fait qu’un court passage dans le pays de mai à fin août 2024 : la Brigade Bear, eux, assuraient notamment des missions de protection de personnalités. De l’ambassadeur russe, selon Viktor Yermolaev, mais aussi très probablement du capitaine Traoré en personne. Le 25 juillet, à Ouagadougou, le chef de la junte avait été filmé pour la première fois, dans une vidéo amateur, entouré et protégé par des paramilitaires russes masqués, en treillis, dont au moins un arborant à son bras un écusson de la Brigade Bear. Ce départ de l’unité paramilitaire russe intervenait alors que le Burkina Faso vient de connaître l’une des pires attaques djihadistes de son histoire. Le 24 août, plusieurs centaines de civils – aucun bilan officiel n’a encore été fourni par les autorités – ont été tués à Barsalogho, à environ 150 kilomètres au nord de Ouagadougou, dans une attaque attribuée au Groupe de soutien de l’islam et des musulmans (GSIM, lié à Al-Qaida). Prétextant alors de rentrer en Russie pour défendre le territoire national (l’armée ukrainienne avait lancé une offensive sur Soudja dans l’oblast de Koursk), le départ de la Brigade Bear au Burkina Faso pourrait aussi être lié à des mécontentements internes en raison de problèmes de paiement de certains combattants.
Le développement de toute une imagerie fictionnelle autour de Traoré sur les réseaux sociaux nourrit un véritable culte de sa personnalité qui s’inscrit dans une stratégie de propagande orchestrée par la junte militaire au pouvoir, visant à faire de Traoré le nouveau symbole de la lutte contre le racisme, le colonialisme et l’esclavage. Pour ce faire, ses sympathisants n’hésitent pas à avoir recours à l’intelligence artificielle, comme dans un clip vidéo qui met en scène le chanteur américain R. Kelly louant la bravoure et le courage du dirigeant burkinabè5. Si la piètre qualité de ce clip dont les copies ont cumulé deux millions de vues sur youtube pourrait prêter à rire, le déluge de contenus générés par intelligence artificielle lui, est bien plus inquiétant, car il est fondé sur la diffusion massive de fausses informations en faveur de Traoré : dernier exemple en date, un faux discours de soutien du nouveau pape Léon XIV au leader burkinabé, que le Vatican a dû démentir.
Traoré est sur ces contenus présenté comme un homme fort combattant des terroristes, soignant des soldats blessés ou priant. De nombreux articles de presse décrivent au contraire un dirigeant peu soutenu par ses pairs et rappellent son incapacité à réprimer l’insurrection islamiste qui a progressé depuis son arrivée au pouvoir. Plus inquiétant encore, ces images occultent totalement les dérives du régime de traoré, qui est, selon de nombreuses sources, impliqué dans des massacres de civils et des répressions violentes de ses opposants : enlèvements visant des hommes politiques, des juges ou encore des journalistes. Dès septembre 2023, de nombreux dissidents du régime ont par ailleurs reçu des ordres de réquisition. Ce déferlement du culte de la personnalité sur les réseaux sociaux prouverait donc au contraire que le dirigeant burkinabé cherche à stimuler un soutien qui lui manque pour légitimer le maintien de sa présence au sommet de l’État.
Le Togo, victime de la déconfiture de ses voisins et de l’incompétence de son régime
Dans le nord du Togo, la population est désormais sous la pression djihadiste, avec l’impression d’un étau qui se resserre autour des habitants de la région des savanes. Son gouverneur alerte sur « l’extrémisme », sur les « tentatives de divisions religieuse ou ethnique »qui menacent dangereusement le tissu social. « Les familles sont démunies », selon la presse locale, car l’insécurité et le sous-développement persistent.
Nous sommes dans cette région du nord à la frontière avec le Burkina Faso, que nous venons d’évoquer. Depuis 2015, un large pan du territoire burkinabè échappe au contrôle de l’État et de son dirigeant, si attentif à son image, malgré ses promesses de sécurité totale. Or le régime Traoré et le régime malien ont fait des communautés peul, un bouc émissaire prise entre l’enclume djihadiste et le marteau des juntes, selon Jeune Afrique dans une série d’enquêtes glaçantes6. Les militaires y livrent les Peuls à la vindicte des paramilitaires.
Par effet domino, plus au sud, la région des savanes au togo connaît, elle, une crise humanitaire inédite depuis 2022, avec des incursions terroristes, des tensions également entre populations déplacées et des agriculteurs : « Pâturages et points d’eau y sont, chaque jour davantage, source de conflits ».
Pourtant, dans la région des Savanes, l’élevage tient une place importante et les villageois togolais ont toujours confié leur bétail aux Peuls : « On s’occupait de leurs bœufs, on a bâti nos maisons près des leurs, et on vivait ensemble, chacun avec son activité. » Les Peuls, sédentarisés, restaient dans les villages avec leurs familles, et les bouviers ne partaient vers la forêt qu’en saison sèche, entre février et mai, quand les pâturages devenaient rares. C’est justement cet équilibre qui s’effondre avec l’augmentation de la population, l’afflux de réfugiés qui ont fui le terrorism au Burkina Faso notamment, sans compter de nouvelles pratiques agricoles et le dérèglement climatique : l’eau manque, l’herbe a disparu.
Même dans les zones reculées du Togo, les groupes armés viennent voler le bétail des communautés peules du nord du Togo et les pâturages, jonchés d’engins explosifs improvisés, sont devenus des terrains dangereux. Les djihadistes ont même tué un jeune Peul qui servait d’interprète à la gendarmerie, symbolisant ainsi le sort réservé à ceux perçus comme proches des autorités. Dans le même temps, les forces de sécurité togolaises soupçonnent les Peuls d’aider les terroristes (phénomène également observé au Burkina Faso7). Cette communauté se retrouve donc prise en étau, forcée à des déplacements incessants. Depuis que les surfaces cultivées prennent le pas sur les pâturages, sur les couloirs de transhumance dans le nord du Togo, « nos bœufs meurent de faim. Les paysans ont labouré partout », déplore un éleveur interrogé par Jeune Afrique. Malgré des appels au dialogue, la communauté Peule souffre au Togo et même dans toute l’Afrique de l’Ouest.
Le Togo est par ailleurs engagé dans un mouvement de contestation du régime « familial » Eyadéma. L’opposition togolaise a dénoncé des arrestations arbitraires lors des manifestations de la semaine dernière à Lomé, la capitale, contre le maintien au pouvoir de Faure Gnassingbé à la tête du Togo.
Ce dernier est à la tête du Togo depuis 2005, comme président de la République et désormais comme président du Conseil des ministres, grâce une réforme constitutionnelle. Mais selon Le Djély, repris par Courrier International, « en mettant l’emphase sur l’évolution du régime présidentiel vers celui parlementaire, Faure Gnassingbé masque plutôt ses propres intérêts en feignant de replacer le peuple au centre du jeu démocratique. Car, dans les faits, il s’est assuré de demeurer encore pour longtemps l’alpha et l’oméga de tous les secteurs de la vie de son pays ». Inacceptable pour « une jeunesse qui refuse de plier », salue le site d’information letogolais.com8 ; c’est une révolte inédite, d’étudiants, d’artisans, de médecins et autres soignants. Si 56 manifestants ont été remis en liberté, a annoncé le procureur de la République à la télévision d’État, d’autres restent en détention. « Mais chaque fois que des menottes se referment sur les poignets d’un combattant, une flamme s’embrase dans le cœur de milliers d’autres. Ils ont voulu réduire au silence Aamron, ce rappeur dont les mots étaient des armes de liberté […] l’heure n’est plus à la peur, mais à la révolte » et à la « résistance nationale ».
Frédéric Faravel
1https://x.com/FbdnStories/status/1933031622057533913
2Le site de ce média est aujourd’hui suspendu…
3https://www.tsa-algerie.com/depart-de-wagner-du-mali-lalgerie-a-t-elle-joue-un-role/
4https://ledjely.com/2025/06/09/mali-wagner-sen-va-mais-pas-la-russie/
5https://www.youtube.com/watch?v=aFrOKH0Rqvo
6https://www.jeuneafrique.com/1693150/politique/dans-le-nord-du-togo-les-eleveurs-peuls-face-a-la-pression-jihadiste/
7https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/la-revue-de-presse-internationale/la-revue-de-presse-internationale-emission-du-jeudi-20-mars-2025-8096505
8https://www.letogolais.com/bertin-arrete-pour-avoir-defendu-aamron-et-la-jeunesse-togolaise-quand-la-repression-attise-la-resistance/