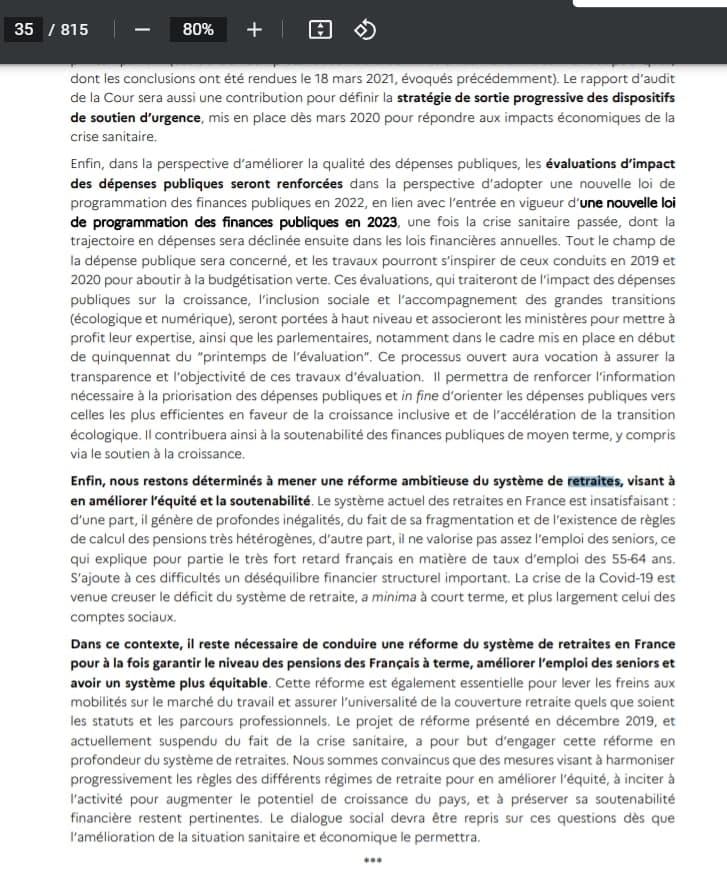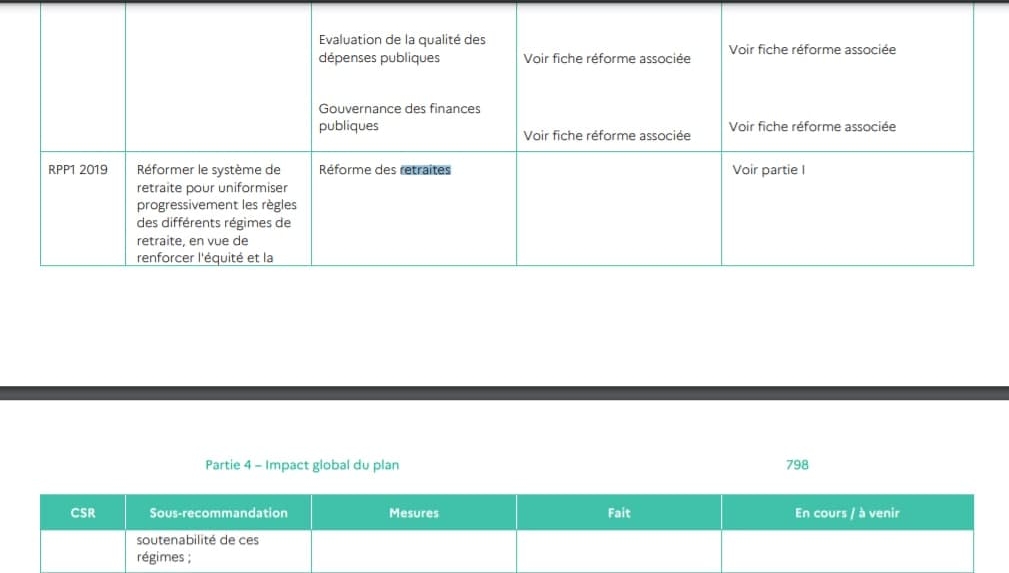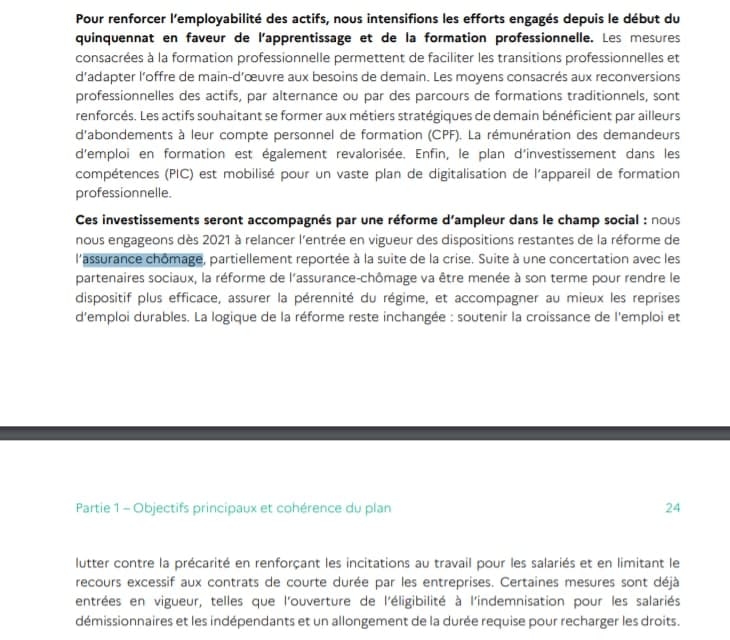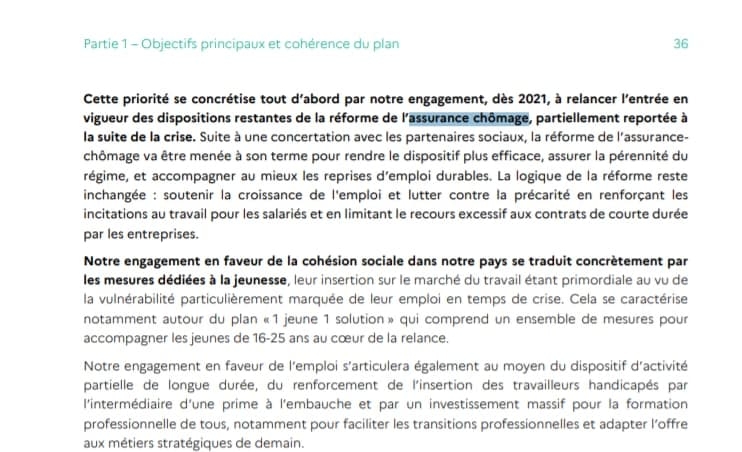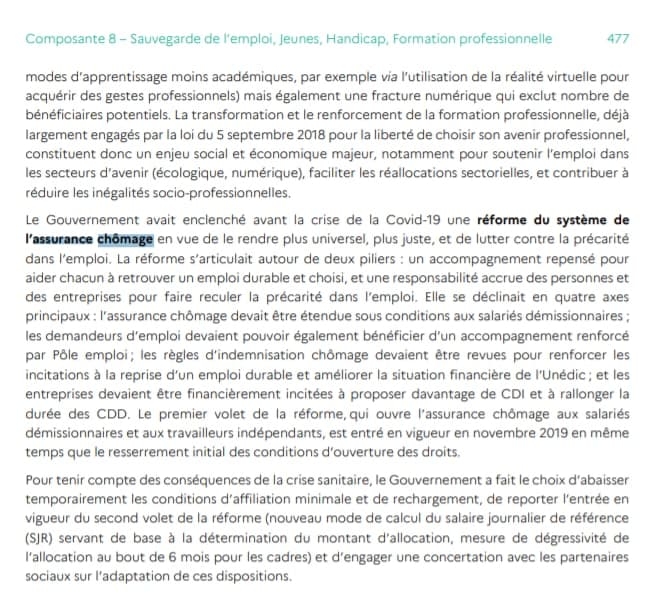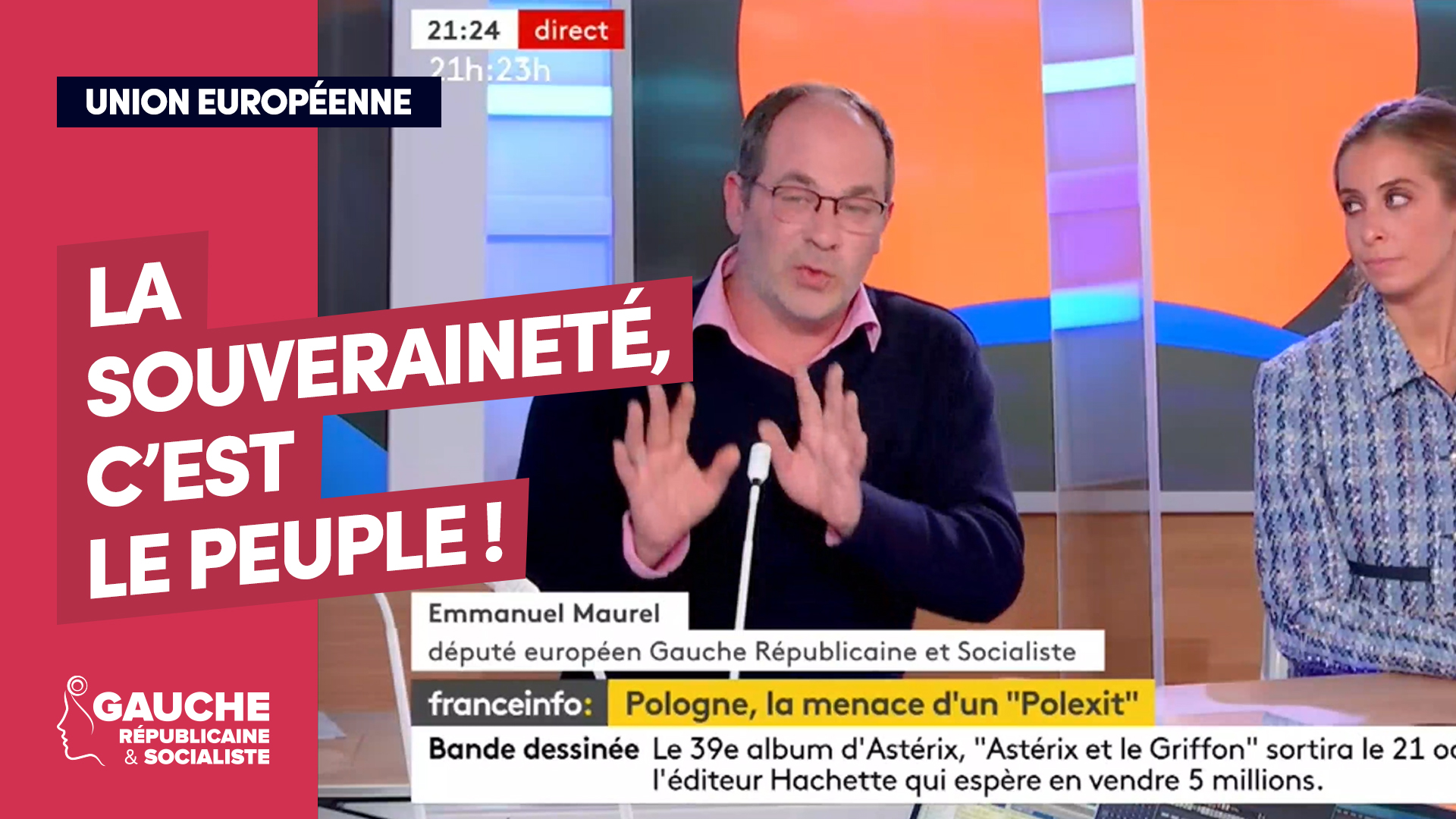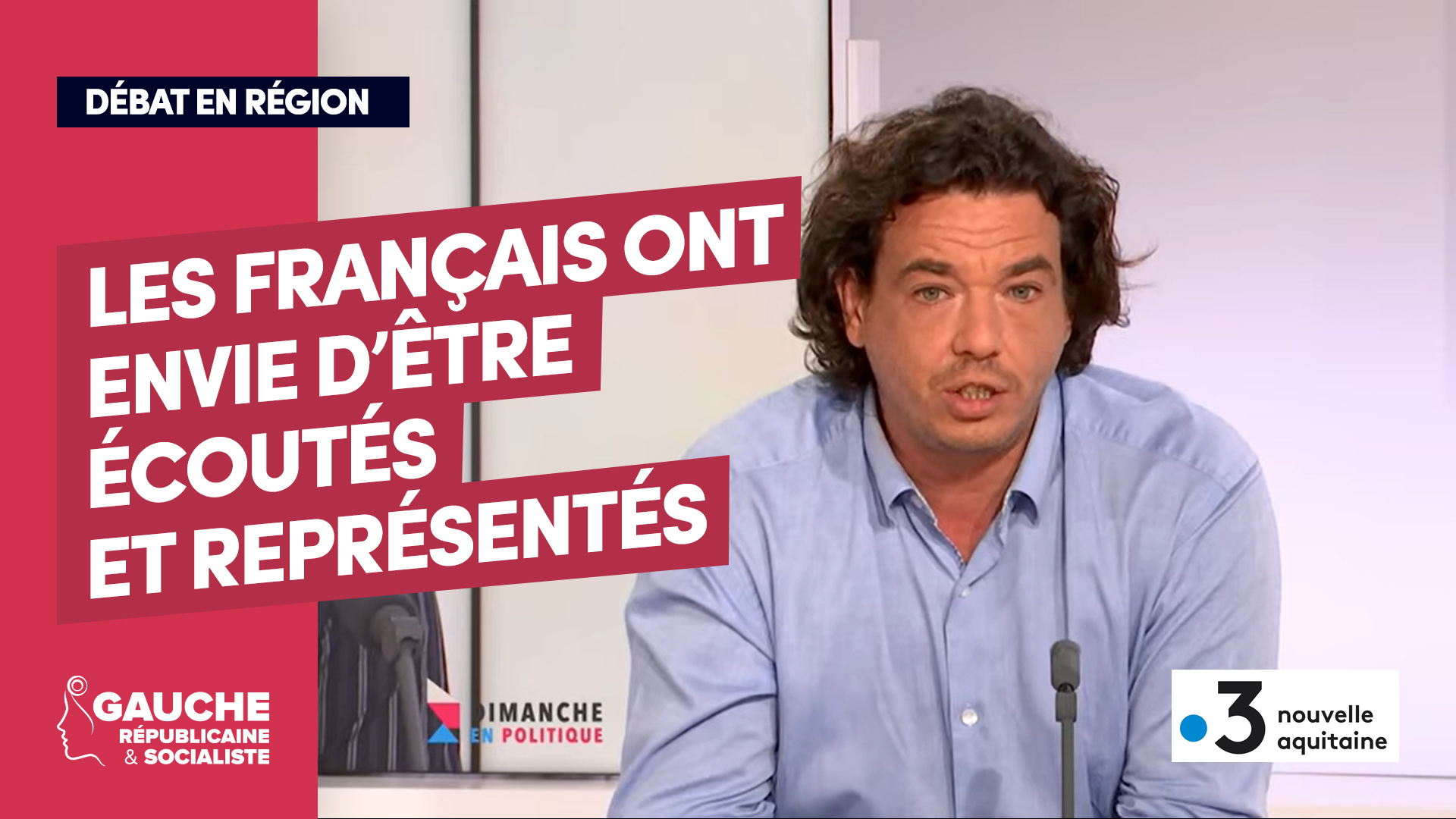Militantes et militants politiques, nous connaissons nos travers qui sont parfois des vertus. Nous avons cette fâcheuse tendance à considérer qu’il ne saurait y avoir de bonheur privé dans une société malheureuse, et qu’il convient de se mêler des affaires du monde pour œuvrer au bien commun. Mais nous avons aussi une propension à vouloir qu’il se passe enfin quelque chose. Nous enrageons à l’idée de vivre dans une époque inintéressante, et nous désirons, parfois contre l’évidence, être les témoins ou mieux, les acteurs, d’un bouleversement, ou d’un moment de basculement.
Aujourd’hui, nous sommes servis. Car même si l’on n’a pas de recul, on peut affirmer que l’on vit un moment de basculement historique.
La crise sanitaire, d’une ampleur absolument inédite, agit à la fois comme un révélateur et un accélérateur.
Révélateur de nos défaillances, de nos vulnérabilités, de nos aveuglements
On se lève un matin de confinement et on réalise que la cinquième puissance du monde, notre pays, est incapable de fabriquer toute seule du doliprane ou des masques. Que la fermeture des frontières d’une petite île du sud-est asiatique entraîne une pénurie mondiale de semi-conducteurs, et donc l’arrêt de la plupart des industries électroniques. Que la mondialisation, les délocalisations et la sous-traitance généralisée entraînent la paralysie de toutes les économies du globe. Que la course au moins disant et l’appât du gain aboutissent à cette situation absurde qui voit un pays très riche en pénurie de matériel sanitaire de base. Il parait que le réel, c’est ce contre quoi on se cogne. Avec le COVID, le choc fut rude.
Le choc du réel, c’est aussi une prise de conscience : la signification concrète des décennies d’austérité ; Nos adversaires n’ont eu de cesse de répliquer que nous exagérions. La vérité, c’est que la situation est encore pire que nous ne l’annoncions. Des hôpitaux débordés, la réserve sanitaire appelée à la rescousse, des milliers d’opérations déprogrammées, des soignants sollicités jusqu’à l’épuisement.
Le choc du réel, c’est la mise en lumière d’un processus aussi insidieux que spectaculaire : l’auto affaiblissement de l’État. A force d’externalisations, de réorganisations, d’économies de bouts de chandelle, d’imprégnation d’idéologie néo managériale, l’appareil d’État a fait preuve d’une incapacité coupable à réagir vite à une crise systémique. Pagaille, mensonges, ordres et contre ordres, improvisations, nullité des hauts fonctionnaires, à commencer par ceux des ARS (qui ont continué, pendant le confinement, à fermer des lits) : l’imprévoyance, le défaut d’anticipation, l’absence de planification, tout cela fut indigne de ce qu’on appelait naguère « l’État stratège ».
Et pourtant, comme toujours, l’État est appelé à la rescousse. On disait qu’il n’y avait pas d’argent magique : on crache des milliards pour financer le chômage partiel et soutenir les entreprises privées. Ça, pour le coup, ça n’a rien d’inédit. C’est le propre du système capitaliste que de de socialiser les pertes et de privatiser les profits.
Mais le fait plus spectaculaire, à la faveur des confinements successifs, c’est l’inversion de la hiérarchisation des métiers. On le savait déjà : l’utilité sociale n’est pas récompensée. C’est même le contraire. Métiers du soin et du lien, logisticiens, caissières, livreurs, éboueurs, femmes et hommes de ménage, aide soignants, assistantes sociales, instituteurs ; les métiers dont on constate le caractère indispensable en situation d’urgence sont les plus mal payés, les plus mal considérés. Cette question de la rémunération du travail pénible, de la considération et de la dignité au travail, avait déjà été soulevée au moment du grand mouvement social des Gilets jaunes. Avec le Covid, elle prend une dimension nouvelle. Les salariés les moins visibles sont entrés dans la lumière. Et ils réclament légitimement leur dû.
La crise agit comme révélateur. Et il est probable que les citoyens aillent au plus court. Il n’y a pas besoin d’aller chercher plus loin les grands axes d’une campagne présidentielle. Démondialisation, retour de l’État dans la vie économique et sociale, augmentation massive des bas salaires, égalité territoriale : si le « monde d’après » a vocation à être meilleur, nul doute qu’il faudra lui faire emprunter ces chemins.
Un formidable accélérateur
Le « monde d’après », on en a tant parlé qu’on a fini par douter de sa réalité. Il n’empêche que la pandémie mondiale et ses conséquences ont renforcé quelques grandes tendances structurelles.
La première est réversible. Notre dépendance à l’égard du sud-est asiatique s’est accrue. Le centre de gravité de la planète se déplace à l’Est. Les capitalistes occidentaux ont trouvé malin de faire de l’Asie le grand atelier du monde. A nous les capitaux et la haute valeur ajoutée, à eux la main d’œuvre pas chère et la production de masse. Sauf que le grand déménagement du monde ne se passe pas comme prévu. Les chinois et les indiens sont tout autant capables que nous de fabriquer des micro processeurs ou des navettes spatiales. Mais nous ne savons pas (plus) fabriquer des masques, des vêtements ou des téléphones.
La deuxième n’est pas nouvelle, mais reste, avec le changement climatique, le problème le plus préoccupant des temps contemporains. L’accroissement des inégalités, entre les continents et à l’intérieur des continents, s’accélère avec la crise.
Au sein du monde occidental, certains ont été épargnés. Une poignée de grandes entreprises en a même bénéficié, réalisant des profits colossaux qui auraient dû être taxés comme ce fut le cas dans les situations paroxystiques du 20eme siècle (voir la taxe Briand sur les profiteurs de guerre en 1916). Pendant ce temps, des millions de citoyens tombaient dans la précarité, à commencer par les étudiants contraints de réclamer une aide alimentaire d’urgence. Les confinements successifs ont contribué à fragiliser les familles occupant des logements trop petits, au décrochage scolaire massif des enfants les plus en difficulté.
La pandémie aggrave la fracture sociale. Et c’est encore plus frappant au niveau du globe. Le génie humain, les progrès de la science, ont permis la découverte de vaccins dans un temps record. Mais le capital n’entend en faire profiter que ceux qui peuvent payer. L’absence de solidarité internationale à des répercussions immédiates. Le continent africain est une fois de plus le grand oublié. Et partout des États vacillent (Liban, Tunisie, etc.) sous les coups de la crise. L’Europe ne fait pas grand-chose pour leur venir en aide.
La troisième grande tendance est hélas, elle, irrépressible. Et elle annonce une mutation plus importante encore que celle produite par la révolution industrielle. L’emprise grandissante du numérique sur nos vies n’en est qu’à ses commencements. Au-delà des réunions zoom, du télétravail, de l’explosion du e-commerce, de l’utilisation frénétique des réseaux sociaux, il y a tout ce qu’on ne voit pas encore et qui pourtant dessine déjà le monde de demain. Les progrès de l’intelligence artificielle et ses perspectives vertigineuses, le Transhumanisme et la surveillance de masse. La progression exponentielle de la blockchain (voir par exemple le recours aux crypto-monnaies) et le projet implicite de dépassement des États dans une sorte de cyberzone dérégulée et décentralisée. La société du tout écran et du tout algorithme, entraînant baisse de l’attention, virtualisation des relations sociales et société du pur présent. Cette révolution technologique est aussi anthropologique. Elle ne s’accommode pas de la lenteur de la délibération collective qui est le propre des régimes démocratiques. Et l’homme augmenté sera, à bien des égards, un humain diminué.
L’ère de l’anxiété
La crise révèle et exhibe nos fragilités psychiques et intimes, elle les accentue et les exacerbe. C’est un sujet politique par excellence. Et pas seulement parce qu’elle se traduit par l’explosion des dépressions, burn out, suicides et autres TCA. Sans vouloir accorder trop de crédit à ce qu’on appelait jadis la psychologie collective, force est de constater que nous sommes entrés dans une ère de l’anxiété qui a des implications politiques concrètes et qu’on doit considérer avec une extrême attention.
Ce n’est pas un hasard si la collapsologie a fait massivement irruption dans la culture populaire. On ne compte plus les livres, les séries, les films, les BD, qui traitent de l’effondrement d’un monde ou d’une civilisation et des stratégies survivalistes à mettre en œuvre pour y réchapper. Les ouvrages sur la chute des empires se multiplient, chacun cherchant dans les catastrophes passées les points communs avec celle à venir.
L’eco-anxiété, par exemple, n’est pas un fantasme de journaliste. Dans la jeunesse occidentale, elle prend des proportions considérables, comme en témoigne la popularité de sa figure tutélaire Greta Thunberg. On peut ne pas goûter les imprécations sans nuance et culpabilisatrices de l’activiste suédoise. Mais elle est représentative des angoisses et des colères d’une jeunesse qui fait du combat pour le climat une cause exclusive, en oubliant parfois son corollaire qui est la lutte contre les inégalités, et qui enrage devant la prétendue inaction des pouvoirs publics et l’indifférence des adultes, au point de sombrer parfois dans une forme de fatalisme contemplatif qu’un très beau petit livre paru récemment résumait par ce titre élégant « plutôt couler en beauté que flotter sans grâce ». Partout fleurissent les manuels de désengagement et d’écologie individualiste.
On ne doit jamais ignorer les aspirations et les peurs de la jeunesse et, à la Gauche Républicaine et Socialiste, nous n’avons pas mis par hasard en exergue de nos documents fondateurs le terme d’écosocialisme. La lutte pour la préservation de la biodiversité, contre le réchauffement climatique, pour un nouveau modèle de développement est au cœur de nos priorités. Et il nous revient de démontrer qu’on peut atteindre ces objectifs sans autoritarisme , en optant pour une planification con duite par la science et la raison.
À l’autre bout de l’échiquier politique, et dans une autre génération, progresse la thèse d’une autre forme de collapsologie. Celle du déclin de la civilisation européenne, rendu inéluctable par l’affaiblissement démographique, le recours non maîtrisé à l’immigration, la faiblesse morale d’une élite cosmopolite dans les États post souverains. Là aussi il faut prendre cette angoisse au sérieux. Évidemment, il ne s’agit pas de faire une quelconque concession aux thèses racistes et bien souvent délirantes d’un Zemmour ou d’un Orbán. Mais ne pas chercher à comprendre les racines de ce que certains ont appelé l’insécurité culturelle, se contenter de renvoyer celles et ceux qui y sont sensibles au camp de l’opprobre et de la honte, c’est s’exposer à de graves déconvenues.
Or il existe une réponse progressiste, humaniste, et, osons le mot, optimiste, à la crise que nous subissons et à l’anxiété quelle suscite
Ce n’est pas une voie royale. Mais le chemin existe. Il existe parce qu’une brèche a été ouverte. Il faut s’engouffrer dans cette brèche.
Je dis qu’une brèche a été ouverte parce que j’ai l’habitude de fréquenter les institutions européennes. Et s’il y a un lieu où pullulent les représentants les plus obtus de la foi libérale, c’est bien là. Or même au sein de la Commission, certains commencent à douter du bien-fondé de leur sainte trinité (rigueur budgétaire, libre échange généralisé, concurrence libre et non faussée). En 2014, dès que je faisais une proposition protectionniste ou régulationniste, je me voyais immédiatement affublé du surnom de « nostalgique de l’économie albanaise ». Aujourd’hui, percuté par le choc du réel, certains de mes contempteurs en viennent à plaider pour des inflexions encore inimaginables il y a trois ans. Plan de relance, mécanismes de défense commerciale, assouplissement des règles sur les aides d’État, taxe carbone aux frontières). On peut penser que c’est cosmétique. Il n’empêche que le fond de l’air idéologique est plutôt du côté de nos thèses. Mais il faut aller vite, car, instruits par l’expérience, nous savons que les portes restent rarement ouvertes longtemps. L’exemple de la crise de 2008 et de ce qui a suivi en témoigne.
Le temps presse. Il ne faut pas négliger le risque d’une évolution négative. Davantage de concentration du capital. Davantage d’inégalités. Sécession définitive des riches. Sociétés archipélisées et communautarisées. Guerre économique et même guerre tout court.
Donc c’est aujourd’hui qu’il faut populariser les grands axes de ce que nous appelions, dans nos textes fondateurs, la nécessaire bifurcation. Bifurcation écologique (changement de nos modes production et de consommation), bifurcation économique et sociale (logique des Bien Communs, rééquilibrage capital/travail), bifurcation démocratique (souveraineté, approfondissement démocratique).
Encore une fois, le moment est opportun. Mettre le pied dans la porte, s’engouffrer dans la brèche, appelez ça comme vous voulez : l’opportunité, elle existe.
Ne nous laissons pas abuser par les analyses paresseuses. À ceux qui diagnostiquent une « droitisation de la société », opposons la formidable actualité des réponses de gauche.
Les gens se disent de moins en moins « de gauche », mais plébiscitent les nationalisations et les augmentations de salaires. Ils associent la gauche à des comportements problématiques (émiettement, pratique du pouvoir décevante ou carrément trahison) mais ils en plébiscitent les idées. C’est le plus important. C’est un solide point d’appui.
Sachons toujours exploiter l’ambivalence du moment
L’individualisme progresse, la dépolitisation aussi en apparence, et en même temps prospèrent mouvements collectifs inorganisés (Gilets jaunes) porteurs de transformation.
L’abaissement du débat public, la tyrannie du clash et du trash, coexistent avec l’émergence d’une myriade de journaux numériques exigeants, de clubs, un impressionnant bouillonnement intellectuel, souvent hors du champ partisan mais bien réel.
Les partis et les syndicats sont dévitalisés. Mais des mobilisations puissantes, souvent mondiales, ne faiblissent pas.
Notre socialisme, fondé sur les grands principes de régulation, coopération, souveraineté, indépendance, se nourrira de ces luttes qui esquissent, sans s’en rendre compte, les contours d’une nouvelle Internationale : celle qui épouse la cause écologique sous toutes ces formes, dénonce les risques des mega-accords commerciaux, combat la malbouffe et l’insupportable gaspillage alimentaire, se mobilise contre l’évasion fiscale, contre l’invasion publicitaire, contre l’uniformité culturelle. Comme il s’inspirera de l’action des collectivités territoriales qui expérimentent les circuits courts et le produire local, les territoires zéro chômeur de longue durée, le revenu de base, et des centaines choses encore qui sont autant de résistances à l’emprise de la société de marché sur nos vies.
Alors redisons le : Les Français n’ont pas perdu le goût de la politique, ils n’ont pas non plus perdu le goût de la gauche. Mais il faut savoir s’en montrer dignes…
La gauche l’est-elle, digne ? honnêtement je n’en suis pas sûr. La présidentielle est certes le moment fort de la vie démocratique française. Mais cela justifie-t-il pour autant que figurent sur la ligne de départ, 5,6, voire 7 candidats ? Les divergences existent : sont-elles à ce point insurmontables ? En privé, chacun s’accorde à dire que « les sondages feront le tri ». Quelle belle ambition intellectuelle ! quelle hauteur de vue ! Le problème de la gauche, ce n’est pas la supposée absence de leadership. C’est la stratégie absurde de la concurrence libre et non faussée dans le domaine électoral.
Je vous le dis : il n’y a pas d’homme ou de femme providentiel. Ni homme de la situation, ni sauveur suprême. Cette conception infantilisante de la démocratie est à mille lieux de notre ADN, qui est celui de la délibération collective et du parlementarisme. Le crétinisme présidentialiste a de beaux jours devant lui : nous ne sommes pas forcés d’y succomber nous aussi. Alors moi je continue, même si c’est décalé avec l’ambiance du moment, à penser que notre stratégie d’un nouveau Front Populaire est la bonne. Que l’élaboration commune d’un pacte législatif est la bonne solution.
Nous n’avons pas renoncé à changer la vie !
Chers camarades,
Nous n’avons pas renoncé à changer la vie. En ces temps de désenchantement démocratique et de recul du militantisme politique, cette profession de foi peut paraître aussi immodeste qu’irréaliste.
Les urgences sont là, spectaculaires et tragiques : réchauffement climatique, inégalités sociales, bouleversements géopolitiques. Nos réponses doivent être à la hauteur de ces défis.
La préparation des élections présidentielle et législatives s’inscrit dans cette perspective politique. Il n’est pas trop tard pour engager la France et l’Europe dans cette grande bifurcation ; il n’est pas trop tard mais il y a peu de temps à perdre. Or le quinquennat qui s’achève nous en a fait perdre.
Que restera-t-il du macronisme ? Un grand mouvement social, celui des Gilets Jaunes, provoqué par une des mesures iniques qui ont fait la marque de fabrique de ce gouvernement. La gestion calamiteuse à grand coups d’improvisations, d’une crise sanitaire inédite, qui a exacerbé l’angoisse des Français. Une série de mesures en faveur des plus riches au moment où le pays tout entier devait son salut aux travailleurs de l’ombre, mal payés et mal considérés. L’abaissement de la France sur la scène internationale, enfin, comme en témoigne l’exemple récent du contrat des sous-marins avec les australiens. Rappeler les ambassadeurs pour une semaine, annuler un dîner de gala, fermer la crise par un coup de fil de Biden et de vagues promesses de coopération, quelle humiliation !
Pour ceux qui ont fait mine d’y croire, les illusions de 2017 se sont rapidement dissipées. Un gouvernement « ni de gauche ni de gauche ». Un candidat prétendument « rempart contre l’extrême droite » qui a fait peu de cas des libertés publiques. Un président incapable de s’élever à la hauteur de l’intérêt général.
Bref, en 2022, il faut tourner la page de l’expérience macroniste. Nous avons toujours dit que notre mission historique c’était l’amélioration des conditions de vie matérielle et morale des Français, particulièrement les plus modestes. Elles ont été largement sacrifiées, méprisées, parfois même matraquées, sous ce quinquennat. 2022 doit être la revanche de la France populaire.
Pour nous, cela passe par une politique de redressement républicain.
Au fond, la question qui continue de nous tarauder, et spécifiquement nous les Français, c’est celle de l’égalité, et, partant, du « modèle républicain ». La République : tout le monde s’en revendique, mais peu la servent ou la font vivre.
Nous venons de discuter de notre programme. Il est riche. Il est incomplet. Il est évidemment imparfait. Mais nous avons un fil rouge, celui de la République Sociale. C’est à la fois un héritage et un projet.
Il n’y a pas de République sans peuple souverain et éclairé. Nous avons beaucoup parlé de souveraineté ce week-end. Mais je voudrais revenir sur la pierre angulaire de toute politique de gauche digne de ce nom. L’éducation. L’éducation. L’éducation.
Pas de République sans un citoyen instruit, éclairé, avant même d’être un travailleur formé.
Pas de République sans un citoyen émancipé de la tutelle de tous les clergés, mais aussi de celle du marché.
Alors, pour conclure, je voudrais partager une colère (celle exprimée par exemple par le collectif des Stylo rouge) et une espérance.
L’école ne va pas bien. Les confinements successifs, je l’ai dit, ont aggravé la situation. Le décrochage scolaire défigure notre nation depuis trop longtemps. Le niveau en mathématiques et en lecture a dramatiquement chuté. Les concours de recrutement sont désertés.
Les professionnels de l’éducation nationale, mal payés et pas toujours considérés à la hauteur de leurs responsabilités, sont confrontés à des situations de plus en plus compliquées. On a longtemps répété que l’école devait rester un sanctuaire. Elle ne l’est pas, ne l’a jamais été. La violence sociale s’y invite. La violence religieuse aussi, et je pense au martyr de Samuel Paty, mort pour avoir enseigne la liberté.
Cette situation est indigne de notre pays. Elle a été aggravée par la politique de Blanquer dont le projet n’est pas celui de la méritocratie républicaine, mais du darwinisme social et du management par le stress.
A l’occasion de cette campagne, décrétons la mobilisation générale en faveur de l’Éducation.
Fixons-nous des objectifs pédagogiques (à commencer par le fameux « lire, écrire, compter ») et politiques (mixité scolaire, lutte contre le décrochage, éducation prioritaire).
Donnons aux professionnels des moyens. Des enseignants soutenus par leur hiérarchie. Des conditions de travail améliorées. Des salaires décents. Une formation continue.
C’est un projet de société à soi tout seul.
Car quelle plus belle ambition que celle de construire une nation éclairée, cultivée, ouverte sur le monde et sa prodigieuse diversité, une nation de savants et de poètes, d’ingénieurs et de scientifiques, une nation de travailleurs bien formés, bien payés et respectés !
Chères et chers Camarades,
Au terme de ce week-end dense et chaleureux, nous repartons de Marseille rassérénés et dotés d’une feuille de route. Dans ces temps confus et incertains, c’est déjà essentiel de savoir pour qui on se bat, et où l’on veut aller. Pour les militants de la gauche républicaine, il n’y a rien de plus exaltant que de se consacrer au redressement de la France.