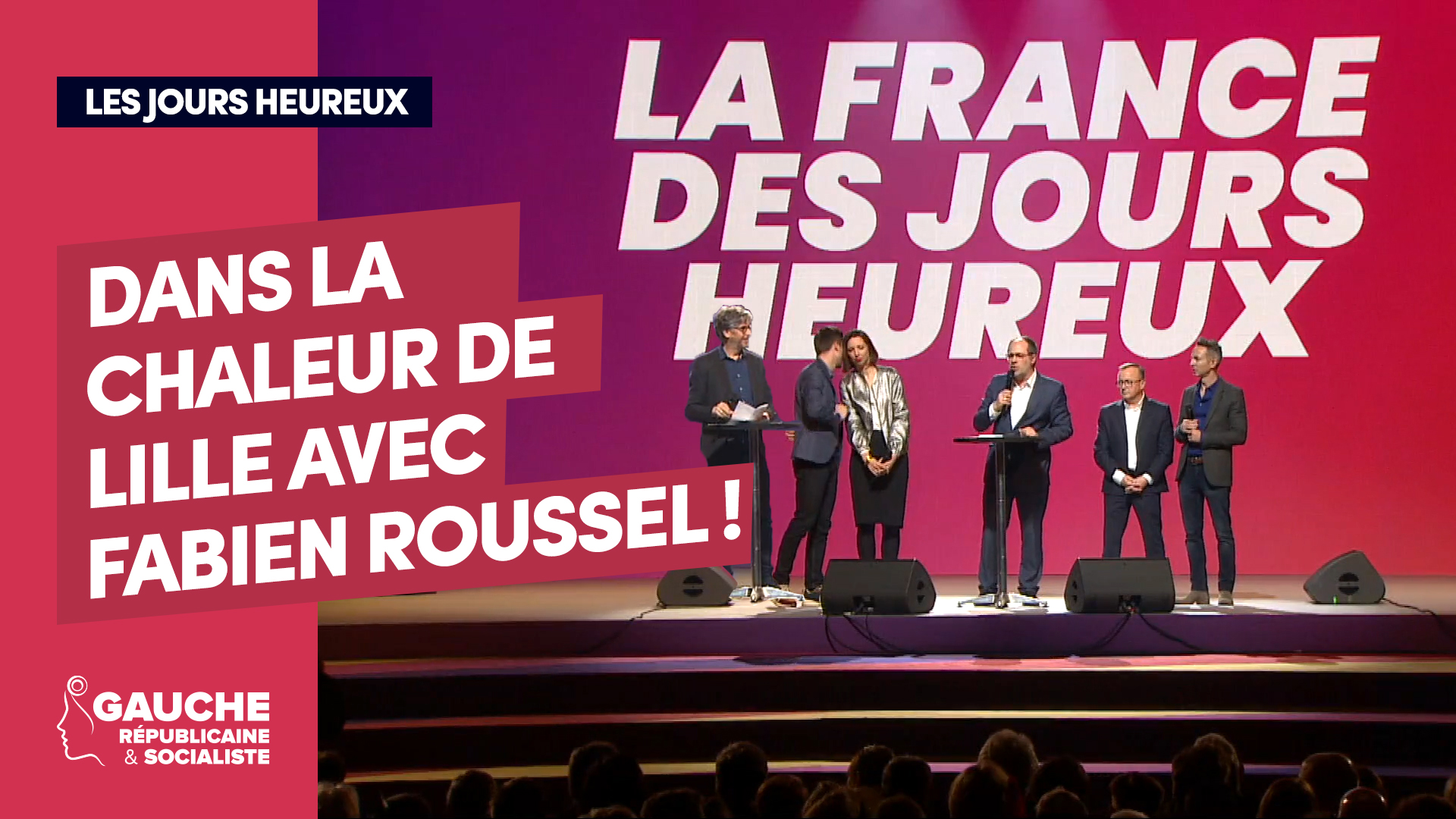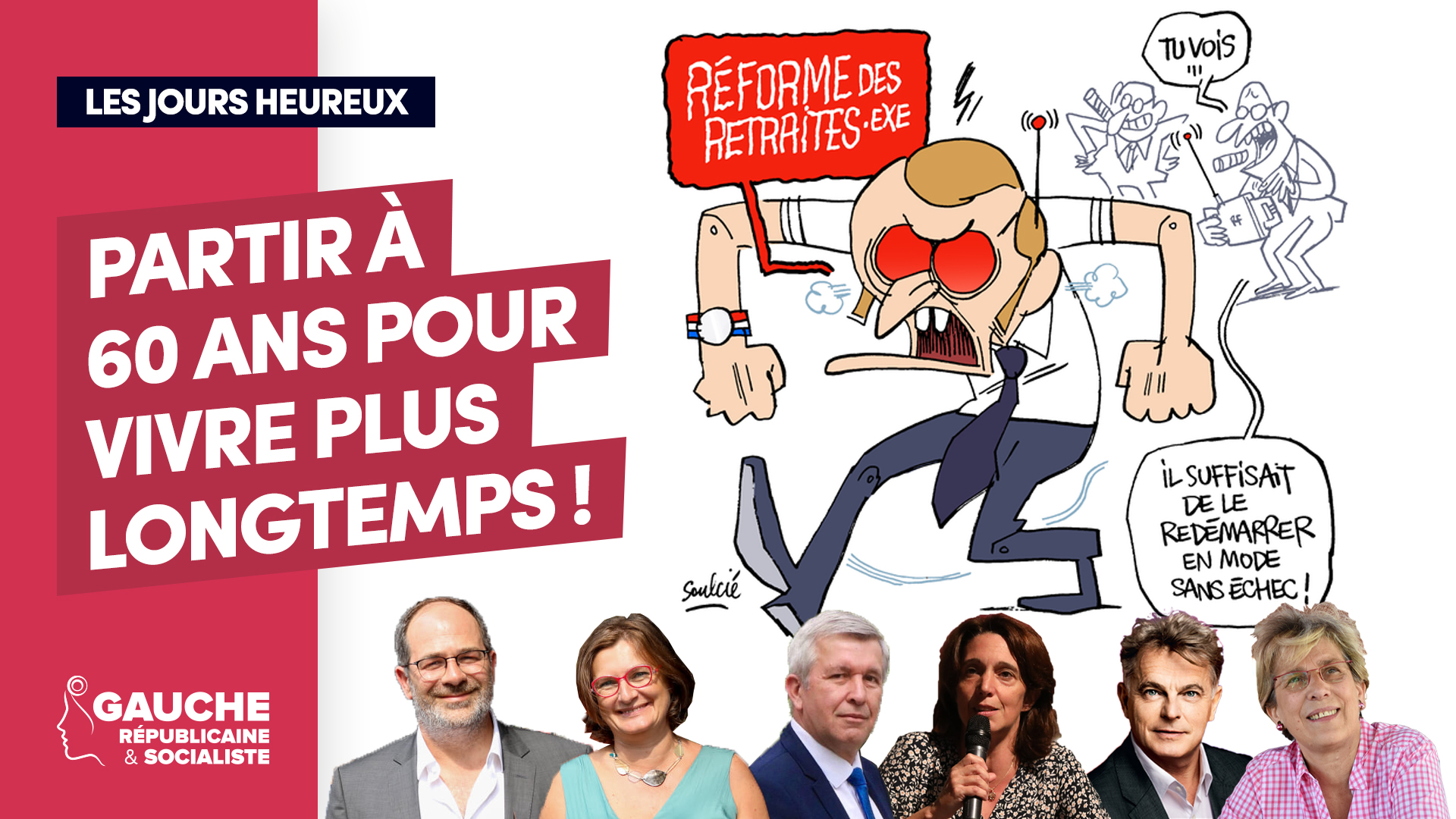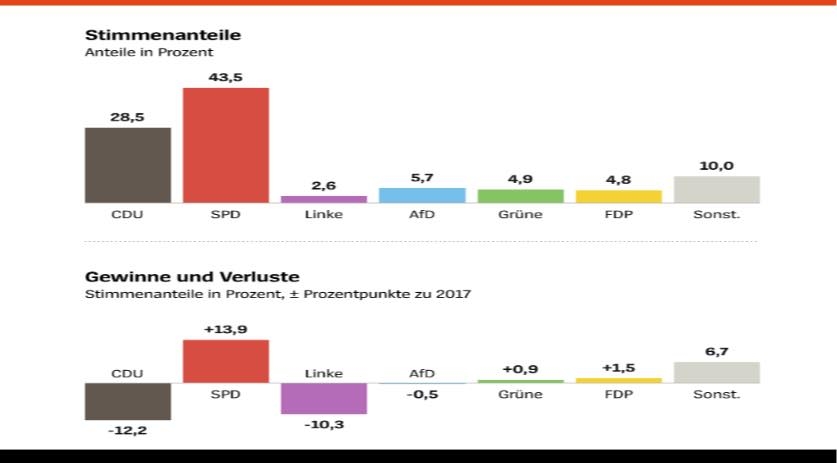L’Union Européenne se trouve aujourd’hui dans une situation à la fois paradoxale et instable.
Paradoxale car les fondamentaux de la construction européenne depuis la trahison démocratique de 2008 n’ont pas changé : la concurrence libre et non faussée, l’austérité budgétaire et le libre-échange forment toujours les piliers d’un système de gouvernement ordolibéral.
Mais ces principes sont remis en cause par une série de chocs, révélateurs d’une Europe percutée par le réel : le repli protectionniste des États-Unis, le nouvel expansionnisme chinois, la montée en puissance des GAFAM, le changement climatique et bien sûr et surtout la crise du Covid-19.
La politique européenne est devenue paradoxale, pour ne pas dire incohérente, à mesure que ces bouleversements ont été pris en compte. À Bruxelles et dans les capitales des États-Membres, on ne tient la ligne qu’à grand peine, tout en esquissant des évolutions contraires.
Les investissements étrangers sont davantage contrôlés. Les géants du numérique font l’objet de nouvelles régulations. La catastrophe climatique oblige à élaborer de nouvelles politiques publiques. Toutes choses aux accents interventionnistes et dépensiers que « l’Europe normale », celle du capital et des marchands, avait en horreur.
Le rachat (certes indirect) de la dette publique par la BCE atteint des niveaux stratosphériques et à partir de l’été 2020, un budget de relance de 750 milliards est approuvé par le Conseil, qui redistribue l’argent non plus seulement à partir des écarts de développement, mais aussi à partir des écarts de conjoncture. Ainsi, très violemment frappée par la pandémie, l’Italie ou la Grèce reçoivent des sommes auxquelles elles n’auraient jamais pu prétendre au titre des politiques habituelles.
Mais la vieille Europe ordolibérale, convaincue « qu’il ne peut pas y avoir de choix démocratique contre les traités » (Jean-Claude Juncker, 2015), se rebiffe. Admettant à contrecœur et du bout des lèvres la violation de ses dogmes, elle prend soin, via Bruxelles et les pays dits « frugaux », de maintenir les États sous la tutelle des « réformes nécessaires ».
Le logiciel européen ne fonctionne plus. Alors que la mondialisation n’offre plus que le visage de la catastrophe, elle ne jure toujours que par l’OMC et signe des accords de libre-échange, pendant que la Turquie, la Russie, la Chine et tant d’autres fourbissent leurs armes. Aux yeux de la Commission, l’Europe-puissance, l’Europe « souveraine », c’est avant tout une Europe au cœur du dispositif marchand.
L’Europe ne comprend pas qu’elle est heurtée de plein fouet par l’instabilité du capitalisme, qui la mine de l’intérieur et de l’extérieur. Le laisser-faire marchand et sa joyeuse émulation compétitive entre égoïsmes individuels engendrent une « main invisible » de l’instabilité et de la division qui s’abat sur tout le Vieux Continent et le fracture, comme en témoignent le Brexit ou les spasmes ultra-réactionnaires qu’on observe en Hongrie ou en Pologne.
Avec Fabien Roussel et son programme « Les Jours Heureux », nous partageons non seulement une analyse commune de la situation et des défis qui sont devant nous, mais nous sommes parfaitement alignés sur les solutions qu’il faut de toute urgence mettre en œuvre ! Au premier rang desquelles l’abrogation du pacte de stabilité, la mise en cause des traités européens qui ont affaibli la souveraineté populaire, la fin de l’indépendance de la Banque Centrale Européenne, mais aussi la construction de coopérations nouvelles entre États et un véritable plan de relance climatique et social d’autant plus indispensable que la guerre de la Russie contre l’Ukraine, État et peuple européens souverains, ont montré nos faiblesses collectives…
La Gauche Républicaine et Socialiste porte des propositions concrètes et détaillées pour refonder et réorienter radicalement la construction européenne. C’est ce que nous vous présentons ici.
L’Europe a plus que jamais besoin de se refonder, sans quoi les soubresauts feront place aux secousses, aux tremblements voire aux effondrements. Pour ce faire elle doit rompre avec le totalitarisme de la finance et du marché ; et s’engager sur un autre chemin, celui d’une union par et pour les peuples, une union fondée sur la coopération, des projets communs mobilisateurs et la capacité des États de peser sur les décisions qui les concernent.
En d’autres termes, nous inversons la phrase de Juncker : il ne peut pas y avoir de traité européen contre les choix démocratiques !
Le pré-requis : une Europe démocratique
Une Europe au service des citoyens respectant la souveraineté des États
Le bilan politique et démocratique de l’Union Européenne n’est guère reluisant depuis 1992. L’idéologie néolibérale qui imprègne les cadres européens et ligote le suffrage universel n’est plus tenable. Si l’Europe a un sens, c’est une Europe fondée sur la prise en compte des intérêts de ses habitants. Or à ce jour, ceux-ci n’identifient pas « d’intérêt général européen ». Pour exister, celui-ci doit non seulement respecter l’intérêt général des États-Nation mais aussi redéfinir les principes contenus dans les Traités.
DES MOYENS :
Pour un « intérêt général européen » fondé sur de nouveaux principes et le respect des États-Nation.
Au niveau national :
● Adopter une loi organique régissant les relations entre l’Assemblée Nationale, le Sénat et le Gouvernement en matière européenne. Au centre du dispositif : l’instauration d’un mandat du Parlement avant chaque Conseil, assorti d’une procédure de ratification similaire à celle des ordonnances, accroissant le pouvoir de négociation, d’orientation et de contrôle des représentants du peuple sur les décisions de l’Exécutif (à noter qu’une telle procédure existe dans d’autres États-Membres, dont l’Allemagne) ;
● Conférer au Parlement un pouvoir d’amendement des règlements européens (les directives sont par natures modifiables, puisqu’elles nécessitent une transposition législative), selon une règle de majorité renforcée (par exemple les 3/5èmes) ;
● Abolir le traité d’Aix-la-Chapelle, qui instaure une sorte de directoire franco-allemand sur l’UE au mépris de partenaires et amis historiques comme l’Espagne ou l’Italie ;
● Modifier la Constitution afin de :
● Résoudre définitivement le conflit de hiérarchie des normes entre la Cour de Justice Européenne, qui estime que la totalité du droit européen (y compris les décrets, appelés « actes délégués », pris par la seule Commission) est supérieur à notre Loi Fondamentale ; et le Conseil constitutionnel, qui se refuse à l’admettre. La Constitution doit être explicitement placée au sommet de la hiérarchie de toutes les normes, nationales, internationales et européennes ;
● Protéger certaines compétences, particulièrement celles relevant d’un service public d’une intrusion du droit communautaire (sans bien sûr empêcher toute coopération européenne), par exemple en matière de… santé. En effet, qui souhaite subordonner la santé à la « concurrence libre et non faussée » ?
Au niveau européen :
● Définir davantage de limites aux « Quatre Libertés » inscrites dans les Traités (libre-circulation des biens, des capitaux, des services et des personnes). Celles-ci ne peuvent généralement être entravées ou régulées qu’en cas de « force majeure » (par exemple la pandémie, le terrorisme ou l’imminence d’un défaut de paiement), ce qui n’est pas démocratiquement compatible avec la mise en œuvre de politiques différentes de celles « recommandées » par les Traités. Ainsi, nous considérons absolument indispensable d’abolir l’article 63 du Traité, qui confère un caractère presque illimité à la liberté de circulation du capital (y compris hors de l’Union Européenne !). Nous considérons également que les services publics et les marchés publics ne peuvent être soumis à la règle de « libre circulation des services » ;
● Confier le droit d’initiative législative (hors budget de l’Union) non plus seulement à la Commission, mais aussi au Parlement et au Conseil ;
● Abolir le Semestre Européen (procédure encadrant les budgets nationaux par la « règle d’or » budgétaire et l’obligation de procéder à des « réformes structurelles »). En cas de refus par nos partenaires, la France devra signifier son refus de l’appliquer ;
● Associer plus étroitement le Parlement européen aux négociations commerciales, via un pouvoir de validation de chaque chapitre des traités de libre-échange.
Une Europe exemplaire en matière de justice sociale et fiscale
Faire de l’Europe un rempart contre la libéralisation et la flexibilisation de l’économie
Les dogmes du libéralisme affaiblissent non seulement la confiance des citoyens dans l’économie, mais l’économie elle-même. Un profond changement de cap s’impose afin d’éviter le dumping entre États membres.
DES MOYENS :
● Salaire minimum européen de 1 000€ minimum, non opposable aux législations nationales plus favorables ;
● Abrogation de la directive sur le travail détaché ;
● Mettre en place un « Buy European Act » sur le modèle du « Buy American Act » voté en 1933, qui garantit aux entreprises américaines un accès prioritaire aux marchés publics ;
● Taux minimum d’impôt sur les sociétés à 20% sur les multinationales ;
● Taxe carbone aux frontières de l’Union afin de limiter les « fuites de carbone », augmentant les droits de douane du coût des gaz à effet de serre contenus dans la production des marchandises étrangères. Cible d’au moins 100 euros la tonne de carbone ;
● Taxe sur les transactions financières et sur le numérique. Interdiction du minage du Bitcoin et de toute cryptomonnaie privée, interdiction de tout paiement au moyen de ces cryptomonnaies ;
● La France instaurera une présomption d’évasion fiscale vis-à-vis de tout mouvement de capitaux vers le Luxembourg, l’Irlande, les Pays-Bas, Malte et Chypre. Elle rapatriera les sièges sociaux délocalisés dans ces pays (ex : Renault) ;
● Interdire toute délocalisation dans le but de réexporter vers les pays d’origine ;
● Faire du respect des droits de l’homme, des droits des travailleurs et de l’engagement environnemental et climatique une condition contraignante, vérifiable et sanctionnable par le Parlement européen, à la conclusion et la mise en œuvre de tout accord commercial, y compris passé ;
● Instaurer un mécanisme de suspension provisoire de tout ou partie des relations commerciales avec des pays violant les droits de l’Homme, des travailleurs, les engagements climatiques ou la propriété intellectuelle.
Une Europe indépendante et maîtresse de son destin
L’Europe peut être fière de la remise en question qui a suivi les guerres, les exterminations, les génocides et les idéologies totalitaires. Elle incarne la réconciliation entre les peuples, mais aussi l’espérance de démocratie et de prospérité partagée. Pourtant, les menaces et le spectre de l’autoritarisme refont surface dans un monde de plus en plus instable. L’Europe doit proclamer son indépendance sur la scène internationale, et promouvoir un modèle démocratique européen.
DES MOYENS
● Sortie de la France du commandement intégré de l’OTAN. Boycott de toute politique de défense européenne qui lui serait subordonnée. Exclusion des investissements militaires du calcul du déficit. Remise à plat des partenariats de défense, en cours ou à venir (par exemple le SCAF, « l’avion du futur » franco-allemand) ;
● Coopération renforcée avec l’Espagne, l’Italie et la Grèce pour relancer le projet Euro-Méditerranéen, négocier et conclure un traité d’amitié et de coopération politique, économique et culturelle avec le Maroc, l’Algérie, et la Tunisie. Adopter un agenda similaire pour l’Égypte, Israël et le Liban. Soutenir la stabilisation de la Libye ;
● Reprise et accélération des négociations d’adhésion avec la Serbie et la Macédoine du Nord. Subordonner les négociations d’adhésion avec la Bosnie à une remise en état préalable de son système institutionnel.
Une Europe qui rapproche : pour une vision culturelle
Souder l’Europe à travers la culture (« admirez-vous les uns les autres » Verhaeren)
L’Europe ne peut se réduire à un simple projet économique ou à des valeurs morales. Elle doit aussi rassembler les citoyens par la culture, en valorisant les littératures, les musiques, les architectures, les savoir-faire, les philosophies, les histoires, les traditions.
DES MOYENS
● Favoriser le multilinguisme est la clé pour rendre l’intercompréhension possible, nous devons donc œuvrer en ce sens :
● À travers l’Europe, l’apprentissage d’au moins deux langues européennes pour tous les jeunes Européens dès le plus jeune âge. Le but est d’avoir des Européens trilingues d’ici une génération ;
● Les langues officielles de l’Union doivent être respectées à tous les échelons. Aucune procédure législative ne pourra être validée sans une stricte conformité à cette règle. Les réunions de travail à tous niveaux et dans tous les organes de l’Union devront alterner les langues officielles, afin d’en finir avec la pratique conformiste, paresseuse et médiocre du « tout anglais ». Des moyens supplémentaires en interprétariat (y compris numérique) devront être engagés à cet effet.
● La valorisation du patrimoine immatériel est une autre condition sine qua non de lutte contre l’uniformisation culturelle du monde :
● Nous devons proposer notre propre modèle de reconnaissance du patrimoine immatériel européen ; il faut également créer des circuits culturels européens transnationaux autour des thèmes chers à l’histoire européenne : ces circuits doivent être accessibles à toutes et tous et doivent proposer un contenu varié afin de satisfaire toutes les sensibilités ;
● Le soutien public à la création en y consacrant des fonds conséquents mais également des politiques protectrices (notamment en matière de propriété intellectuelle) est un enjeu de taille : la valorisation du patrimoine immatériel ne saurait être complète en ignorant la production continue d’œuvres immatérielles ;
● Le fond culturel européen doit devenir une réalité qui permet la diffusion de la culture européenne dans l’Europe mais également au-delà des frontières du continent afin de perpétuer et de renforcer le rayonnement culturel européen.
● Éducation européenne – l’éducation est le moyen privilégié de transmission de la culture et de renforcement de la citoyenneté :
● Sortir les dépenses publiques d’éducation et de formation professionnelle du calcul des déficits ;
● Élargir le programme Erasmus pour le rendre accessible à tous les jeunes Européens (non plus seulement à certains étudiants) : en finir avec la sélection drastique qui fait des étudiants de ce programme des heureux élus.