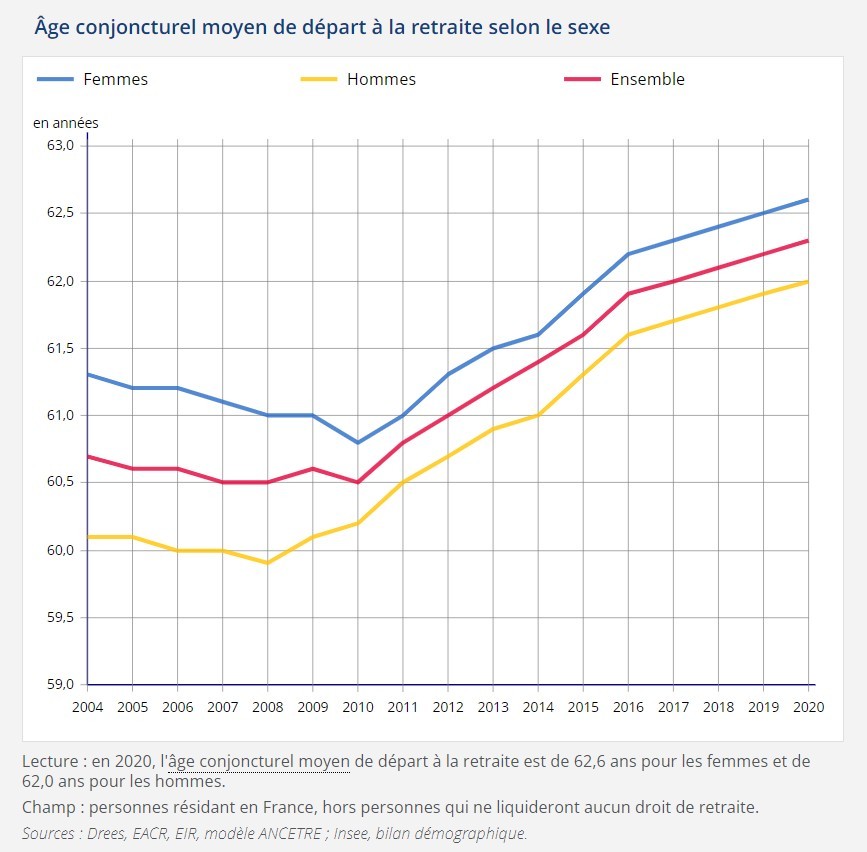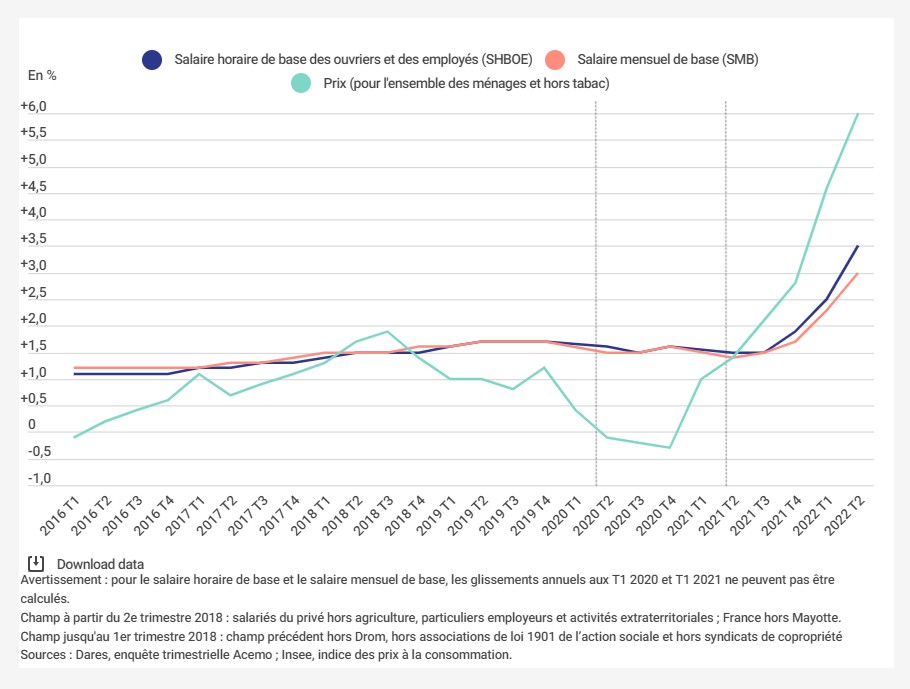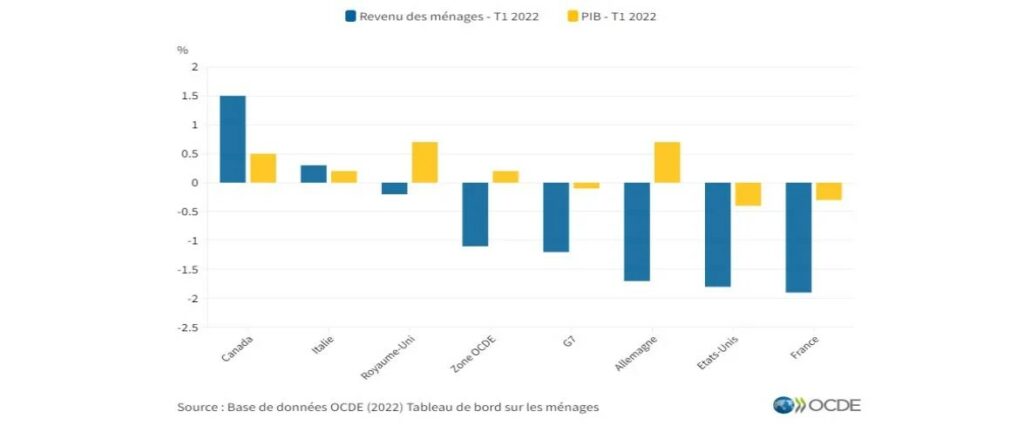Le 2 janvier dernier, les juges d’instruction ont prononcé un non-lieu dans l’enquête sur l’empoisonnement des Antilles au chlordécone. La Gauche Républicaine et Socialiste fait un point complet sur le dossier.
Pour quelles raisons un non-lieu a-t-il été prononcé ? Les juges d’instruction du pôle de santé de Paris estiment tout simplement que les faits sont prescrits. Ce n’est malheureusement pas une surprise au regard du non-lieu prononcé par le parquet de Paris en novembre 2022.
Pourtant, cette volonté de ne pas prononcer de jugement ou même de débattre de ce désastre humain, sanitaire et écologique, quelle que soit la date des faits, ne rend pas honneur à notre système judiciaire.
Pour rappel, qu’est-ce que le dossier de la pollution à la chlordécone aux Antilles ?
La pollution des Antilles par l’utilisation du chlordécone est un exemple, aujourd’hui classique, de la manière dont les excès du productivisme et du libéralisme (et un certain aveuglement administratif) détruisent la nature et détériorent les conditions de vie humaines.
L’histoire commence il y a plus de soixante ans. Après la Deuxième Guerre Mondiale, les États sont engagés dans une logique de reconstruction et de relance économique avec ce que cela comprend en termes d’avancées scientifiques, notamment sur les méthodes et les leviers de production. C’est dans ce contexte qu’est inventé le chlordécone.
Découvert dans les années 1950, il est connu dans le milieu agricole comme un pesticide qui permet d’augmenter les rendements. Ses résultats sont démontrés et sa production devient exponentielle notamment aux États-Unis. Cependant, dix ans après son lancement, des premiers travaux prouvent qu’il est hautement toxique pour l’homme et pour la faune. Les mises en garde n’empêcheront pas Jacques Chirac – alors ministre de l’Agriculture et de l’Aménagement rural – de délivrer une Autorisation de Mise sur le Marché provisoire sous le label Képone. Paradoxalement, le chlordécone fait déjà l’objet d’interdictions aux États-Unis au même moment. Ainsi, un gouverneur ira jusqu’à fermer l’accès d’une rivière au public car polluée au-delà des doses acceptables par le pesticide.
À la même époque, en France et pendant plus de 20 ans, le chlordécone est largement utilisé aux Antilles. Comme certains pays d’Afrique, où il existe une culture intensive de la banane, l’objectif est d’arrêter le développement d’un parasite, le charançon du bananier, et d’accroître les rendements des producteurs locaux. La question de son interdiction ne se pose à aucun moment car les quelques travaux de recherche qui existent sur le sujet démontrent que le chlordécone se développent qu’au niveau des racines et non au niveau des fruits suspendus. Ouf ! il n’y a donc aucun risque pour les populations européennes et américaines qui consomment massivement de la banane antillaise : circulez, il n’y a rien à voir… Quant aux agriculteurs des territoires concernés, ils ne s’en plaignent pas. Du moins pour le moment…
Au fur à mesure des épandages, la Martinique et la Guadeloupe accumulent plus 300 tonnes de chlordécone pulvérisés sur plus de 20 ans, jusqu’en 1993 où sont usage sera interdit.
Bilan, on estime aujourd’hui que 16% des sols, les rivières, les nappes phréatiques, le littoral de la Martinique et de la Guadeloupe sont pollués au chlordécone pour au moins 600 ans, selon des rapports les plus optimistes. Le plus inquiétant est qu’il s’agit là de chiffres officiels et que des recherches approfondies pourraient vraisemblablement apporter des informations plus alarmantes.
Les études menées prouvent que la catastrophe touche non seulement la nature et la biodiversité mais aussi l’être humain. Ces faits sont rapportés dans les mises en garde de l’Institut National de la Recherche Agronomique ou encore des enquêtes, comme « Kannari1 », de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, qui indique que 92% des personnes testées en Martinique ont du chlordécone dans le corps et que 19% des enfants testés dépassés la dose toxique.
1 Une étude de santé sur la nutrition et l’exposition à la chlordécone afin d’évaluer l’exposition, de l’évolution de l’état de santé des populations, de rechercher les facteurs associés et d’établir des référentiels.
Les implications de la pollution à la chlordécone aux Antilles françaises…
Les effets pour l’homme sont de plusieurs natures : sanitaires, environnementaux, économiques, démographiques et sociaux.
Aujourd’hui considéré comme un perturbateur endocrinien, l’utilisation du chlordécone est à l’origine de nombreux cancers de la prostate. Sur l’ensemble des personnes interrogées, on constate qu’elles ont eu à manipuler ce produit depuis leur plus jeune âge, et ensuite sur plusieurs années, sans protection dans les bananeraies des Antilles. Cela représente en moyenne 600 nouveaux cas chaque année, faisant de la Martinique et la Guadeloupe des territoires détenteurs d’un triste record : celui des plus forts taux de cancer par habitants au monde.
Les naissances prématurées (accouchements à 37 semaines de grossesse), les handicaps lourds, les malformations et les effets sur le cerveau chez les enfants, nés de parents détenant un taux de chlordécone supérieur à la moyenne non létale1, sont les autres séquelles de cette pollution. Pour reprendre les mots de Josette Manin, députée de la Martinique, « les agriculteurs qui ont manipulé ce poison pendant ces longues années de tolérance agonisent lentement ».
Les impacts économiques, en dehors de l’accroissement du niveau de rendement de la banane sur quelques années, sont aujourd’hui très importants. La filière de la banane est touchée de plein fouet soit par la mauvaise publicité dont souffre aujourd’hui la banane antillaise soit par la concurrence directe qui est imposée par les producteurs de pays du bassin caribéen.
Par ailleurs, les produits de la mer et les filières viandes sont impactés en raison de la pollution directe des cours d’eaux, des nappes phréatiques, des rivières, du littoral et des sols. Les animaux sauvages, le bétail domestique ainsi que les poissons qui fraient auprès des côtes et sont consommés par les populations locales, alors qu’ils sont intoxiqués, ne sont pas des exceptions. Pour des populations qui produisent des biens d’autoconsommation en circuits dits « informels » (jardins créoles, plantations sur des petites parcelles de terre, etc.) – afin de pallier la cherté des produits de circuits formels (supermarchés, hypermarchés, etc.) ou par pure tradition – les risques de contamination restent très forts.
Les difficultés induites pour le secteur de la pêche traditionnelle sont terribles, car les ressources halieutiques sont aussi affectées par la chlordécone. Cela les oblige à s’éloigner du littoral avec toutes les difficultés qui y sont liées : les équipements sont rarement adaptés pour la pêche en haute mer ; il serait utile de mesurer dans quelle mesure cette évolution a potentiellement accru le nombre de disparitions de pécheurs traditionnels. Pour couronner le tout, ils souffrent d’une forte concurrence d’armateurs mieux équipés.
La concurrence est donc plus rude entre les produits auto-consommés et les produits industriels qui bénéficient, souvent à tort, d’une image d’alimentation « zéro chlordécone ». Cela condamne une grande partie des agriculteurs et prive les populations de leurs jardins créoles sur lesquels reposent souvent une partie de l’équilibre alimentaire et économique des familles. Par ailleurs, cela accentue aussi la dépendance aux produits de consommations issues des importations. Il conviendra là-aussi d’évaluer l’impact sur les taux d’émissions de gaz à effets de serre du fait de l’accentuation des achats de produits importés provenant des Amériques ou d’Europe. Il est regrettable que des amendements qui allaient dans ce sens aient été déclarés « cavaliers législatifs » et n’aient donc pas été discutés lors de l’examen de la loi « Climat-résilience » à l’Assemblée Nationale2 à l’été 2021.
Tout cela vient affecter l’économie de la santé dans les Antilles. Les Antilles françaises connaissent des difficultés sanitaires structurelles – budgets, matériels, équipements insuffisants, manque de personnels pour accueillir convenablement les patients, vétusté et délabrement de certains sites hospitaliers : l’empoisonnement au chlordécone accroît donc constamment les obligations de soins existants, alors même que la pandémie a multiplié les obstacles pour l’accès aux soins. Il est difficile d’imaginer le sort des patients atteints de cancers et qui ont subi des déprogrammations dans le contexte de la lutte contre le Covid 19.
Sur plan de l’agitation sociale, la prescription invoquée dans l’affaire chlordécone aura participé aux actions qui ont abouti à la destruction de statuts à Fort-de-France et à Pointe-à-Pitre, rouvrant ainsi des douleurs séculaires.
Le manque d’action de l’État, sur ce dossier comme sur d’autres en Outre Mer, vient alimenter l’idée que l’État français pollue et ne participe nullement au développement des Antilles, volontairement. En effet, quand on voit les freins au développement économique et social des Antilles, mais aussi des territoires comme la Guyane et Mayotte, et la « lenteur systémique de l’État » pour y apporter des réponses, on peut comprendre que de telles considérations aient émergé ou aient été renforcées. Les problématiques structurelles existantes aux Antilles – l’éloignement géographique avec l’Hexagone, insularité, climat, démographie en nette chute depuis 30 ans – en sont accrues.
Ainsi la pollution des Antilles au chlordécone trouve une profonde résonance sanitaire, économique, sociale mais aussi politique et culturelle ; malheureusement, toutes les conséquences du dossier ne sont pas encore connues. Nos compatriotes antillais perçoivent ainsi très durement ce qui apparaît de plus en plus comme un évidence : l’inaction de l’État français et son incapacité à entendre leurs plaintes.
1 La dose létale moyenne est un indicateur quantitatif de la toxicité d’une substance et mesure la dose de substance causant la mort de 50 % d’une population animale donnée (souvent des souris ou des rats) dans des conditions d’expérimentation précises.
2 La logique consistant à repousser sans autres formes de procès des amendements qui pourraient gêner le Gouvernement en considérant que les dispositions présentées dans un amendement n’ont rien à voir avec le sujet traité par le projet de loi. Or, même si la pollution au chlordécone n’est pas une des premières causes du réchauffement climatique, l’on ne peut nier ainsi un lien avec ce sujet.
Comment réparer une injustice que même la justice ne veut plus résoudre ?
Il aura fallu tant de cris d’alarme, de larmes, de rapports et de morts avant que l’État ne décide enfin de s’impliquer, du moins politiquement, dans ce drame. N’oublions pas que la reconnaissance officielle, pleine et entière, de cette tragédie ne date que du 27 septembre 2018. Cette date est historique car c’est la première fois qu’un Président de la République parle d’aller « vers les chemins de la réparation » sur ce dossier.
Cependant, depuis cette date, les avancées sont faibles, et ce malgré la littérature, les mises en garde et les travaux parlementaires sur le sujet. Du côté de ces derniers, on dénombre :
- Une proposition de loi visant la création d’un fonds d’indemnisation des victimes du chlordécone et du paraquat en Guadeloupe et en Martinique, complètement vidée de sa substance par la majorité LREM de l’Assemblée Nationale ;
- Une commission d’enquête parlementaire qui a permis de comprendre et de découvrir les raisons et les responsabilités liées à l’utilisation de ce poison et qui a soumis 42 propositions pour réparer les préjudices causés. Or, malgré les annonces présidentielles, la République En Marche a toujours refusé de mettre en place des leviers financiers et matériels importants pour dépolluer les Antilles.
LREM et l’exécutif se réfugient derrière la mise en œuvre d’un Plan Chlordécone, le quatrième depuis 10 ans, pour apporter des réponses et apaiser les populations. Mais les moyens alloués à ce plan sont bien en deçà des attentes des populations au niveau sanitaire, économique et social.
En réalité, l’affaire chlordécone pose la question de la place faite à l’Outre-mer au sein de la République. Elle démontre la discrimination systémique et inacceptable de citoyens de la République, du fait de décisions prises à plus de 8000 kilomètres des Antilles. La pollution à la chlordécone et ses suites politiques et judiciaires font étrangement penser aux essais nucléaires sur l’atoll de Mururoa. Ce sont les réseaux sociaux et les mobilisations citoyennes ont permis de mettre ces tragédies sur le devant de la scène.
Les Outre Mer contribuent de manière substantielle à notre rayonnement dans le monde – la France est la République sur laquelle le soleil ne se couche jamais – et participe largement à faire de notre pays la puissance mondiale qu’elle est encore. Ils apportent à la France plus de 90% de sa richesse en matière de biodiversité marine1, plus de 90% de ces territoires maritimes, plus de 90% de son rayonnement à l’international hors de l’Union Européenne en étant tournées vers l’Afrique, le Pacifique et les Amériques. Notre République est une et indivisible et reconnaît en conséquence nos concitoyens d’Outre-mer au sein du peuple français, cependant, dans les faits, ces territoires et leurs habitants sont trop souvent considérés comme une ligne budgétaire qu’il s’agirait d’alléger.
La création du crime d’écocide aurait permis d’apporter de la justice sociale dans cette affaire, qui est aujourd’hui sous le coup d’une prescription – de quoi alimenter l’imaginaire sur le dossier et les rétropédalages du Gouvernement, au profit des lobbies.
Aimé Césaire, poète et parlementaire antillais disait qu’« une civilisation qui ruse avec ses principes est une civilisation moribonde ». Dans cette affaire, l’État français a rusé avec les principes républicains à de multiples reprises. In fine, le dossier chlordécone est symptomatique du traitement de l’Homme par l’Homme et de la nature par l’Homme : c’est au nom de la recherche d’une production et d’une profitabilité maximale que les plantations de bananes ont été aspergées de chlordécone, sans prise en compte des effets, y compris une fois connus ceux-ci.
Plus que jamais, cette catastrophe doit nous faire réfléchir sur nos modes de production et de consommation, nous ne pouvons continuer à adhérer à un libéralisme économique mortifère et brutal qui est la cause première de nos maux. Nous devons rétablir le lien entre la nature et l’homme tout en acceptant qu’il y ait un tribut à payer à la nature – le seul critère de rentabilité ne permet de pas de le concevoir aussi bien au niveau de l’écologie, de la solidarité et de la fraternité. Penser le « monde de demain », avec les anciens systèmes et les anciennes méthodes, nous condamne certainement à vivre de nouvelles « affaires chlordécone » dans l’avenir.
Depuis quelques années, des articles de presse, des manifestations alimentées par des épisodes judiciaires chaotiques, des documentaires et des travaux parlementaires nous alertent sur les impacts de l’utilisation de la chlordécone dans les bananeraies des Antilles. Considéré par certains comme émanant « d’une logique coloniale et volontaire de la part de l’État pour, dit-on, assassiner les populations antillaises » et par d’autres comme étant un « accident de parcours », ce scandale écologique et sanitaire n’a pas fini de défrayer la chronique.
Il est dit que la justice est aveugle, dans ce drame judiciaire elle aura été aveugle et inhumaine. Il faut maintenant espérer que ce dernier épisode ne vienne pas embraser socialement et politiquement les Antilles.
La Gauche Républicaine et Socialiste soutient les familles des victimes, les associations martiniquaises et guadeloupéennes qui avaient saisi la justice en 2006, les élus qui n’ont eu de cesse d’alerter l’État sur les conséquences d’un non-lieu ainsi que les populations encore concernées aujourd’hui par cette pollution à long terme qui vivent clairement un déni de justice et un mépris d’État.
François Morland
1 80 % de la biodiversité terrestre.