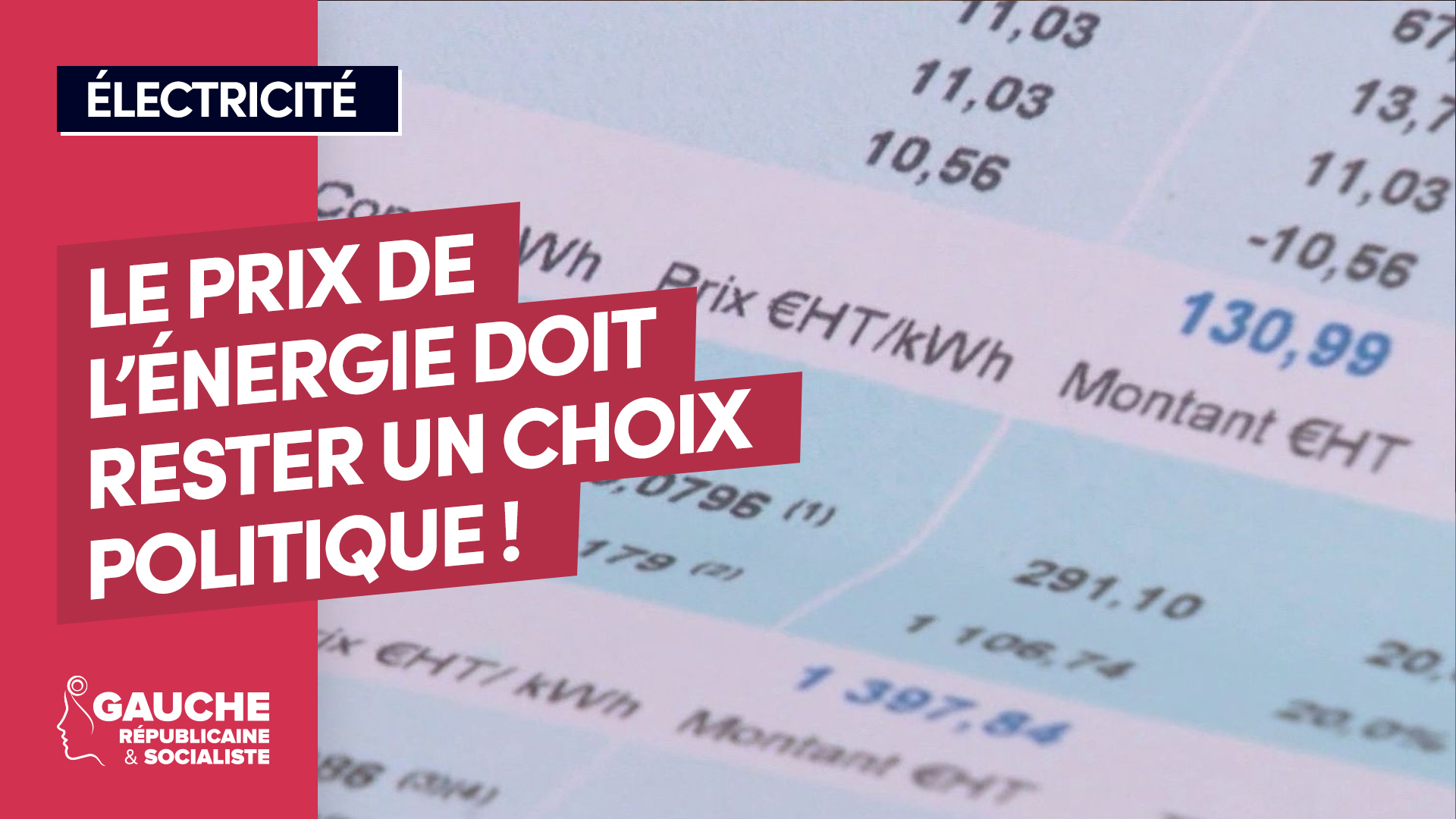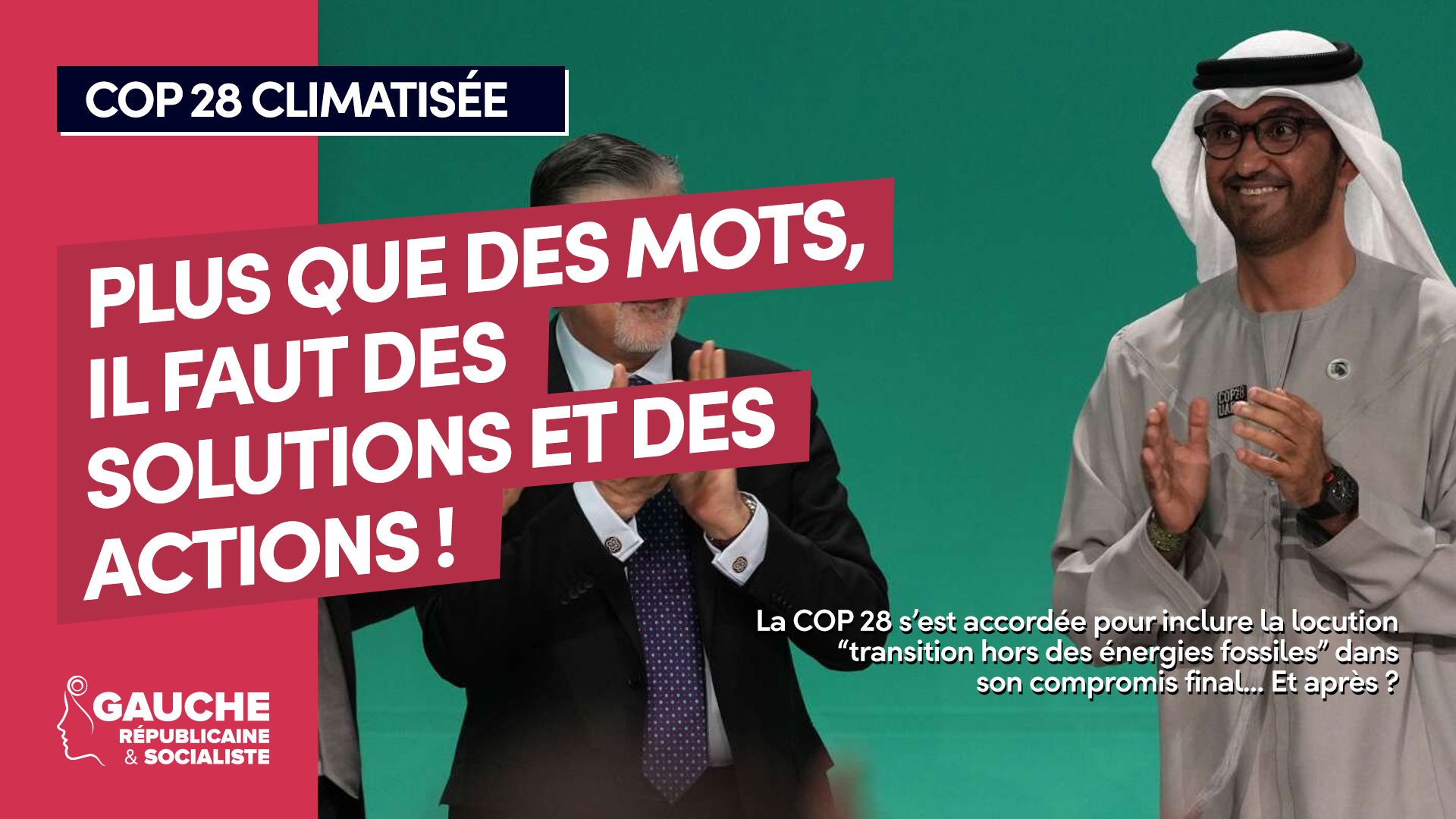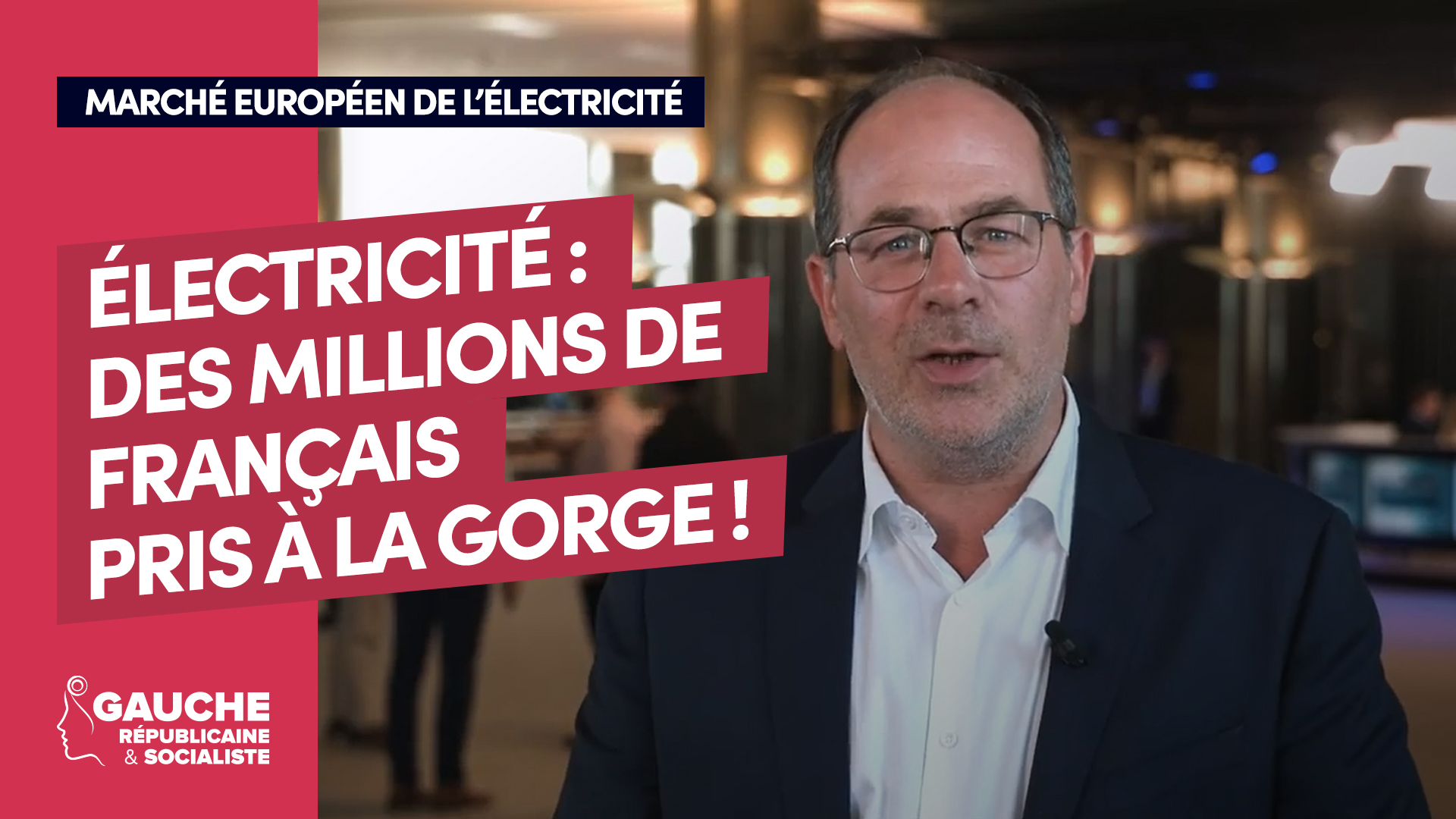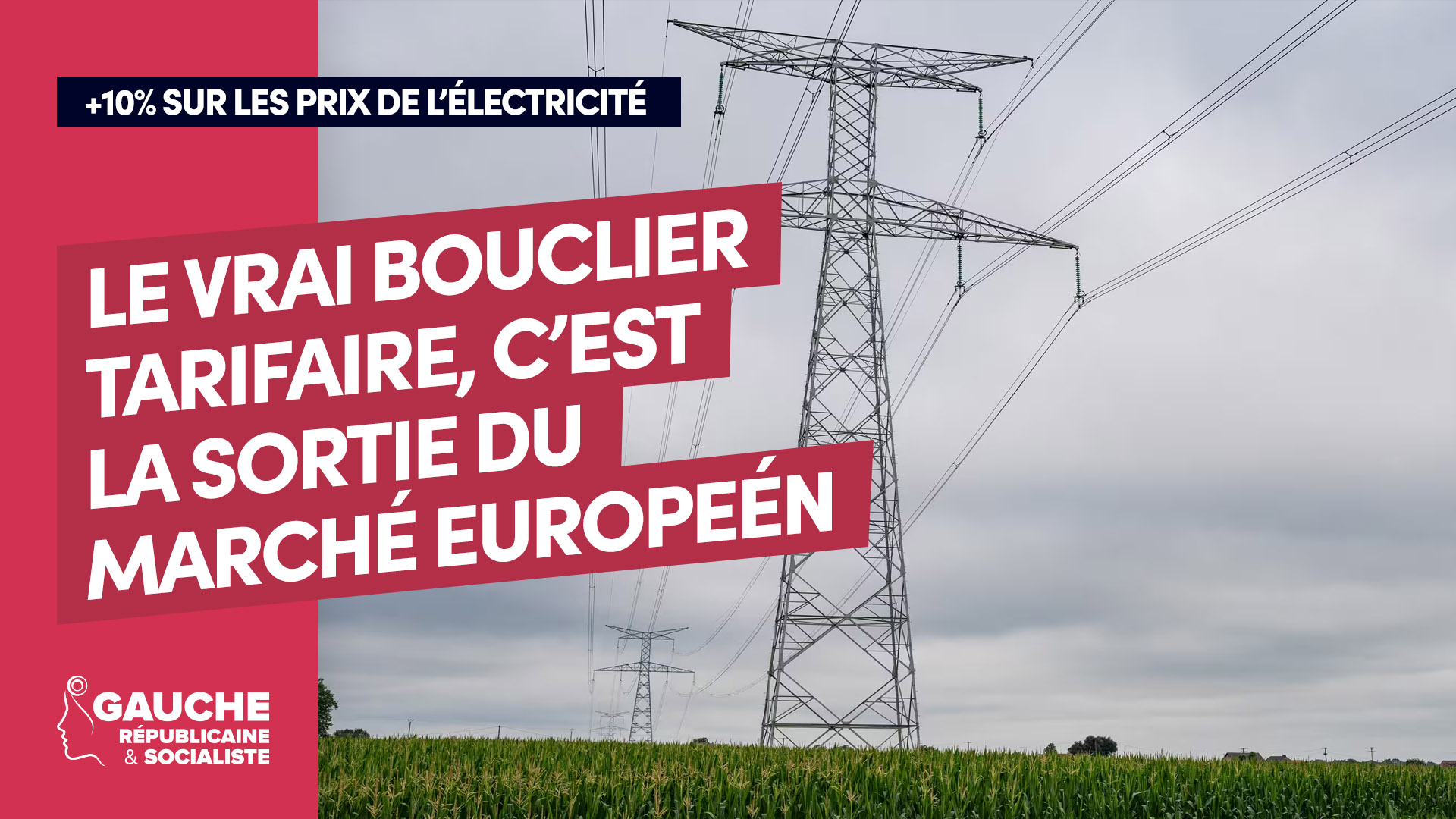C’est la nouvelle année, le temps des « bonnes résolutions » et le gouvernement vient donc de découvrir que les boulangeries françaises étaient au bord de l’asphyxie. Pourtant, depuis plusieurs semaines et même plusieurs mois, il n’était pas bien compliqué de s’en rendre compte pour qui va lui-même acheter son « pain quotidien » : les prix flambaient (au rythme de plusieurs augmentations pour un même produit en quelques mois), certaines boutiques choisissaient de fermer leur devanture une journée supplémentaire par semaine quand d’autres mettaient tout simplement la clef sous la porte… après les « déserts médicaux », les pénuries de médicaments, nous voici à l’orée de créer des « déserts boulangers ».
Le prix du pain est rentré dans l’imaginaire des Français comme ce qui a déclenché la Révolution (la grande et aussi les suivantes) – et on se souvient du slogan du Front Populaire « Pain, Paix, Liberté » –, tous les exécutifs sont conscients que ce sujet est à la fois symbolique et terriblement concret : le pain doit rester accessible, et pas trop cher. Quand la baguette ne coûte plus 1€, mais 1,10€ ou 1,20€, les Français le voient tout de suite ; souvent la boulangerie est le dernier commerce ouvert dans un village, sa disparition provoque automatiquement un sentiment d’abandon, sentiment d’abandon (et perte de pouvoir d’achat) qui voici un peu moins de 5 ans avait nourri le mouvement des « Gilets Jaunes ».
Panique gouvernementale
Voici pourquoi en catastrophe, Bruno Le Maire a mis en scène mardi 3 janvier 2023 sa mobilisation au secours des artisans boulangers (il aura donc fallu attendre la rentrée scolaire), dans un point presse qui a suivi un échange avec les représentants du secteur de la boulangerie. Les 33 000 artisans auront donc l’immense plaisir de recevoir « courrier personnalisé » pour « leur préciser les aides auxquelles ils ont droit ».
Rassurez-vous d’autres mesures suivent… Les boulangers pourront « demander le report du paiement de leurs impôts et cotisations sociales » (merci la sécurité sociale) ; ils auront droit à une remise sur l’électricité « pouvant aller jusqu’à 40% de remise sur leur facture » ; ils pourront enfin résilier leurs contrats d’énergie sans frais, lorsque l’évolution des prix pratiqués sera « prohibitive » – les experts comptables des artisans concernés devront faire preuve de talent et de subtilité pour définir le niveau à partir duquel cette évolution sera « prohibitive » (on ne sait toujours pas s’il y aura un décret pour encadrer la mesure). Dominique Anract, le président de la Confédération Nationale de la Boulangerie-Pâtisserie Française, qui avait participé à la réunion du matin s’est évidemment réjoui de ces nouvelles mesures, mais il lui fallait forcément nuancer : « pour une facture (d’énergie) qui va être multipliée par dix ou douze, rien ne sera suffisant »… c’est mieux que si c’était pire, donc.
Nous avons également eu droit à une nouvelle saison de #BrunoDemande : « Aujourd’hui, je le dis clairement : les fournisseurs n’aident pas suffisamment les boulangers et les PME » avant de rencontrer les « énergéticiens » dont Engie, EDF ou TotalEnergies. Il leur « demande » de « faire plus, de faire mieux, et de le faire tout de suite ». Alors même que début octobre 2022, ils ont signé une charte les engageant à protéger les entreprises de la hausse des pris de l’énergie, « un certain nombre de fournisseurs ne respectent absolument pas les engagements qu’ils ont pris », selon l’aveu du ministre de l’économie lui-même. S’ils ne « corrigent » pas le tir, Bruno promet de prendre « les mesures nécessaires pour faire respecter ces engagements et nous assurer que les fournisseurs jouent aussi le jeu » : « On peut toujours prélever davantage sur les fournisseurs d’énergie que ce que nous faisons aujourd’hui ». Dans le budget pour 2023, le gouvernement a mis en place un mécanisme qui doit lui permettre de collecter une partie des bénéfices des énergéticiens et lui rapporter, selon ses estimations, 11 milliards d’euros. Pourquoi ne pas agir maintenant alors que les défaillances sont ouvertement constatés ? Sans doute pour la même raison que les super-profits d’un certain nombre d’entre eux ne sont pas taxés, car ils n’existeraient pas.
Enfin, « dans chaque département, dans chaque préfecture, un point d’accueil des boulangers, avec des équipes dédiées, qui non seulement accueilleront tous les boulangers qui ont des questions et qui se demandent comment bénéficier des aides mais qui viendront aussi à la rencontre des boulangers » a souhaité préciser le même jour sur France Info, la première ministre Élisabeth Borne. Sauf que son ministre déplorait quelques minutes plus tard « nous avons à peine une cinquantaine de PME par jour seulement, je ne parle même pas des boulangers, qui viennent solliciter une aide à laquelle ils ont droit » : dans des préfectures et sous préfectures qui ne disposent déjà pas des moyens nécessaires pour effectuer correctement leurs missions habituelles, on doute que les boulangers se précipitent, alors qu’ils se plaignent déjà du caractère ubuesque des procédures à respecter pour obtenir ces aides – une dépense d’« énergie supérieure aux quelques centaines d’euros obtenues en bout de course » (sans jeu de mots).
Concours Lépine du faux-nez politique
Les boulangers vont-ils marcher sur Paris ? Certains en rêvent. Le 23 janvier, un Collectif pour la survie de la boulangerie et de l’artisanat appelle à manifester dans la capitale. Un autre collectif, La boulangerie à poil, va participer. Ces professionnels invitent d’autres artisans à les rejoindre et accusent l’État de ne pas les soutenir suffisamment. Ils affirment qu’ils veulent « changer le cours de l’histoire », rien de moins. On sent la reprise des codes du mouvement des « Gilets Jaunes » que nous évoquions plus haut.
Or, Frédéric Roy, le boulanger niçois qui a créé le premier de ces collectifs, est ouvertement engagé en politique. Dans ses interviews, il ne se contente pas de montrer ses factures. Il a tout un discours sur l’échec de l’Europe dans le domaine de l’énergie, et sur la souveraineté française qu’il faudrait retrouver. Qui le soutient ? Localement, Eric Ciotti, le député des Alpes-Maritimes, qui est aussi… président de LR. Il est particulièrement savoureux de voir LR – qui a accompagné toutes les décisions néolibérales et technocratiques décidées par le Conseil et la Commission européennes (donc le gouvernement français) – se révolter aujourd’hui… si quelques-uns peuvent parfois (difficilement) se prévaloir d’une lointaine filiation gaulliste ou séguiniste, pour la plupart on se vautre dans la caricature.
La palme revient sans doute à Valérie Boyer, sénatrice LR des Bouches-du-Rhône qui fut députée pour le même camp de 2007 à 2020, qui citant Loïk Le Floch-Prigent – « Le fait de produire de l’énergie d’origine nucléaire à 40 €, de la vendre à 42, et ensuite de la racheter le 21 juillet à 397 € devrait faire s’interroger tous les Français » – conclue par « Le fiasco énergétique de Hollande-Macron » : pour quelqu’un qui a voté en 2010 la loi NOME (qui introduit le processus aboutissant à l’impasse actuelle) à la demande du président Nicolas Sarkozy, c’est assez gonflé… Or la flambée des prix de l’énergie qui étrangle les boulangers, les TPE et plus généralement les Français, trouve aussi et d’abord son origine ici.
Démondialisation et marché européen
Les boulangeries avaient déjà subi une poussée de fièvre sur les prix fin 2021-début 2022 à cause de l’augmentation des prix du blé. On avait même vu dans certaines boutiques s’afficher des graphiques explicatifs pour justifier une première augmentation de 10 % de la « baguette tradition ». La guerre en Ukraine – qui a évidemment aggravé le phénomène – ne l’explique pourtant pas ou pas totalement. Depuis plus de 20 ans, le blé est une « matière première » hautement spéculative… Or aujourd’hui, si un producteur français voulait vendre à des prix plus accessibles que les cours actuels du marché, il ne pourrait pas car ce marché justement est mondialisé : tout est négocié à … Chicago. La construction d’un marché international régulé des céréales n’est évidemment pas à remettre en cause – c’est un des acquis des grands objectifs de régulation de la communauté internationale construite après la seconde guerre mondiale –, mais justement la « régulation » n’existe plus ou peu car la réglementation a sauté ligne par ligne avec le processus de libéralisation des marchés engagé depuis les années 1990. La « mondialisation heureuse » des néolibéraux aboutit au dysfonctionnement total du marché… Mais là, l’exécutif français reste coi, au niveau international comme au niveau européen.
L’échelle européenne, parlons en justement… car, en pratique, face à la crise, le gouvernement répond avec des aides ciblées en craignant la contagion des revendications. La peur n’ayant jamais écarté le risque, déjà, d’autres professionnels réclament, eux aussi, des aides supplémentaires. Les restaurateurs expliquent qu’ils ont du mal, comme les boulangers, à payer leur facture. Le gouvernement macroniste craint donc d’avoir ouvert la boîte de Pandore, alors que, depuis quelques mois, il essaie de diminuer son soutien à l’économie hérité de la crise sanitaire. Officiellement, la politique du « quoi qu’il en coûte » est derrière nous – l’État n’en aurait plus les moyens au moment où les taux d’intérêts nominaux remontent. Comment soutenir alors ceux qui ont des problèmes, sans faire chaque jour de nouveaux chèques ?
La solution est systémique et c’est celle que le gouvernement et la haute fonction publique de Bercy – aveuglés par le foi néolibérale – se refusent encore à mettre totalement en œuvre : c’est exiger (après avoir défendu l’inverse pendant des décennies) la fin du « marché » européen de l’énergie. La sortie du traité de la charte de l’énergie ne saurait satisfaire les Français avides de solutions concrètes. Pourquoi proposer au TPE et aux artisans de revenir temporairement aux tarifs réglementés (la gauche voudrait y adjoindre les collectivités), quand on sait que c’est le système actuel qui dysfonctionne en soi ?
Nous avons longuement écrit sur le sujet et vous pourrez vous référez à nos articles… l’idée fait son chemin pourtant, et il est un moment où personne ne pourra encore la différer : il fallait écouter le journaliste Jean-Sébastien Ferjou, le mardi 3 janvier au soir dans l’émission Les informés de France Info, expliquer que, tout en se revendiquant libéral et affirmant « croire au marché », lorsqu’il n’existe qu’un seul producteur – EDF en l’occurrence – il n’y a pas de marché et que les dispositifs mis en place par les institutions européennes pour en créer un artificiellement étaient tout simplement absurdes.
Espérons que l’inéluctable ne soit donc pas mis en œuvre trop tard.
Frédéric Faravel