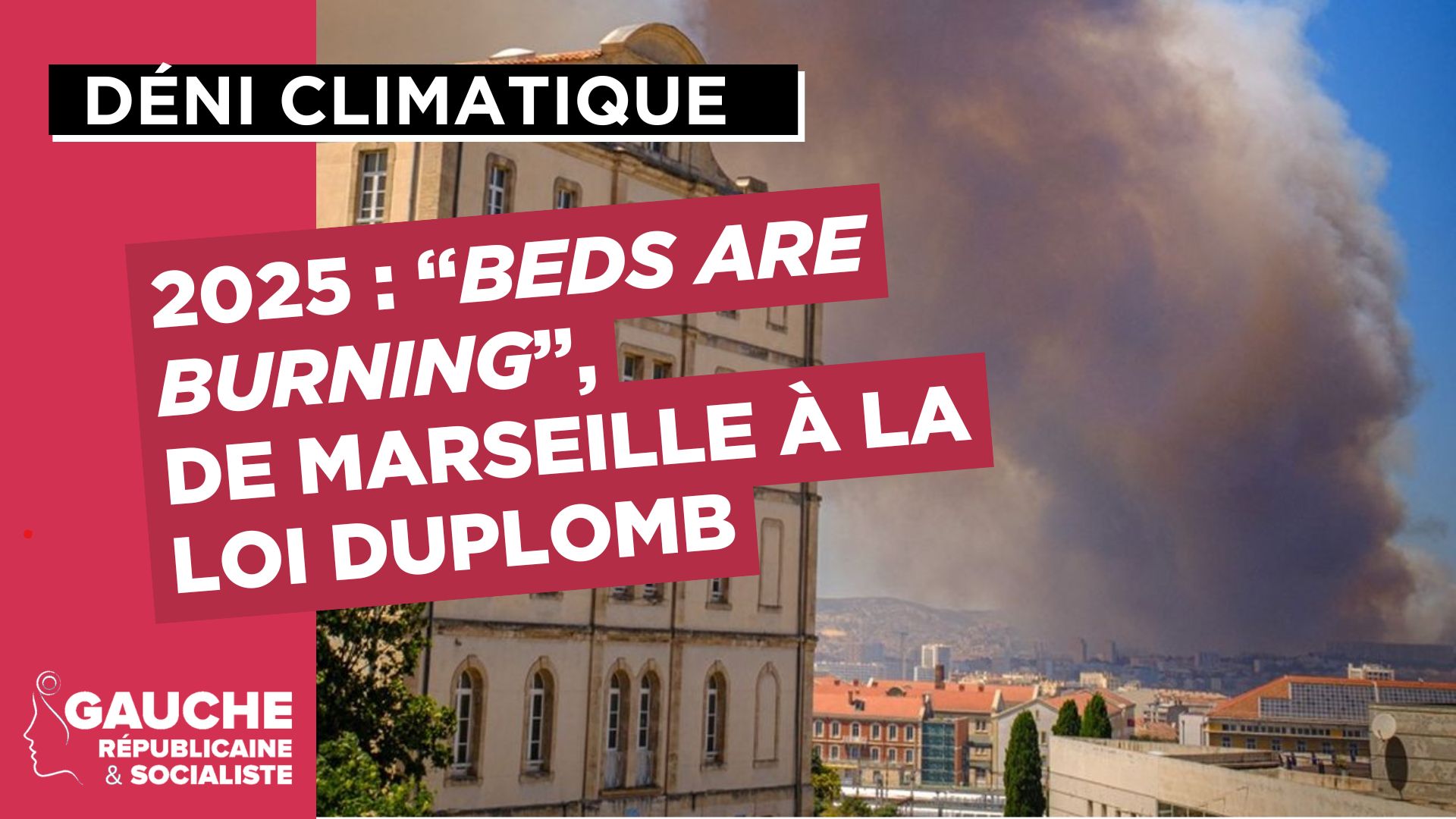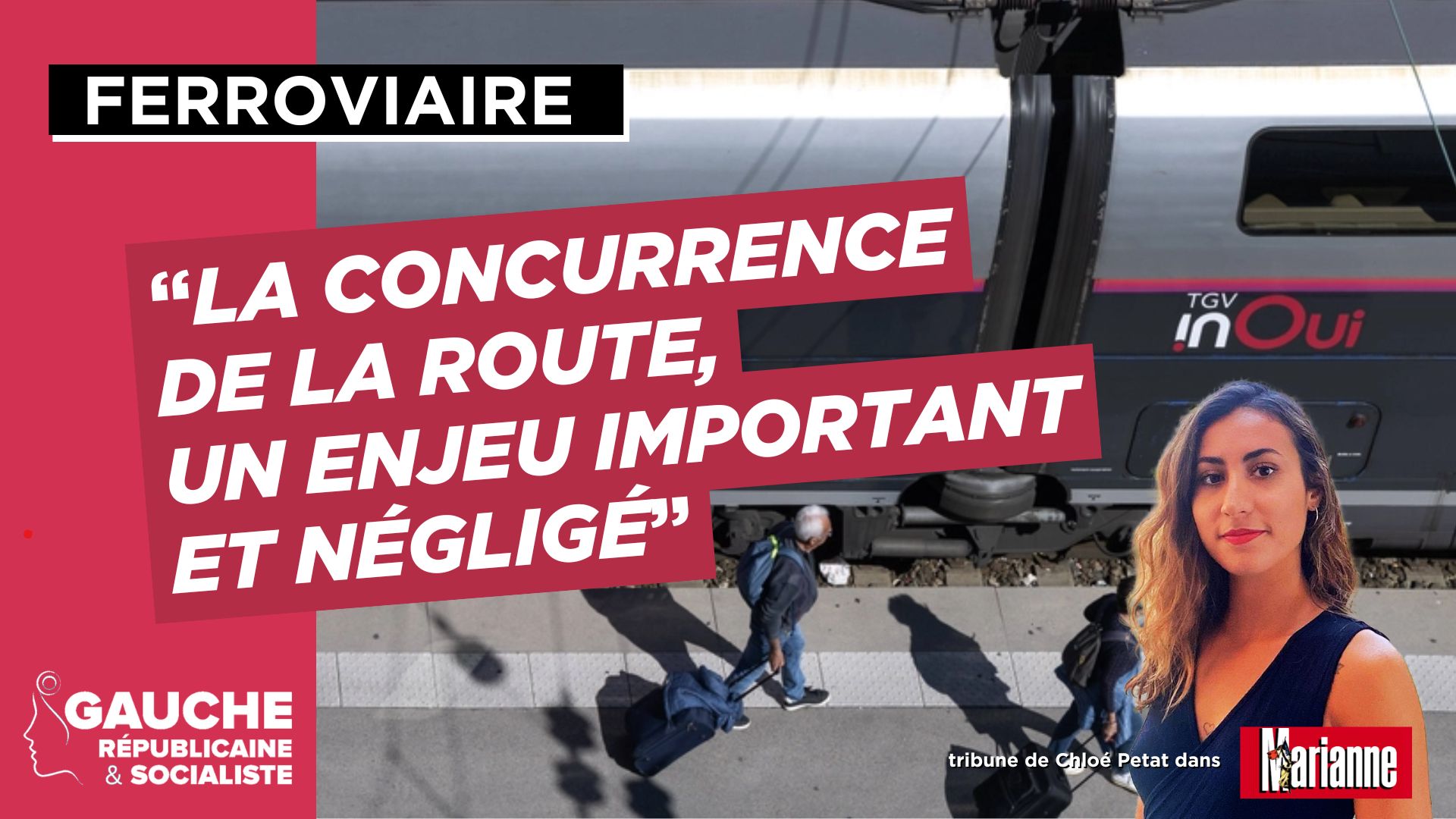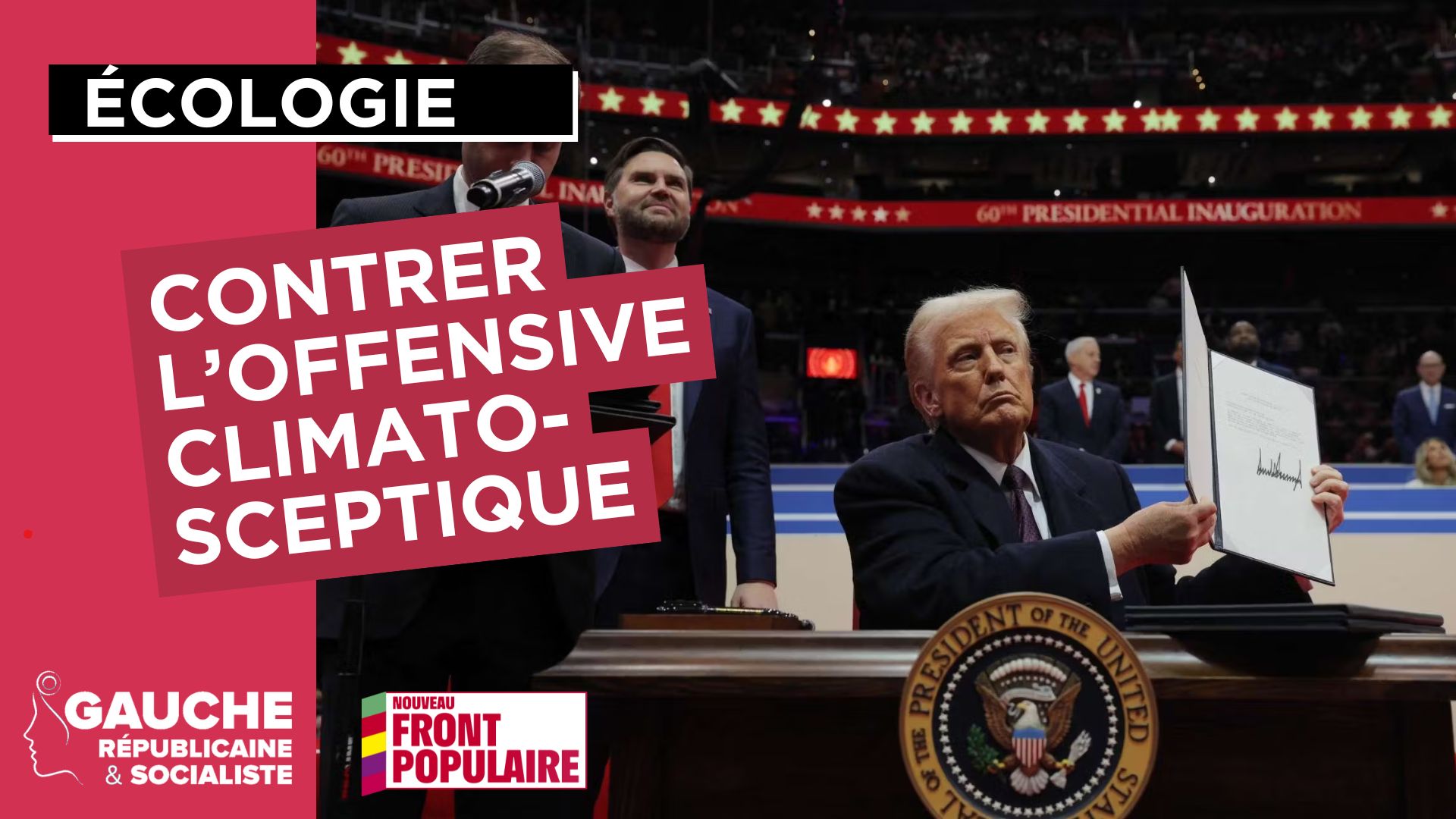Après plusieurs mois de recul, il est utile aujourd’hui de revenir un incident intervenu en avril 2025 mais sans précédent depuis plusieurs décennies en Europe, le « black-out » électrique qui avait plongé la quasi-totalité de la péninsule ibérique dans le noir pendant de longues heures. Non seulement cette immense panne de courant généralisée fut un événement dont les Européens n’avaient plus l’habitude, mais elle fut également marquante pour avoir eu des conséquences en série, notamment une paralysie quasi complète des transports et des activités.
La faute en avait été imputée sur le coup (drame de la stupidité réactive de l’information en continue) par beaucoup aux énergies renouvelables.
Depuis, deux rapports officiels ont rendu des conclusions partielles sur cette panne gigantesque : celui des autorités espagnoles, puis celui de l’ENTSO-E le réseau européen des opérateurs de réseaux de transport d’électricité, qui permettent d’y voir plus clair sur le déroulement de ce black-out et de savoir milliseconde par milliseconde comment s’est déroulé l’effondrement en cascade du réseau ibérique.
Reste un problème non résolu, car on n’a pas encore identifié la ou les causes qui en sont à l’origine.
Rappel des faits
Ce qui a clairement été établi, c’est que, plusieurs heures avant l’écran noir constaté à 12h23 le 28 avril dernier, le réseau espagnol a commencé à montrer des oscillations de tension anormale, d’abord dans les marges acceptables entre 10h30 et midi, qui ont pu être amorties avec des procédures standards. Mais ces oscillations sont devenues de plus en plus importantes, autour de 12h19. À partir de là, plusieurs équipements de production électrique ont commencé à se déconnecter de manière précoce du réseau pour se protéger, déclenchant une plus grande amplifications des oscillations hors des niveaux de tension acceptable, cette fois-ci, jusqu’à culminer à 12h32.
À ce moment, un grand nombre de centrales se déconnectent, des pertes de production et des hausses de tension se produisent que le réseau n’arrive plus à gérer, au point de ne plus pouvoir maintenir sa fréquence nominale à 50 Hz. À partir de là, tout s’effondre. La France et le Maroc coupe l’interconnexion de leurs réseaux et c’est le black-out à 12h33.
Très vite dans toute l’Europe, on a entendu, en France en particulier, des experts proches de l’industrie nucléaire expliquer que l’incident était imputables énergies renouvelables. En effet, à ce moment-là, en Espagne en particulier, les deux tiers du mix énergétique était assuré par du photovoltaïque ou de l’éolien. Or les rapports récents ont démontré que les centrales éoliennes et solaires avaient tenu plus longtemps que les centrales thermiques, qu’elle avait plutôt joué un rôle de stabilisateur du réseau au lieu d’accélérer sa chute.
Les innovations issues du renouvelable
Au regard de la façon dont le débat a été posé dans les médias fin avril, la question de l’intégration de ces renouvelables dans les réseaux électriques européens doit être traitée. Si la cascade de surtension dans le réseau ce jour-là n’a pas pu être enrayée, c’est sans doute en partie parce que les opérateurs réseaux en Espagne et au Portugal utilisent des procédures « à l’ancienne », qui ne tiennent pas compte des dernières évolutions basée sur un pilotage plus fin et intégré d’un des composants-clé des centrales photovoltaïques et éoliennes, les onduleurs.
Ces appareils représentent une révolution copernicienne dans le système électrique, avec énormément de fonctionnalités, autorisant une plus grande flexibilité, car ils permettent de transformer le courant continu produit par les énergies renouvelables en courant alternatif compatible avec le réseau, mais ils peuvent aussi être adaptés pour devenir le coeur même du réseau électrique. C’est qu’on appelle « l’électronique de puissance ». Or ces possibilités offertes par les onduleurs des énergies renouvelables ont été insuffisamment prises en compte par le réseau.
Les législations européennes n’autorisent toujours pas les gestionnaires de réseau à utiliser pleinement ces fonctionnalités. Les Espagnols en ont subi les frais à leurs dépens. Aussi presque immédiatement après le black-out, le réseau électrique espagnol a autorisé des énergies renouvelable à fournir ce qu’on appelle le réglage dynamique de la tension, donc à utiliser une fonctionnalité qui est native dans tous les onduleurs et qui est une aide au réseau. Voilà qui est très révélateur de la prise de conscience par les Espagnols des possibilités de « l’électronique de puissance », après le black-out.
La résilience par la complémentarité
Cette évolution semble démontrer que l’on peut réfléchir à une architecture plus subtile de nos réseaux électriques, en mettant les énergies renouvelables et leur potentiel de régulation au service de ceux-ci plutôt qu’à la marge. C’est tout l’enjeu, un des leçons qui seront tirées, ou non, de ce black-out ibérique du mois d’avril. Le rapport d’enquête final du gouvernement espagnol doit être rendu courant 2026.
Le « black out » de la péninsule ibérique rappelle que nous sommes, en France comme ailleurs, très dépendants à l’électricité : cette dépendance à notre système électrique va être croissante. À l’heure actuelle, environ un quart de nos besoins énergétiques est couvert par de l’électricité. Si l’on se projette au milieu du siècle, il faudra couvrir à peu près 60%, avec les véhicules électriques, les pompes à chaleur, les électrolyseurs, les data centers, etc. Il faut se préparer à ce monde, notamment en investissant dans les réseaux.
Les conclusions des premiers rapports espagnols et européens démontrent au demeurant qu’il n’est pas bon d’opposer les sources d’énergie électrique décarbonnées entre elles. Si nous voulons définitivement sortir de la société des hydrocarbures, il faudra penser l’articulation et la complémentarité entre nucléaire et énergies renouvelables, ces dernières pouvant apporter des atouts en termes de fonctionnalité qui compensent les risques liées à leur intermittence.
Frédéric Faravel