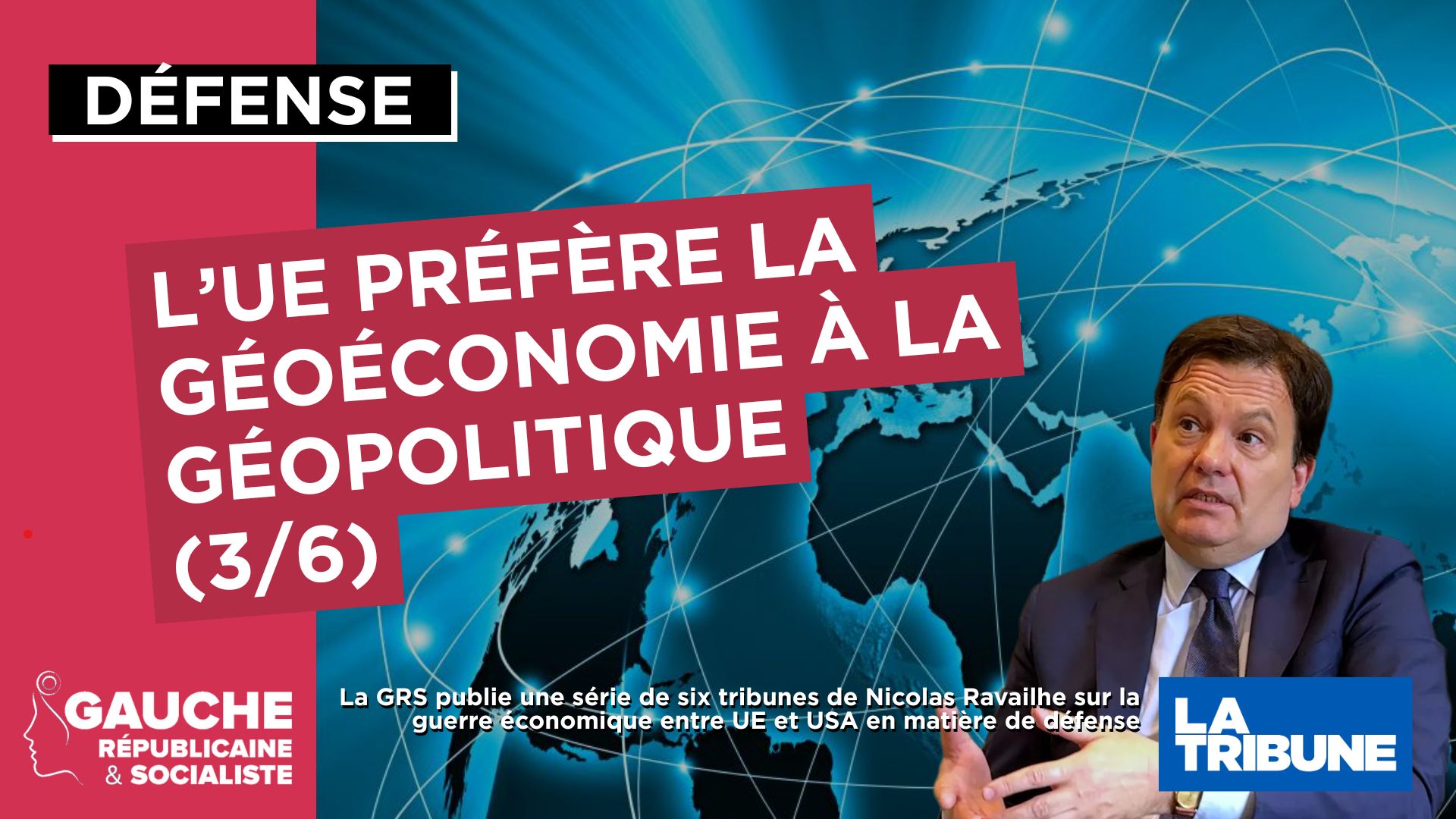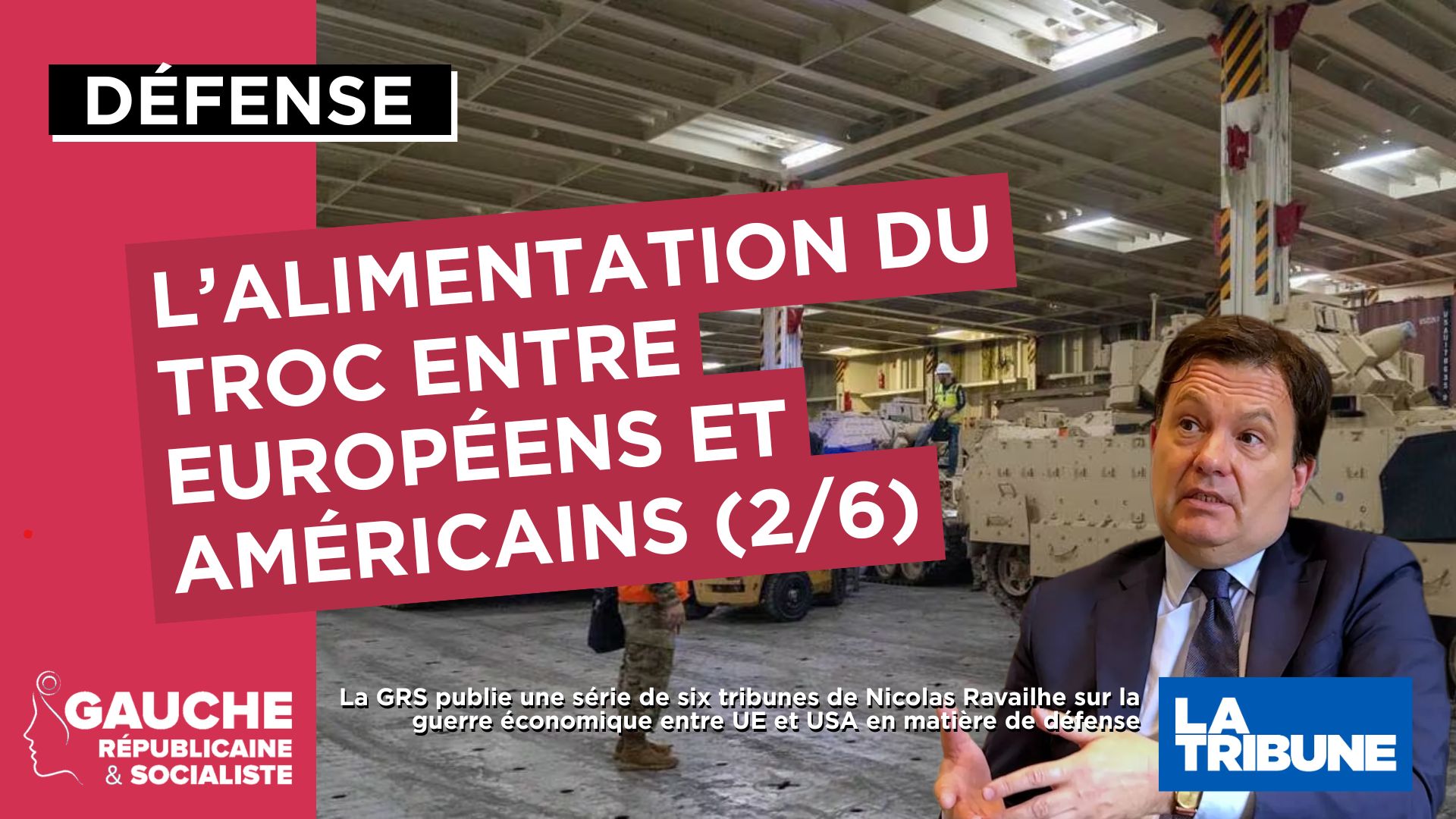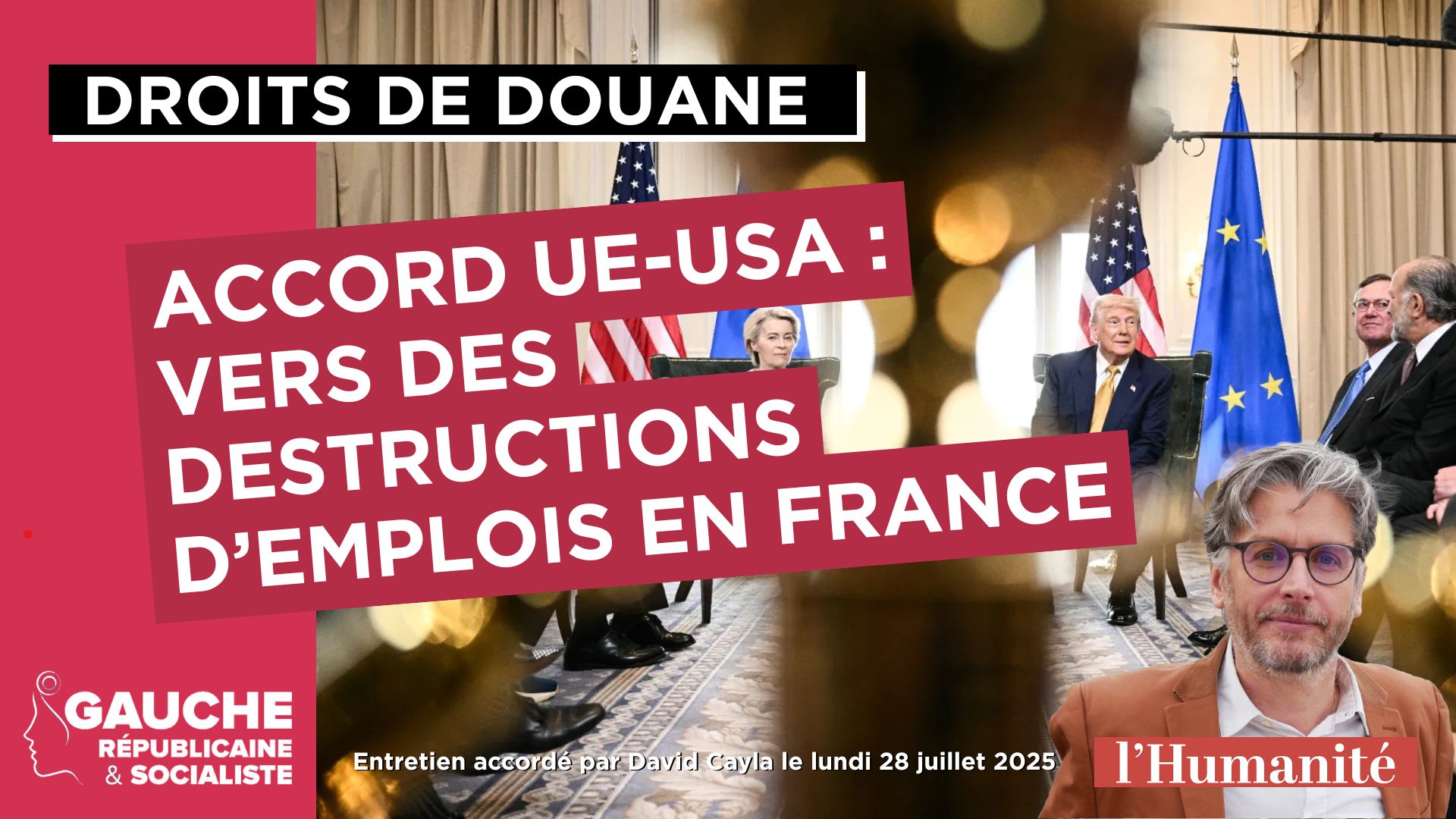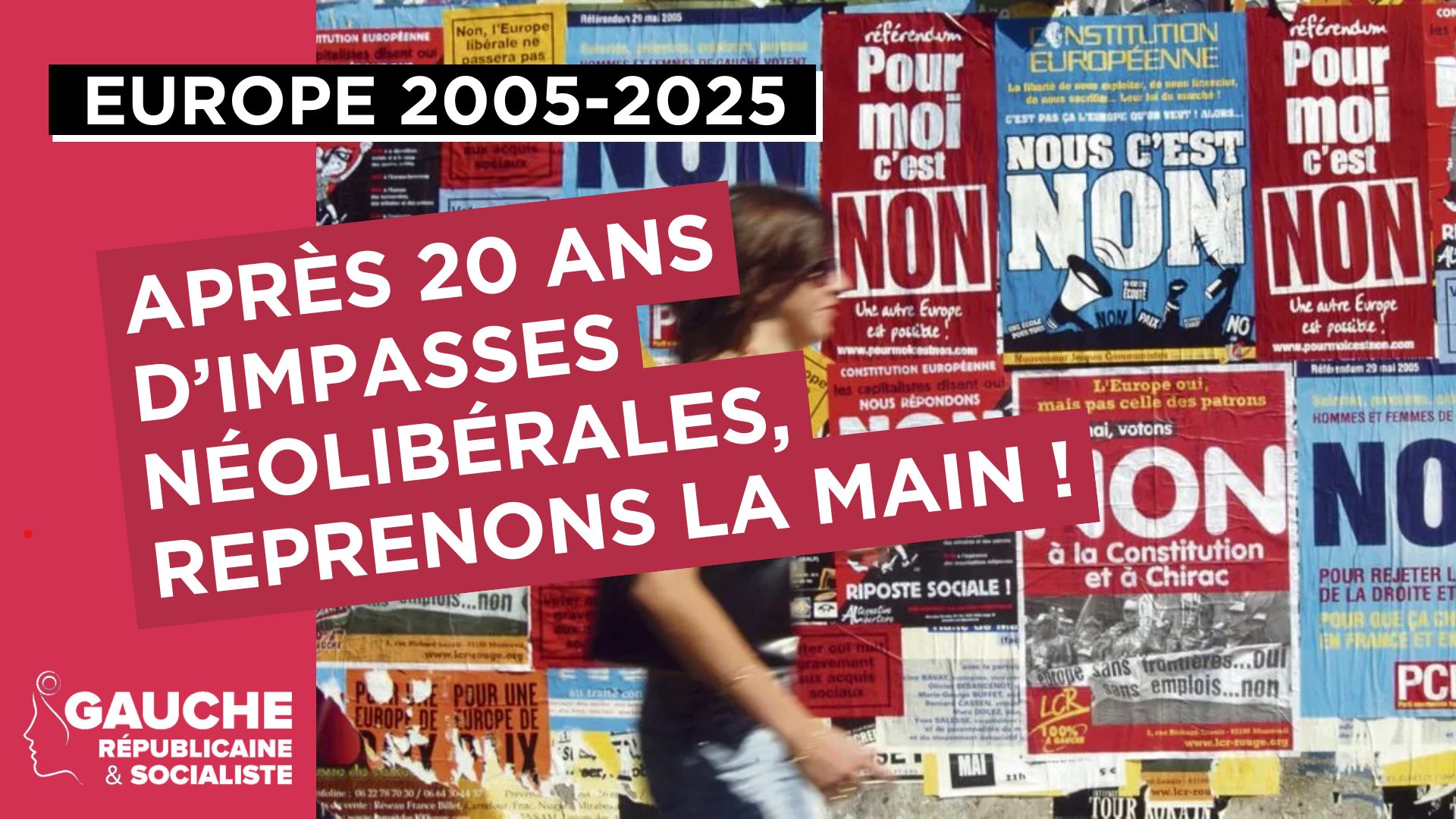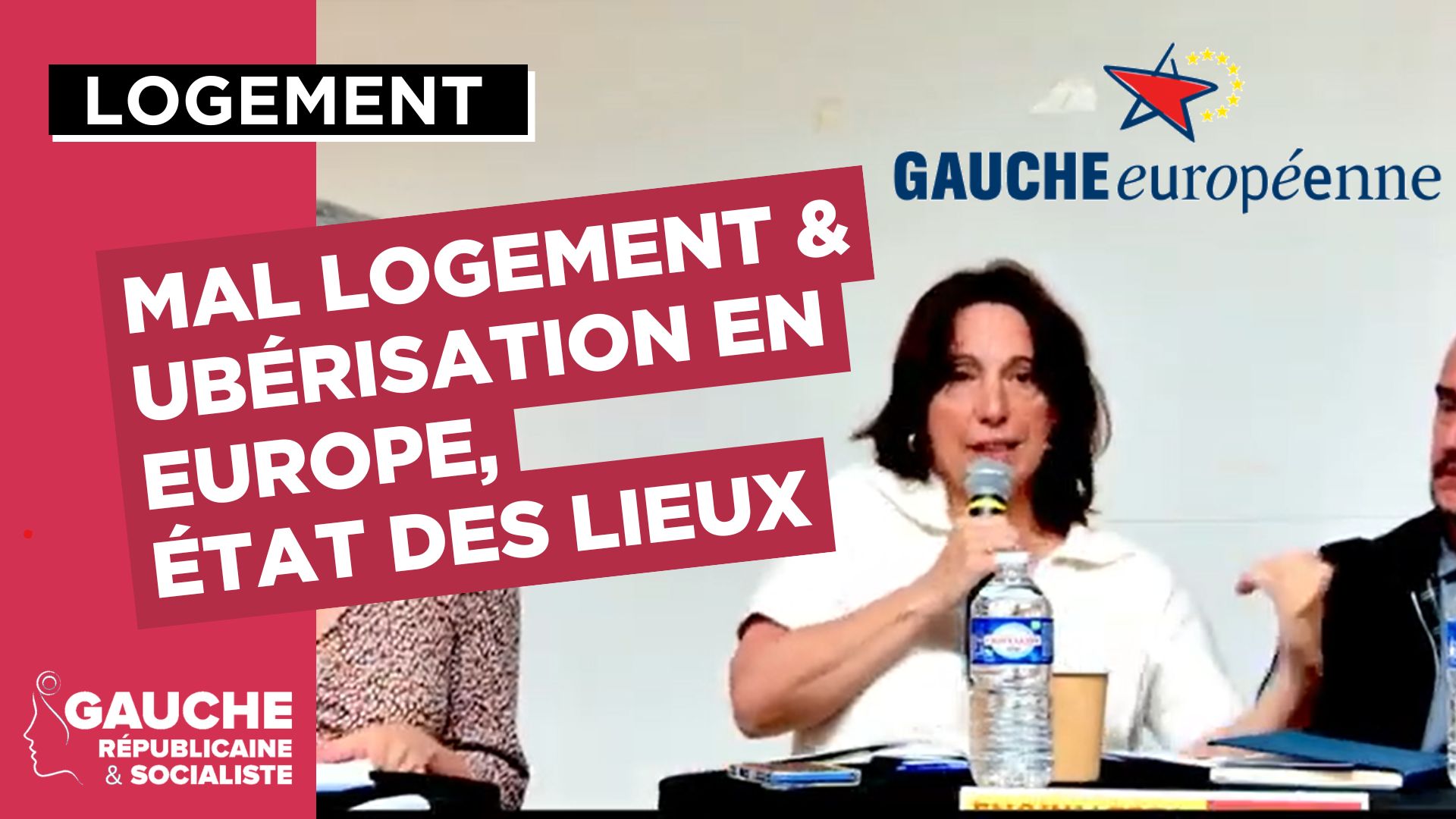Nicolas Ravailhe, professeur à l’École de guerre économique et avocat au barreau de Bruxelles (droit européen), propose une chronique sur la guerre économique entre les États-Unis et l’Europe dans le domaine de la défense en six volets. Ces articles ont été initialement publiés dans La Tribune.
Quatrième partie : la priorité de Berlin reste les excédents commerciaux, notamment aux États-Unis ; celle de Washington vise les ventes d’armes en Europe.
Nous assistons au début d’une relation en apparence conflictuelle avec le retour de Donald Trump mais, sans naïveté, les Européens ont toujours su que les États-Unis défendent leurs intérêts avant tout. Peut-on légitimement leur en vouloir quand tant d’États européens font de même ? Outre la phrase prêtée au Général de Gaulle à propos des États-Unis « qui n’iront pas mourir pour les beaux yeux d’une Hambourgeoise », la souveraineté des Européens en matière de défense est un sujet récurrent depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale.
Si, en France, gaullistes, communistes et centre gauche (Pierre Mendès France) ont été unis contre la droite modérée pour refuser la Communauté européenne de défense (CED), ce n’est pas par crainte de l’Allemagne ou par refus de l’Europe. En 1954, la mise sous tutelle des Européens par les Américains était redoutée avec la CED. Les enjeux n’ont pas changé. Toutefois, les rapports de force, les institutions européennes et les courants de pensée sont désormais bien différents en Europe.
Agacements de Washington vis-à-vis de Berlin
On s’offusque en Europe du style de Donald Trump, mais les États-Unis ont toujours été à l’unisson pour réagir face aux excédents européens en matière civile. Les démocrates américains n’étaient pas non plus inactifs. Ils ont d’ailleurs aussi bien réussi avec les achats d’armes américains massifs en Europe sous la présidence de Joe Biden. Depuis Barack Obama, relayé par Donald Trump sous son premier mandat, puis par Joe Biden, les États-Unis n’ont eu de cesse de dire aux Allemands que le contribuable américain n’avait pas à les protéger contre les Russes alors que l’absence de budget de la défense outre-Rhin permet d’investir davantage dans les productions civiles.
Ces investissements permettent aux entreprises allemandes d’être attractives et, ainsi, d’avoir des excédents commerciaux aux États-Unis. Une colère américaine renforcée par le fait que les Allemands allaient acheter du gaz pas cher aux Russes – pourtant une menace – afin d’être encore plus compétitifs par rapport aux industries américaines. Nous ne pouvons pas avoir la mémoire courte. Jusqu’au déclenchement de la guerre russo-ukrainienne, l’alliance économique avec la Russie était plutôt germano-russe que russo-américaine.
Les Allemands ont profité pendant des décennies de cette réalité. Quand il devient compliqué de commercer avec les Russes sans renoncer aux États-Unis, l’Allemagne va chercher de nouveaux alliés ailleurs, en appliquant les mêmes logiques. La Chine, l’Inde avec un projet d’accord de libre-échange total avec l’Union européenne (UE) presque finalisé, les ex-pays satellites de l’URSS et l’Amérique latine sont déjà très « ciblés ». D’ailleurs, les liens tissés entre des États européens, en particulier l’Allemagne, et la Chine irritent les États-Unis.
Allemagne : priorité aux excédents commerciaux
L’Allemagne en connait les risques et elle équilibre en permanence ses messages. La progression des exportations allemandes aux États-Unis, plus de 40 milliards d’euros d’excédents supplémentaires en quatre ans, demeure une de ses priorités. Cette pénétration allemande des marchés américains n’a pas pour seule explication une augmentation de la production en Allemagne et dans les pays satellites en Europe de l’Est. Les États-Unis ont parfaitement observé – via Eurostat – une augmentation en Allemagne d’importations depuis la Chine.
De nouveau, il convient de citer le Général de Gaulle, « les États n’ont pas d’amis, ils n’ont que des intérêts ». Il ne sert à rien d’adresser un réquisitoire en règle contre l’Allemagne et/ou les USA, d’autant que des alliances militaires bien négociées sont utiles et nécessaires. L’Allemagne ne remet pas ses modèles en cause. Elle cherche à se redéployer ailleurs via l’UE, vers par exemple le Mercosur ou le « Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership » (CPTPP), qualifié de mini OMC.
De même, rien ne paraît pouvoir arrêter les orientations américaines. Les États-Unis ne sont pas assez productifs et compétitifs. Le documentaire produit par les Obama, « American factory », en témoigne. Les États-Unis taxent en conséquence les biens entrant sur leur sol et ils utilisent leur puissance géopolitique pour exporter ce qu’ils fabriquent : des armes. Un troc s’opère : exportations d’armes en Europe contre importations civiles aux États-Unis. C’est si lucratif pour certains Européens que ceux-ci sont prêts à accepter sans broncher la sur-taxation de 10% des produits importés aux États-Unis sans répliquer.
Quid de la France ?
La France aurait pu s’entendre avec les États-Unis. Elle connaît la même réalité économique qu’eux avec des déficits commerciaux face à l’Allemagne, face à l’Italie, comme face à la quasi-totalité des pays européens. La première difficulté pour l’Hexagone est que ses entreprises souveraines sont souvent concurrentes des américaines, dans les secteurs où les États-Unis sont forts : défense, aéronautique, spatial… L’Allemagne va donc s’engouffrer dans cette brèche pour toujours finir par chercher à s’allier avec les États-Unis dans l’industrie de défense.
Rappelons-nous que le chancelier allemand Scholz (SPD) a déclaré « la France est notre allié le plus proche, les USA sont les plus importants ». Outre quelques dissensions et jalousies historiques probablement mal pansées, on doit comprendre que 92 milliards d’excédents commerciaux en 2024 sur les biens aux États-Unis pèsent davantage qu’environ 15 milliards d’euros d’excédents annuels en France. Puis, comme déjà évoqué, le droit européen protège l’Allemagne de représailles (taxes…) en France alors qu’il est inopérant aux États-Unis.
Défense : consensus politique en Allemagne
L’Allemagne connaît un consensus sur la guerre économique, même sans la nommer, depuis des années. Tous les partis politiques s’y rallient, y compris les écologistes et les sociaux-démocrates. Des crédits de la guerre votés même par le SPD « en 14 » en passant par le réarmement économique post 1945, l’Allemagne dirigée en coalition depuis des décennies n’a pas varié concernant son consensus : produire et importer pour vendre dans le monde entier.
Toutefois, les questions de défense y sont sensibles depuis l’après Seconde Guerre mondiale. Aucun des partis ne les a mises en avant. Ils ne souhaitaient pas réarmer. Une telle décision aurait exposé l’Allemagne à des logiques d’arbitrages géopolitiques qui auraient pu faire perdre des contrats civils et même militaires. L’Allemagne conçoit des chars pour les vendre, pas pour les utiliser. Des affirmations géopolitiques auraient pu exposer à des désaccords avec les États-Unis dans une registre où ceux-ci s’imposent depuis des décennies en qualité de « gendarme plus ou moins affirmé du monde ». Il est donc impératif d’éviter tout risque en l’espèce.
De plus, la gouvernance allemande est complexe à appréhender sur les sujets de défense. Le Bundestag a des prérogatives importantes et les accords y sont incertains. Cela pousse même des groupes allemands comme Rheinmetall à produire ailleurs, souvent en Europe de l’Est. Une stratégie d’éviction des risques politiques internes et des subventions européennes abondantes à l’Est et au Sud favorisent ces choix. En France, le pouvoir exécutif et ses structures comme le secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale (SGDSN) emportent les décisions. La gouvernance en matière de choix de défense est plus stable.
Une affirmation de l’Allemagne dans le contrôle de l’UE
Avant la réunification, les Allemands « câlinaient » la France. Edith Cresson, qui a connu en responsabilité les deux périodes, avant et après, décrit parfaitement cette évolution. Les Russes étaient aux portes de l’Allemagne de l’Ouest et la France avait un intérêt stratégique pour la RFA. En repoussant les frontières de l’Europe avec la Russie en Ukraine, la donne a complètement changé. Cependant, en Europe, nous ne sommes pas pris en « traîtres » par nos partenaires / concurrents. Nous avons parfaitement, notamment à l’École de guerre économique mais pas exclusivement, analysé les stratégies de l’Europe du Nord.
À titre d’exemple, il est loisible d’observer que les fonds européens en Europe de l’Est ont servi à des relais de croissance pour les entreprises allemandes. La conséquence directe est que les États d’Europe soutiennent souvent l’Allemagne dans les décisions européennes afin de conserver les activités économiques « investies » par les entreprises allemandes sur leur sol.
En Europe, les stratégies économiques offensives priment sur les défensives. Notre pays souffre de deux maux : une croyance dans une Europe qui n’est plus le fantasme espéré jusqu’au milieu des années 1990 et un défaut de formation et de travail sur ce que l’UE est réellement. L’UE est le nom du champ de bataille et elle définit des règles communes dans la guerre économique (marché intérieur et accords économiques avec les pays tiers). Il ne suffit pas de toujours vouloir avoir raison et d’en expliquer les motifs aux autres Européens, il faut vouloir gagner.
France : la réindustrialisation, clé de son autonomie
Pour peser en Europe, il faut des succès économiques. Un État qui s’appauvrit doit d’abord analyser ses échecs et se réorganiser. La France doit profiter de l’effort de défense pour se réindustrialiser et vite, pour produire et pour exporter. En matière d’intelligence économique, le secteur de la défense est une priorité. Souverain, notre pays a un avantage : la souveraineté comme « soft », « smart » et même « hard power », en proposant à des États d’acquérir nos technologies afin de ne pas dépendre des États-Unis ou d’autres pays, en particulier la Chine. La question centrale est donc celle des financements de la réindustrialisation et des choix effectués en tenant compte des cadres juridiques européens.
Nicolas Ravailhe
(à suivre)