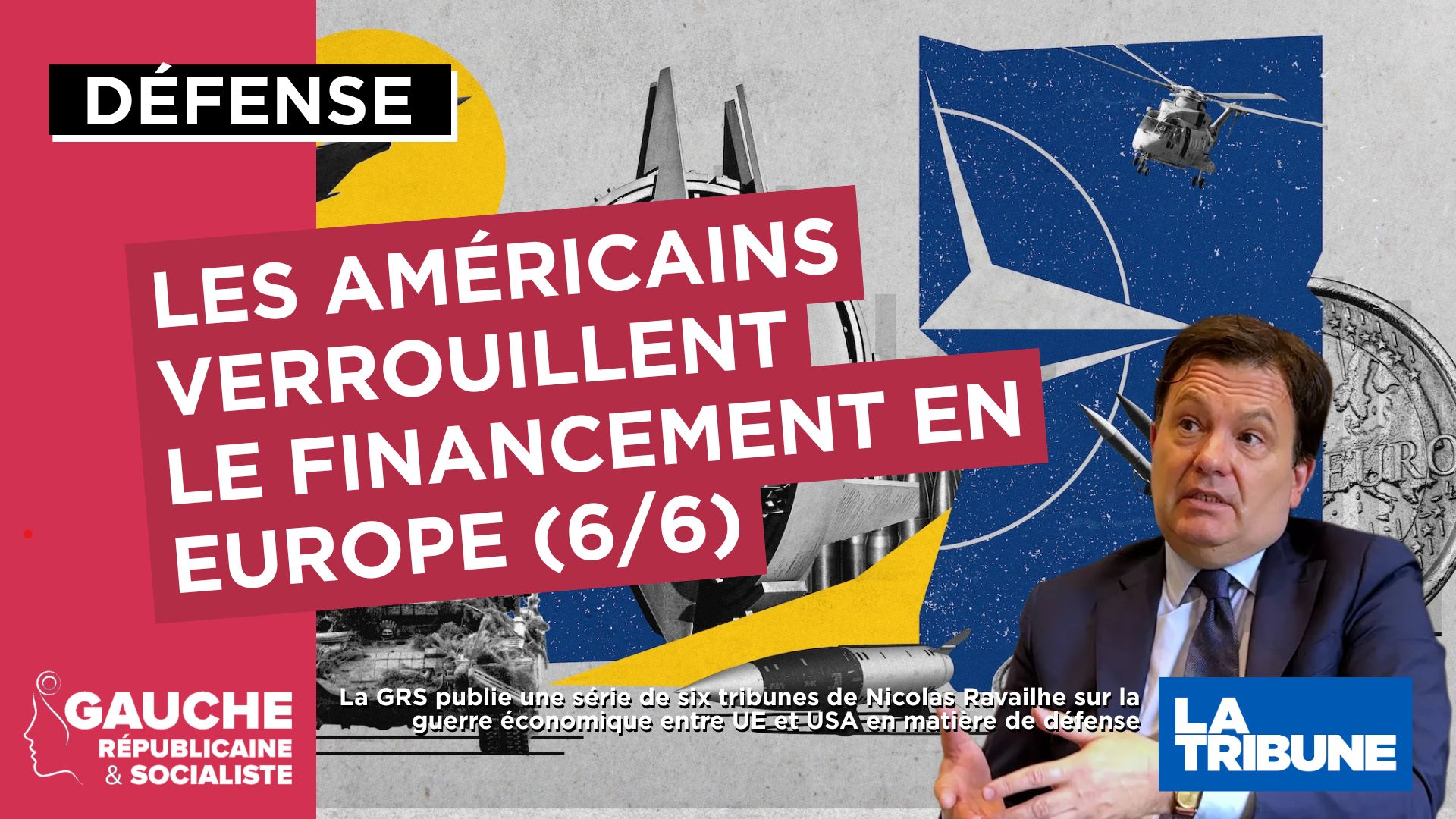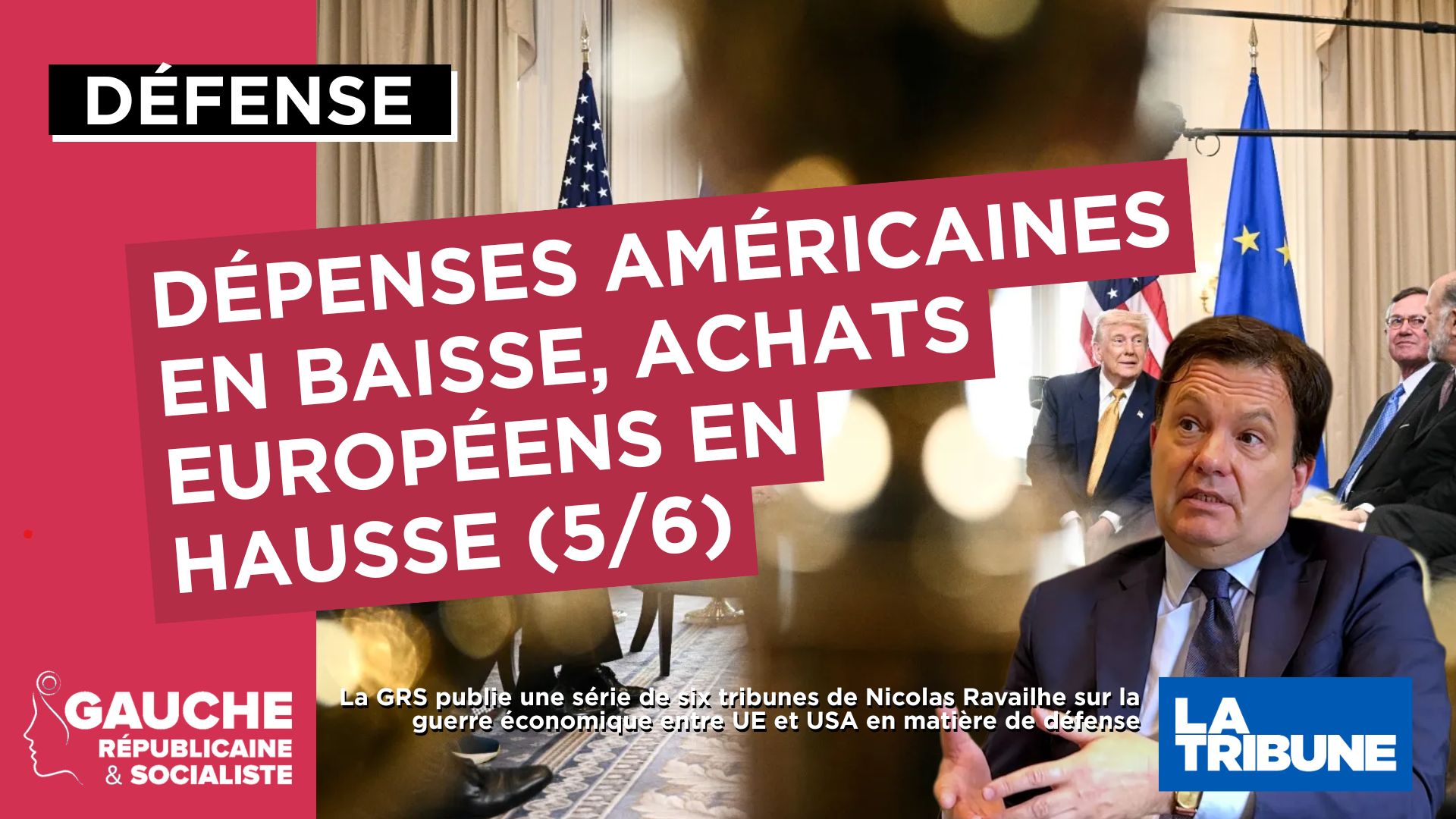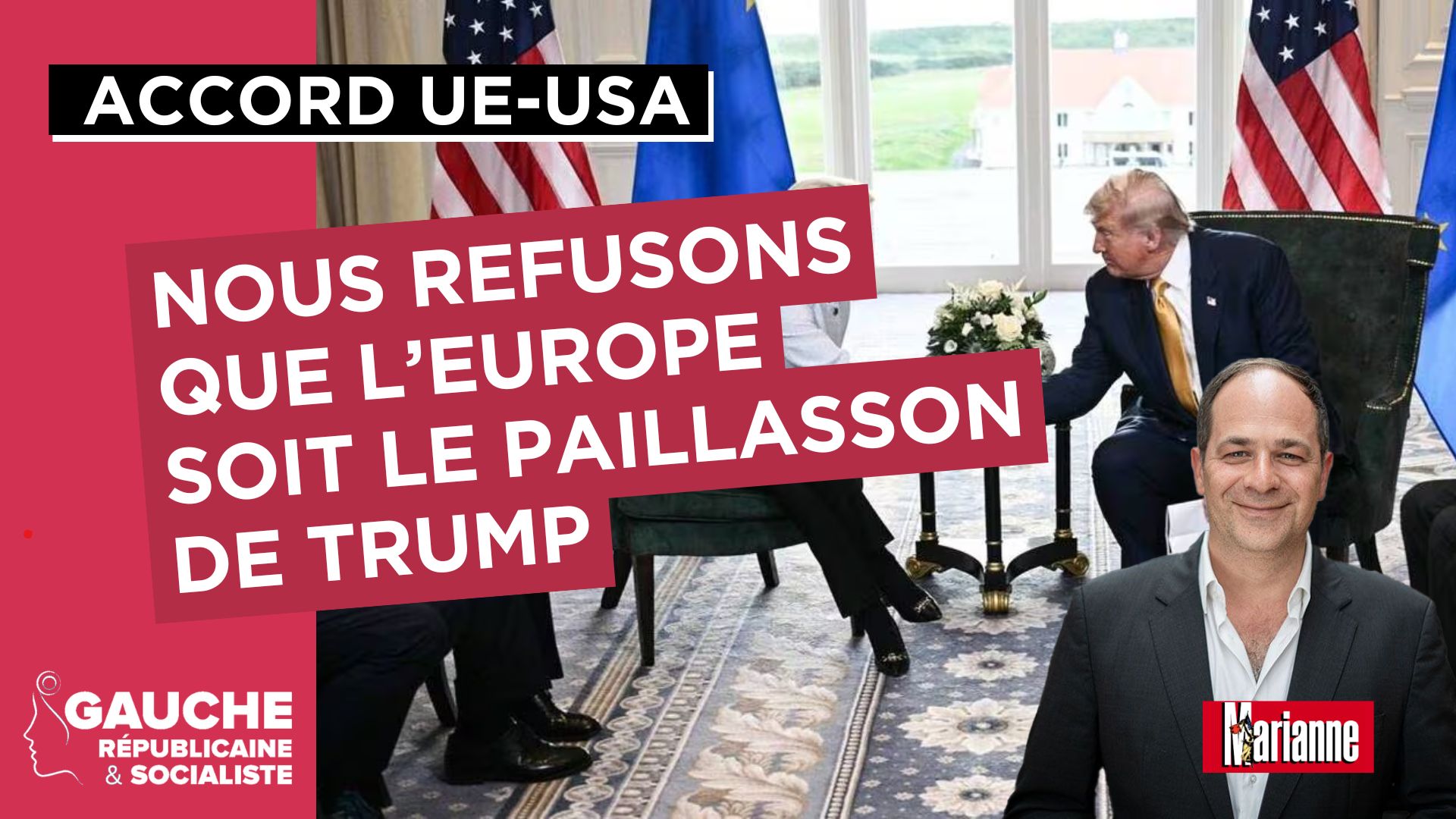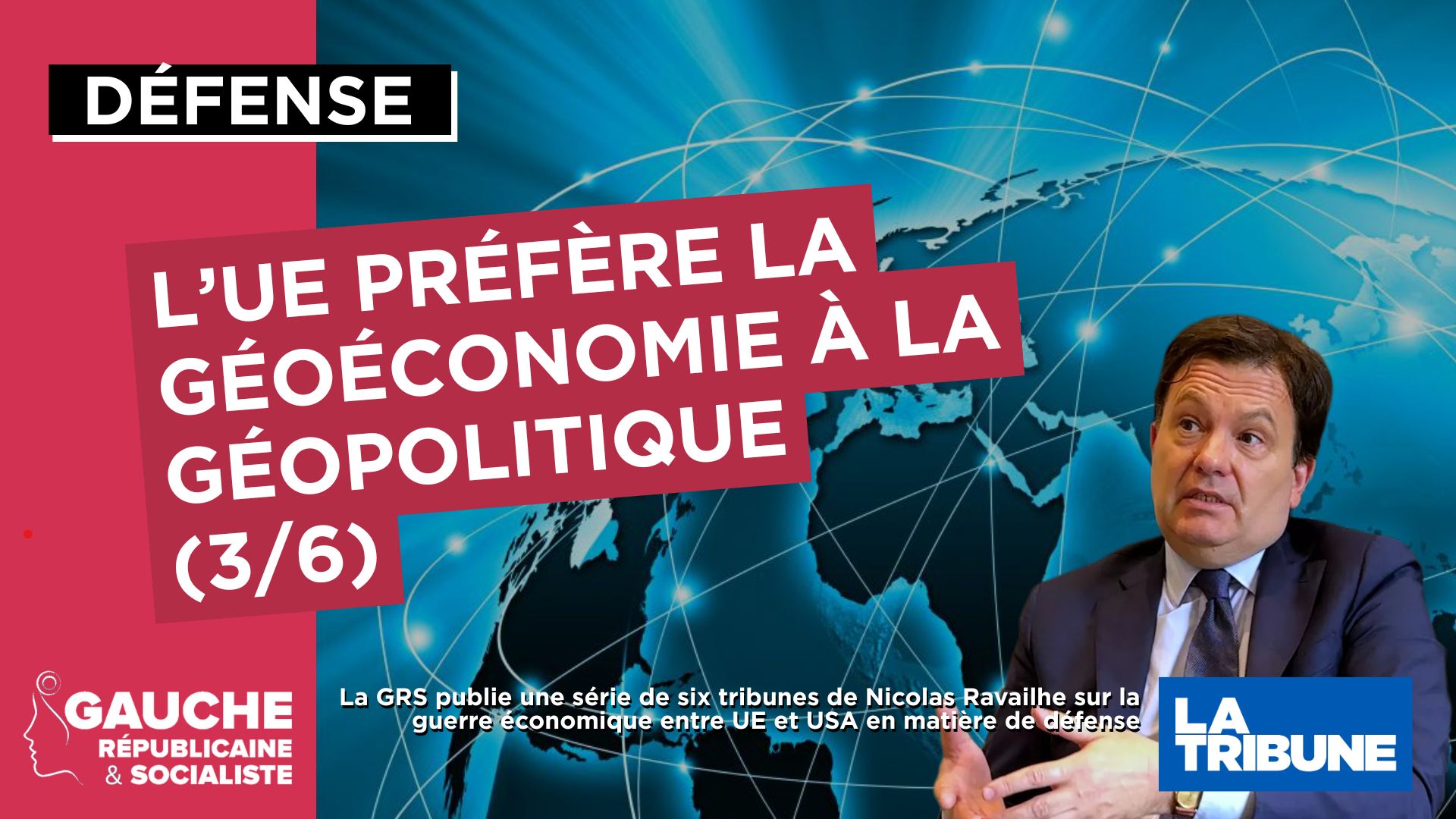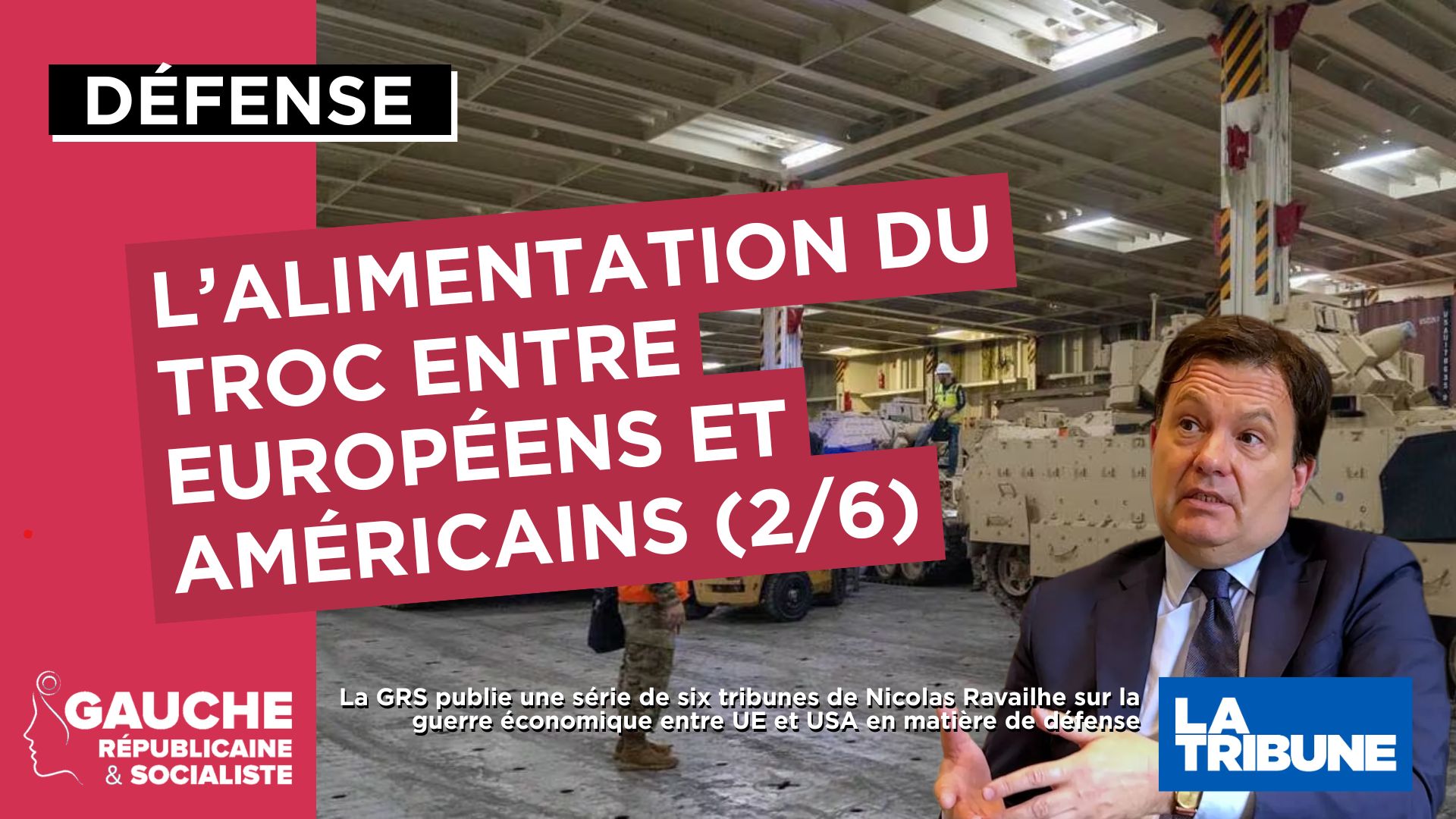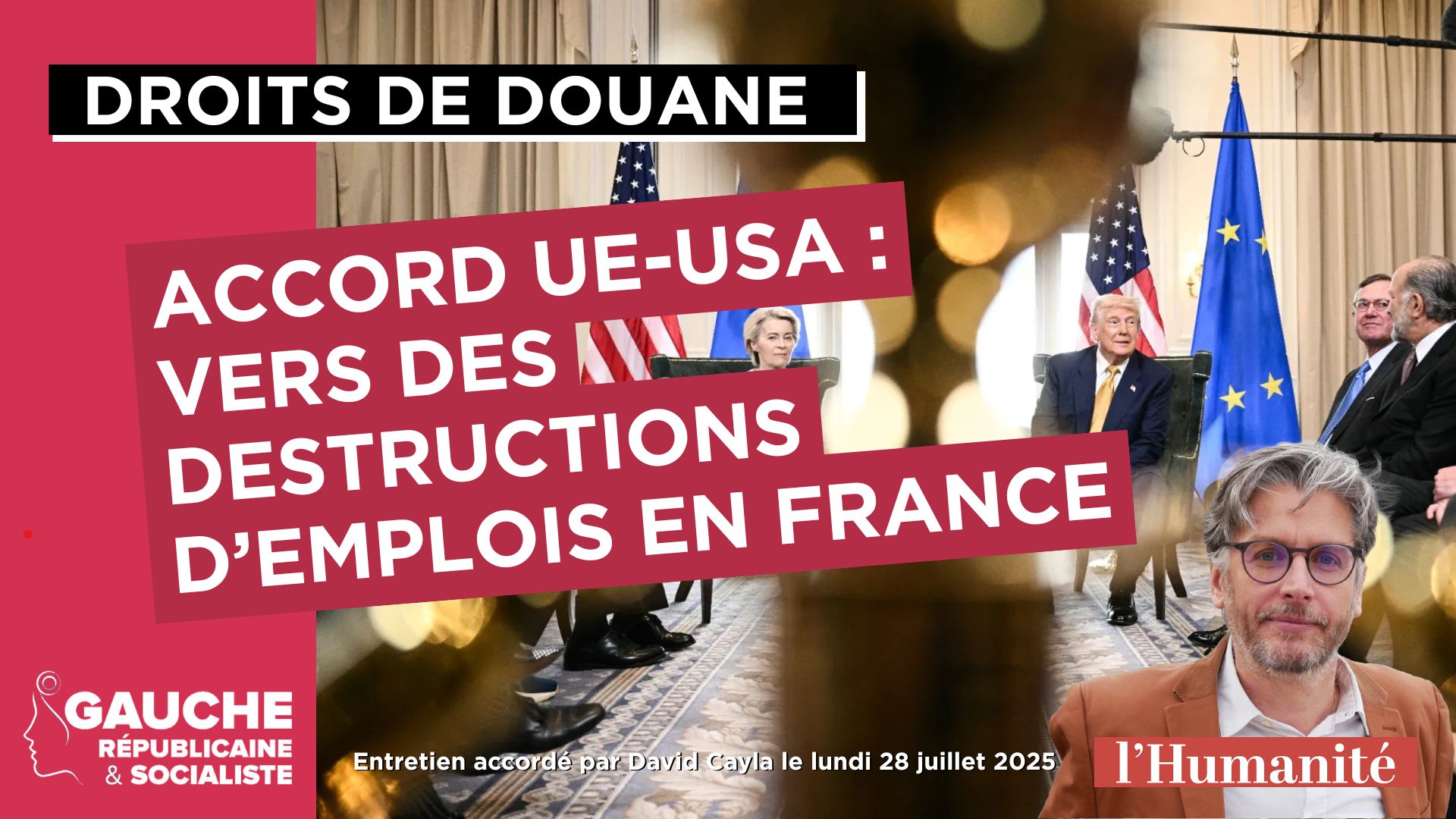Nicolas Ravailhe, professeur à l’École de guerre économique et avocat au barreau de Bruxelles (droit européen), propose une chronique sur la guerre économique entre les États-Unis et l’Europe dans le domaine de la défense en six volets. Ces articles ont été initialement publiés dans La Tribune.
Dernière partie : le nerf de la guerre qui est comme toujours la question du financement contrôlé par le droit. De l’économie de guerre à la guerre économique, l’Union européenne devra se mobiliser pour rester la plus autonome possible.
Personne n’ignore que sans maîtrise des financements, il ne peut pas y avoir de souveraineté. Toute l’expertise de l’Union européenne (UE) se déploie donc sur le sujet et c’est un « festival » de pièges à tous les niveaux. Des experts, par exemple des universitaires américains, sont dépêchés pour venir modéliser les enjeux du réarmement de l’UE devant les décideurs européens. La dernière intervention, le 26 juin 2025 devant une commission du Parlement européen, est celle de Madame Kaija Schilde, Associate Dean of Studies, Pardee School of Global Studies, Boston University.
Dans son intervention, elle a expliqué aux Européens que la logique d’arsenal des États était néfaste. Kaija Schilde a plaidé pour un cadre juridique sécurisant au niveau européen – ce qui est fait avec la « modernisation » prévue des directives – afin de permettre au secteur privé d’investir dans des marchés sécurisés. Werner von Siemens, véritable père fondateur de l’UE, n’aurait pas dit mieux : « qui crée la norme, crée le marché ». Viennent ensuite les logiques de financements.
Avant de financer, il est donc nécessaire de restreindre les marges de manœuvre des États. Pourtant, les directives sur les marchés publics permettraient le contraire. Il convient aussi « booster » les possibilités de commercer en matière de défense. La dernière proposition vise à éliminer des freins dans la directive de 2009 sur les marchés de défense et dans des législations connexes, « Omnibus défense ».
Les marchés publics : cible numéro 1
Pour la France qui aspire à se réindustrialiser, le fait que la défense relève de marchés publics spécifiques est d’ailleurs un énorme atout. L’ambassadeur américain en Europe ne s’y est pas trompé et ils déplore déjà que des États qualifient de défense certaines dépenses un peu en marge du sujet. Qu’à cela ne tienne… les Européens négocient que dans les 5% de PIB affectés à la défense, 1,5% serve la logique de défense, des infrastructures connexes par exemple.
Ensuite, la commande publique des Européens est organisée. Le Parlement européen et le Conseil ont eu à se prononcer sur le programme EDIP. Des débats ont eu lieu sur des dispositions fantoches et inopérantes concernant la souveraineté, par exemple la condition de 65 % de composants européens pour intégrer les dispositifs européens. Or, il suffit de 1% pour être dépendant de composants stratégiques. Quant aux 65% de composants européens, la définition n’est pas très claire étant donné que des groupes étrangers produisent en Europe souvent en coopération avec des groupes américains, comme par exemple Rheinmetall. La France et l’Allemagne s’opposent sur la définition de la souveraineté.
Il faut de l’argent, encore de l’argent
Sur les 800 milliards annoncés du plan Rearm Europe, 650 milliards doivent provenir des États. Qui dispose de montants aussi importants ? L’Allemagne est riche et peut allouer 400 milliards. Un belle aubaine pour combler le « trou d’air » des industries civiles. Le PDG de Rheinmetall a été vu visitant des usines Volkswagen. De l’intérêt des directives européennes qui permettent d’investir dans la défense sans les cadres européens contraignants. En matière civile, la réglementation des aides d’État et celle sur les marchés publics auraient été un obstacle avec de tels montants.
Pour la France qui peine à respecter sa loi de programmation milliaire, la réalité est autre. L’UE a donc ouvert aux États qui n’ont plus d’argent la possibilité de se réarmer. La contrainte dite « critères de Maastricht » qui pèse depuis des années sur les budgets des États est levée, à tout le moins partiellement, pour une durée limitée – quatre ans dans la proposition initiale. À juste titre, la France n’a pas souhaité recourir à cette faculté de « clause de sauvegarde » offerte par l’UE. S’endetter davantage n’a pas de grande utilité sans logique de conquêtes économiques.
De plus, des logiques d’opposition franco-françaises sur l’usage de la dette surgiraient alors que nous avons besoin d’investir dans la défense comme dans d’autres secteurs.
Dans quatre ou six ans, nous serions davantage endettés et directement placés sous tutelle. L’Italie n’est pas plus motivée. Face au peu de succès de la mesure, l’UE cherche donc d’autres marges de manoeuvre tout en refusant l’endettement commun. En effet, l’Europe du Nord craint d’être exposée par les dettes de concurrents. De plus, ces derniers pourraient se renforcer dans la compétition qui s’accentue en matière de productions et de ventes d’armes.
Outre les 650 milliards d’euros sensés être mobilisés par les États, l’Europe lance le programme SAFE, doté de 150 milliards d’euros entre 2025 et 2030. La France a décidé d’y recourir. Tout sera donc intelligence économique dans ce programme qui vise l’achat ou la production d’armes en coopération et avec toujours la même « ambiguïté » autour de la notion « d’au moins 65% de composants ou technologies européennes ».
L’Allemagne verrouille les votes
Les fonds européens actuellement disponibles sont mobilisés. La politique régionale, gros pourvoyeur, a été immédiatement sollicitée. En l’espèce, l’Allemagne s’est souvenue des succès de son Ostpolitk qui a servi ses exportations et ses investissements à l’étranger. Contributeur net au budget européen, comme et même davantage que la France, la République fédérale et ses Länder ont aidé les entreprises allemandes à se ruer sur les financements européens disponibles en Europe de l’Est après les élargissements, c’est-à-dire avec la sécurité juridique du droit européen.
Ces relais de croissance, à l’opposé de délocalisations effets d’aubaine, n’ont pas supprimé d’activités outre-Rhin. Les entreprises allemandes ont augmenté leur volume de production, réduit les coûts et gagné en compétitivité. Les États, objets de ces investissements, ont été arrimés aux intérêts allemands pour conserver ces activités économiques. Ils votent donc majoritairement avec l’Allemagne les choix législatifs et normatifs de l’UE, ce qui conforte les majorités au Conseil comme au Parlement européen. La gouvernance de la Commission européenne est quant à elle bien maîtrisée par la présidente et ses collaborateurs.
L’ouverture des fonds européens de la politique régionale aux activités de défense va donc engendrer les mêmes logiques que dans le civil. Ne pas accompagner des PME et des grands groupes dans leurs logiques de croissance dans les États européens exposera à des difficultés concurrentielles très fortes. La préparation du prochain cadre financier européen, post 2028, devrait renforcer ces logiques au profit des industries de défense.
Les Français ont payé des chars coréens à Varsovie
Bien entendu, d’autres fonds européens contribuent à financer les activités de défense. Le Fonds européen de la défense (FEDef) est peu doté mais il a une influence sur les coopérations et les choix de défense en Europe. On voit mal la France, avec ses finances publiques exsangues, participer au financement d’un projet via le FEDef et concomitamment financer un projet concurrent avec le budget de l’État. Le Programme de R&D civil de l’UE – Horizon – est aussi sollicité en raison de la dualité de certaines activités ou de transferts très aisés de technologies civiles vers les matériels de défense.
La Banque européenne d’investissement est également à la manœuvre. Une première tranche de 3 milliards a été débloquée. Dans ce cadre, le premier partenariat signé avec des banques européennes pour distribuer ces prêts est conclu avec la Deutsche Bank pour 500 millions d’euros destinés à financer des entreprises en Europe. BPCE devrait recevoir une enveloppe de 300 millions d’euros.
Il est utile de noter que ces programmes européens sont « audités » à grands frais par des cabinets américains (soumis au droit américain). Les mêmes cabinets conseillent aussi les instances européennes, notamment la DG Defi de la Commission européenne.
En outre, on rappellera qu’un autre programme, la Facilité européenne pour la paix, est déployé dans le but de moderniser les armées européennes qui ont donné des matériels à l’Ukraine. Les armes données sont remplacées par des équivalents à valeur du neuf sans condition de souveraineté européenne. Le contribuable français et européen a par exemple payé des chars coréens et des avions américains à la Pologne avec une perte sèche pour notre industrie et le budget de nos armées d’environ trois milliards d’euros. Il est faux de dire que nous n’étions pas en capacité de fournir, d’autant plus que les Russes ne sont pas en état d’attaquer l’UE à brève ou à moyenne échéance.
Création d’une banque de défense
Comme les fonds publics ne suffiront pas : les fonds privés sont-ils la solution ? Un lobbying très intense s’opère dans l’UE autour de ce business très prospère. Il est envisagé de créer la Banque de défense, de sécurité et de résilience (DSR) conçue comme un instrument financier stratégique visant à renforcer les capacités de défense collective des nations euro-atlantiques et indo-pacifiques.
Dans un contexte de menaces sécuritaires et d’incertitudes économiques croissantes, de nombreux pays alliés peinent à maintenir des dépenses de défense adéquates en raison de ratios dette/PIB élevés, de coûts d’emprunt élevés et de contraintes budgétaires nationales. La Banque DSR proposée vise à alléger ces pressions financières en fournissant un mécanisme de financement durable et coopératif facilitant les investissements à long terme dans la défense, la sécurité et la résilience ».
Le droit américain en embuscade
Tout est dit et cela résume tout : les États n’ont plus de moyens financiers et l’UE se charge de les contraindre en ce sens. L’UE régule, par la R&D et le droit, le marché et les programmes européens de défense. Des experts américains viennent expliquer que le privé permet d’être cinq fois plus efficace que les États. Une banque est créée pour décider qui finance quoi et où. De plus, elle saura tout sur ceux qui solliciteront les fonds. En matière, d’intelligence économique, on ne peut pas faire mieux. La force de l’extraterritorialité du droit américain pourrait se charger du reste « en cas de nécessité ».
Les États comme les entreprises de défense n’auront pas le choix. Ils devront recourir à des structures financières privées – il n’y aura pas ou peu d’argent disponible ailleurs – ou périr face à une concurrence qui sera financée. Bien évidemment, cette banque ou des équivalents ne seront pas contrôlés par des États en mesure d’exercer leur pleine souveraineté. En l’état des perspectives européennes comme des moyens nationaux, il est manifeste que des fonds privés doivent être mobilisés, en particulier pour sécuriser les fonds propres de nos entreprises comme pour assurer leur croissance.
L’irrigation des fonds privés vers le secteur de la défense est urgente mais en étant opérée de concert avec les États. Les fonds privés nationaux n’obèrent pas forcément la souveraineté d’un État. Économie de guerre ou plutôt guerre économique, il nous appartient de nous mobiliser.
Nicolas Ravailhe
(fin … provisoire)