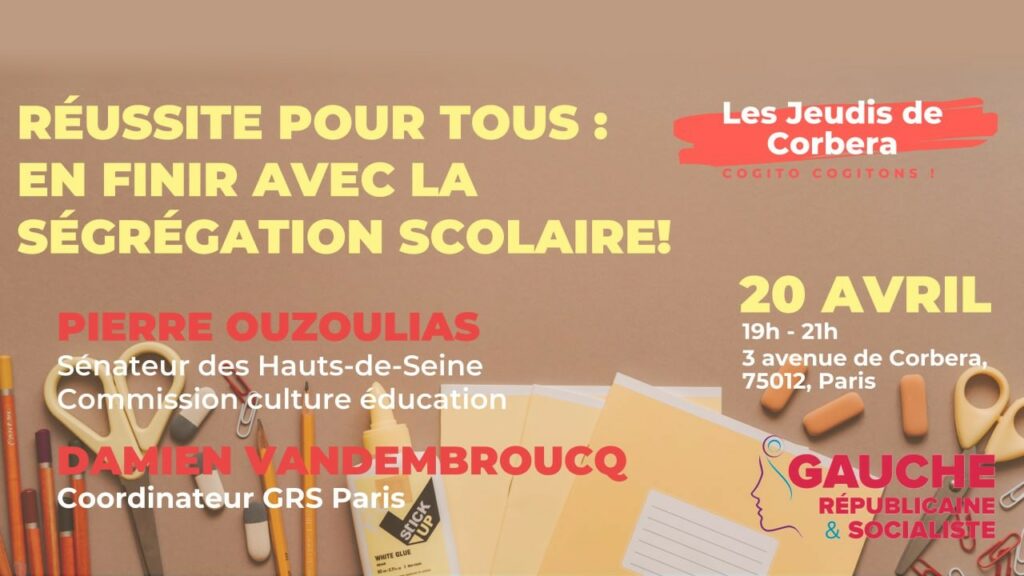Dans cet entretien Manon D. étudiante en économie nous décrit le quotidien des étudiants pendant la crise du Covid-19. C’est un témoignage personnel. Cet entretien a été réalisé voici plusieurs mois, nous choisissons de le publier aujourd’hui car les difficultés révélées par la crise sanitaire et celles qu’elle a provoquées n’ont toujours pas trouvé de réponses de la part des pouvoirs publics.
propos recueillis par Augustin Belloc et Gurvan Judas
GRS : Comment en tant qu’étudiante as-tu vécu la crise de la Covid-19, avec les cours à distance, la solitude, les loyers exorbitants à Paris ou encore la nécessité de travailler pour subvenir à tes besoins ?
Manon : C’était difficile, comme pour tous les étudiants et notamment les plus précaires. Moins pour les étudiants biens lotis avec un logement adéquat ou une maison en province à la campagne avec leurs parents. Mais pour moi et mes amis qui étaient dans la même situation, nous nous sommes retrouvés dans un petit appartement de 10 m². Les cours étaient à distance, nous n’étions pas confinés mais avec le couvre-feu, les cafés et bibliothèques fermés c’était comme un confinement. On suivait nos cours à distance et le soir, nous étions confinés. Donc nous étions isolés.
Pendant deux ans, aucune possibilité de rencontrer de nouvelles personnes et de faire de nouvelles expériences relationnelles et professionnelles. C’était dur pour le morale.
Pour les cours, on dépendait de notre connexion Wifi, moi au 7e étage j’avais une mauvaise connexion donc il y avait des cours que je n’ai pas pu suivre, ce qui m’a pénalisé et m’a fait avoir de mauvaises notes. J’ai été prise en Master, mais une amie a redoublé et a décroché à cause de ça. Les professeurs n’ont pas pris en compte les problèmes liés à la connexion internet. Apprendre seul et apprendre avec un professeur, cela n’est pas pareil…
Ce problème d’exclusion, ne pas pouvoir suivre les cours et tout faire dans la même pièce de 10 m² où l’on mange, où l’on dort, où l’on travaille, etc. C’est dur. Mes APL m’ont fait survivre, mais une amie qui travaille dans la restauration et qui avait besoin de travailler n’a pas pu. Donc, elle a eu des problèmes d’argent.
As-tu eu le sentiment d’avoir été soutenue par l’institution universitaire ?
Il y a eu des moyens mis à disposition, on pouvait louer un ordinateur, une box, etc. Mais ça ne marchait pas, ils ne prenaient pas en compte les moyens propre à chacun. Donc des moyens était mis à disposition, certains professeurs mettaient des exercices pédagogiques. Mais je ne pensais pas avoir mon année et personne ne m’écoutait.
Par exemple : un examen en ligne, où je ne pouvais pas passer les questions à cause d’un problème de connexion, j’ai contacté le professeur il n’a rien fait… Je ne me sentais pas entendu. J’ai eu 4 à cet examen ce qui a plombé ma moyenne.
On a beaucoup vu les étudiants devant les banques alimentaires, est-ce quelque chose que tu as vécu ou connais-tu des personnes qui l’ont vécu ?
Personnellement non, grâce à ma bourse, mais une amie déjà concernée avant le Covid oui. Mais elle vivait cela avec du recul. Donc des amis partageaient cette situation : du mal à se nourrir avec des familles qui n’ont pas les moyens d’aider. Donc ils ont eu recours aux paniers alimentaires.
Je vivait en appartement CROUS, il y avait des moyens mis en place. Je n’ai pas connu cette situation, je m’en suis sorti financièrement car comme nous étions confinés il n’y avait pas de sortie, ça fait économiser de l’argent. Mais c’était dur.
Selon les types d’études, il y a eu des inégalités entre les grandes écoles avec plus de moyens et les universités, tu as pu le constater ?
J’ai été mis au courant de cela. En école privée, les étudiants pouvaient aller dans les locaux en petits effectifs. Ils pouvaient se sociabiliser alors que dans les universités nous étions mis à la marge, en détresse, on était les oubliés ; une amie a redoublé sa L2 car elle a fait une dépression. Elle a vu un psy mais avec des sessions d’une demi-heure… Donc dans certaines écoles privées, les étudiants avaient presque une vie normale et nous, à l’université, nous étions seuls.
Cette situation a-t-elle généré des tensions entre différents étudiants selon les possibilités qui leurs étaient offertes ?
C’était de la survie, chacun pour soi. Nous n’avions pas le temps de penser à mal envers autrui, la situation nous échappait donc c’était de la survie propre. Le fait que certain en profitaient, on le voyait de loin.
On a beaucoup parlé des étudiant dans les médias et le monde politique mais rien n’a été fait à part une revalorisation des APL dont on avait retiré 5 euros. On en a parlé, mais dans les faits est-ce que quelque chose a été fait ?
Depuis la crise, la cause étudiante a été mise en avant comme une des préoccupations du mandat d’Emmanuel Macron. Mais je ne cherche pas à voir ce qui a été fait ni à écouter ce qui peut se dire. Je n’ai pas cherché à avoir une augmentation, ma bourse et mes APL me suffisaient.
Le Système d’aide exceptionnelle, j’y ai eu recours à la rentrée dernière avec un dossier et une lettre de motivation. On doit passer devant une commission et parfois ils effectuent un versement selon les besoins.
Il y a eu également des aides avec des assistantes sociales. Il y a aussi des repas à un euro, ça a permis à des étudiant de se nourrir, car parfois le midi je ne mangeais pas, donc le restaurant universitaire et le repas un euro ça m’a changé la vie. On peut manger à moindre coût, mais sinon il y a eu peu de changement pour les logements notamment, etc.
Car je suis boursière échelon 6 avec une mère seule sans père, elle ne peut pas financer un logement à Paris. Je n’ai pas eu de logement Crous à ma rentrée à Paris et sans logement l’assistante sociale a été mis devant le fait accompli et j’ai réussi à l’avoir.
Donc même si il y a des moyens on ne facilite rien. J’aurai pu ne pas avoir de logement. Ma demande Crous n’a pas été renouvelé, j’ai un appartement que je paie plein pot avec certes heureusement les APL. C’est différent d’un logement Crous, donc la situation ne s’est pas améliorée malgré de petites mesures.
Avec une approche plus politique qu’est-ce que l’État aurait pu ou dû faire dans ce cas ?
On a conscience de la précarité étudiante globale mais pas de la diversité. On a l’impression parfois que tous les étudiants faisaient la queue devant les banques alimentaires mais ce n’est pas vrai.
J’ai une amie qui habite à Paris mais qui a besoin de travailler c’est un exemple de précarité économique, on a pas tous les même contacts si on a un problème, on a pas tous le même filet de sécurité.
Ma bourse me suffit si je travaille à côté ; mais si je ne peux pas travailler, on est dans la précarité économique. Il ne faut pas juste prendre en compte une certaine situation, il faut prendre en compte la diversité des situations. Ceux par exemple avec des parents pas assez riches pour aider et financer un logement à Paris, mais trop riches pour avoir une bourse. Ils ne sont jamais pris en compte.
Beaucoup ont besoin d’aide mais ne les voit pas. Les logements étudiants sont des taudis, avec des fenêtres cassées et douches cassées, c’est honteux de se dire que là réside l’avenir de la Nation, ils ne peuvent pas réussir à l’université dans ces situations quand ils habitent là… il faut revoir les conditions d’existence, se nourrir, se loger, etc. On a l’impression de devoir le mériter alors que ce sont des besoin fondamentaux. Il faut faire en sorte que les emplois du temps soient flexibles pour que les étudiants travaillent. Certes il y a les examens terminaux mais ça veut dire qu’un étudiant dépend juste d’une note, c’est une insécurité.
Je sais que le personnel pédagogique n’a pas à se charger de ça mais il ne peuvent rien faire. Donc il faut soulager les cours et les emplois du temps, car deux jours par semaine j’avais cours le midi et je travaillais dans un restaurant, ce n’était pas possible. Ça n’incite pas à travailler mais simplement à se serrer la ceinture.
La prise en compte de la diversité au pluriel est quelque chose de ciblé. Certains habitent loin mais pas suffisamment loin avec effectivement des parents trop riches pour être boursiers et trop pauvres pour payer un loyer à Paris. Ils sont alors obligés de faire 3 heures de transport quotidiennement ce qui est un autre type de difficultés.
Rien à voir avec des étudiants qui vivent dans un 200 m² dand le VIe arrondissement de Paris avec leur parents et aucune tâche ménagère à faire…
C’est le cas pour les études supérieures réservé à une élite. C’est impossible de faire une Prépa si les parents ne suivent pas derrière. Ce n’est pas possible avec des tâches ménagères et sans aide. C’est infaisable. Il y en a beaucoup pour qui ce type d’études d’élite n’est pas possible.
Il y a un plafond de verre, même s’il va à Paris avec une bourse, c’est impossible.
Ce n’est pas inaccessible sur le papier, mais dans les faits… Donc, comment les étudiants se sont-ils organisés avec cette précarité entre écoles privées et les universités, il n’y a pas eu de friction, mais une entraide entre étudiant ?
Oui clairement, avec le confinement et tous les gens chez eux, des initiatives ont permis de faciliter le quotidien. Comme l’association « Copains ». C’est initiative de banque alimentaire pour les jeunes étudiants. C’est plus terre à terre que ce que propose le gouvernement car ils connaissent les étudiants et leur situation.
Alors qu’aujourd’hui quand on demande une aide au CROUS on doit le justifier. Ça tombe dans le misérabilisme le fait de devoir justifier l’état de son compte bancaire ; là ce n’était pas le cas.
J’y suis allée pour des photos, j’ai vu les locaux et le directeur de l’association. Il nous a dit qu’il voit des étudiants dans toute les situations, c’est une initiative étudiante. Ensuite des choses dans les promos ou entre amis ont été faites. J’ai mal vécu cette période et avec mon amie qui a redoublé on se retrouvait, on dormait ensemble, etc. C’est pour cela que l’on a réussi à surmonter cette situation car on a créé du lien, on a créé des interactions dans le réel, une solidarité entre étudiant.
Face au côté macro de Copains, avec mon groupe d’ami de la fac, on s’invitait régulièrement à manger à la maison. On s’aidait avec des webcams pour bosser ensemble. On essayé de trouver des solutions pour rendre ça viable.
Quel rôle ont joué les syndicats étudiants pendant la crise ?
Je suis assez étrangère à ce petit monde, ce petit microcosme, trop proche de la France Insoumise.
Il y a 20 ans dans une situation pareille les syndicats étudiants auraient été incontournables, là ça n’a pas été le cas, ils n’ont pas réussi à s’organiser dans cette situation cela en dit long, non ?
Il se sont organisés à leur échelle. Ça n’est pas aussi important que dans le passé mais ils ont lutté contre le Conseil universitaire pour illustrer le problème de connexion internet ou l’exclusion sociale, car Mme Vidal (Ministre de l’Enseignement Supérieur) donnait des orientations rigides. Ils avaient la volonté de faire quelque chose mais les universités ont bloqué.
Ils ont parlé des modalités des partiels qui étaient injuste. Les étudiants étaient évalués de manière rigide.
Pendant le CPE en 2005 un syndicat comme l’Unef était incontournable, aujourd’hui on a l’impression d’avoir vécu la crise étudiante sans en entendre parler en dehors d’un petit microcosme. Même toi qui est étudiante et engagée…
Les étudiants ne relayaient pas ce qui défendait leur cause malheureusement car nous étions dans une forme d’individualisme.
Entre ceux dans leur résidence secondaire et nous en difficulté, on faisait face à la fatalité, on était désespéré, on ne voyait pas d’évolution possible.
Sans les syndicats et les universitaires qui tiennent le choc, qui était là pour les étudiants dans cette période ?
Je n’ai pas été aidées par des organismes extérieurs. Entre les étudiants eux-mêmes il y a eu une vraie solidarité. Malgré l’aide de secours avec le Crous mais c’est quelque chose d’extérieur d’annexe de froid sans prise de nouvelles ni de suite ni de suivis alors qu’on avait besoin de tuteur.
Je me suis remise en question sur mon orientation, si je dois continuer en économie ou non. J’en suis venue à me demander si je devais me réorienter dans quelque chose de plus accessible.
Il y a eu des talents perdus, des abandons. J’ai eu de la chance de ne pas me perdre : on parle pas des destin gâchés.
Dans le monde professionnel, les formations qui ont eu lieu pendant le Covid et après ont été refaites car ça n’a pas marché. Dans le monde professionnel, il y a un filet de sécurité mais à la faculté ceux qui n’ont pas pu suivre et qui ont dû quitter la fac n’avaient pas de filet de sécurité. Notamment ceux qui ont obtenu le Bac en 2020, il y avait une angoisse d’avoir eu un « sous bac », ou une « sous licence » ensuite…
Il y a eu beaucoup d’examens à distance et de triche organisée. Et ce n’était pas les meilleurs. Ils ont prit la place en Master de gens qui n’avaient pas triché. Mon ami qui a redoublé ne pouvait pas tricher. Et les professeurs étaient plus stricts dans leur évaluation car ils savaient qu’il y avait des tricheurs et ils ne cherchaient pas à comprendre.
En deuxième année, les tricheurs on eu de bonnes notes et mon amie redoublait sa L2…Souvent ils ne sont pas passionnés par ce qu’ils font, c’est par défaut et ils ont de bonnes notes car de bonnes conditions pour tricher.
La gestion des universités pendant la crise n’a donc pas été adaptée ?
Il y a eu des initiatives de la part des universités. Des initiatives prises comme le tutorat en présentiel une semaine sur deux mais c’était décousu donc sans intérêt. L’équipe pédagogique a aidé les élèves mais pas l’université dans son ensemble.
Je me suis déjà plainte à un chargé de travaux dirigés et c’est lui qui a mis en place un support pédagogique mais pas l’université. C’était au cas par cas.
Le problème de l’université, c’est que les initiatives n’étaient pas adaptées au terrain et à la disparité des étudiants. Moi avec mes problèmes de connexion internet, ils ne m’ont pas prise en compte.
Donc il y avait des moyens à disposition mais des œillères, ils n’ont pas cherché à voir la continuité du problème.
Pourquoi la gauche a-t-elle échoué à s’emparer de cette question de la précarité énorme des étudiants ? Cela n’a pas abouti à une mobilisation des étudiants aux urnes avec une abstention massive, plutôt qu’un vote massif Mélenchon et Nupes… Ensuite, pourquoi le mouvement social n’est pas devenu politique ? Comment la gauche aurait dû s’en s’emparer ?
Le problème de la gauche c’est qu’elle misérabilise les étudiants. Quelqu’un comme Louis Boyard par exemple misérabilise les étudiants qui seraient tous à la rue, etc. Mais ce n’est pas le cas, c’est hétérogène. On accepte cette situation de vivre en tant qu’étudiant, aucun étudiant n’est à l’aise financièrement c’est normal, c’est la période. La gauche s’est décrédibilisé. C’est une chance d’étudier.
On travaille et on m’aime pas être misérabilisé. Ça ne me donne pas envie de considérer ça je ne vois pas ça avec sympathie donc je pense qu’ il faut arrêter avec le misérabilisme et se rende compte de la diversité des situations, il y a des étudiants très pauvres avec des situations terribles mais ils sont accompagnés et c’est très bien.
J’ai une amie avec des problème familiaux et le CROUS a été là, ils l’ont aidée. Les étudiants dans une extrême pauvreté sont aidés. Donc ça ne doit pas être la cible principale pour le politique, le principal problème ce sont les étudiants des classes moyennes rurales pas accompagnées, dans l’ombre, dont on ne parle pas médiatiquement car on les considère normaux.
L’analyse c’est que la gauche doit retrouver le chemin de la majorité, pas des minorités. Il faut parler des étudiants ultra-précaires mais tu ne gagnes pas avec simplement cela. Tu ne gagnes pas avec l’addition de minorités, c’est le biais de l’intersectionnalité.
Il faut parler des étudiants des classes moyennes pour qui c’est plus difficile, des gens dont les parents paient le loyer mais qui doivent se débrouiller avec leur paye pour les charges et la nourriture.
Ils doivent travailler tous les week-ends et moi avec ma bourse, je n’ai pas besoin de travailler… Mon amie paye son essence car elle habite à la campagne. C’est une charge supplémentaire. Les classes moyennes des campagnes souffrent énormément, cantonnées à la ruralité.
Le fait qu’on parle que des pauvres attisent une haine envers eux, une jalousie car ils sont couvert avec les aides sociales et on les misérabilise. C’est contre productif d’avoir de l’empathie pour eux. Arrêter le misérabilisme et prendre en compte la disparité des situation.
Les étudiants précaires qui viennent de villes moyennes et de banlieues, comme le dit Christophe Guilly on une facilité d’accès à la culture et à l’enseignement et les classes moyennes qui viennent de la ruralité n’ont accès à rien.
Les gens veulent se faire respecter de manière général. Les gens n’aiment pas que l’on les misérabilises, ils veulent un travail. La gauche ce n’est pas le paternalisme, la gauche c’est l’émancipation.
La gauche a abandonné le travail.