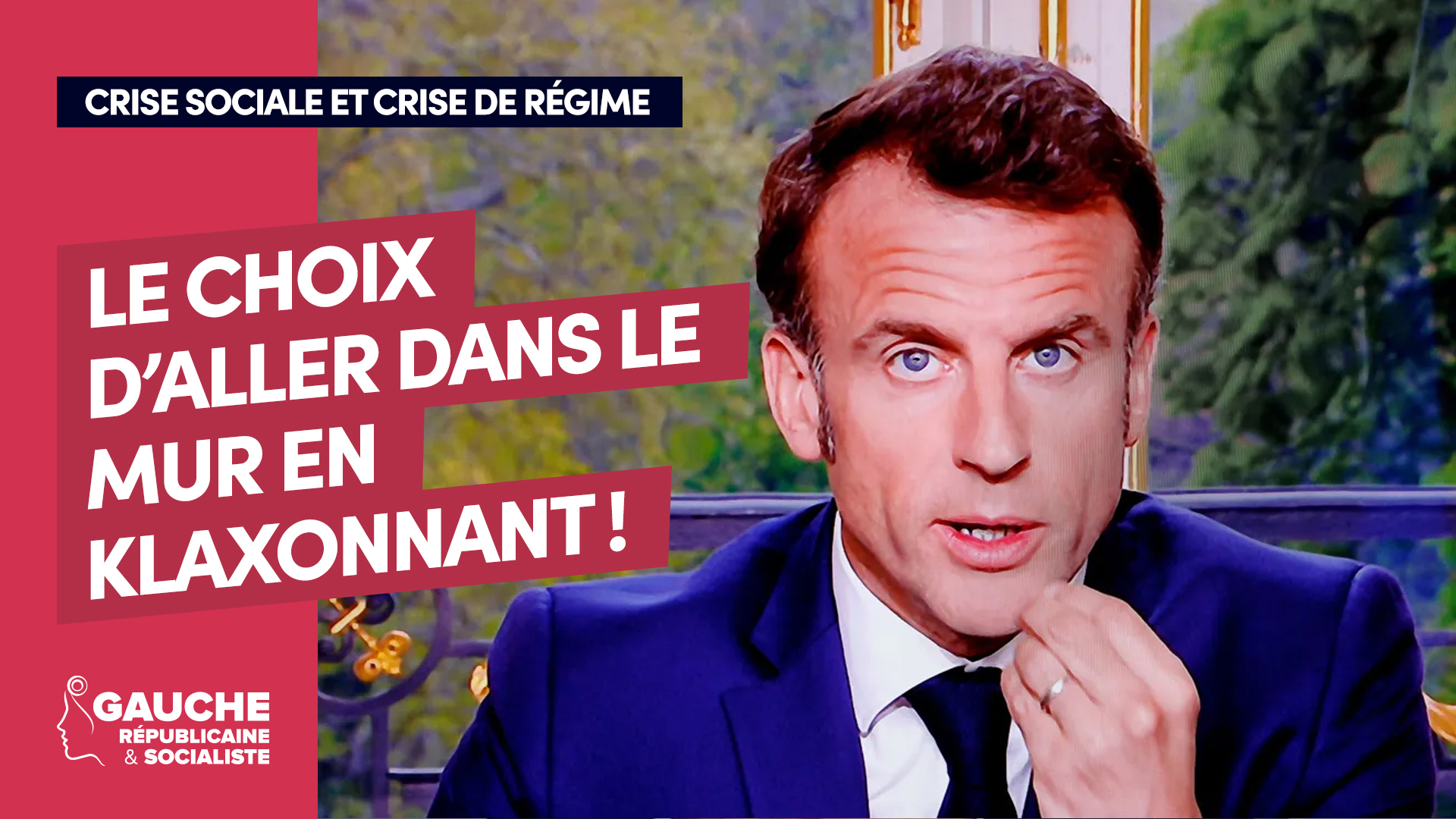De l’intervention du président, les Français n’attendaient qu’une seule chose : qu’il retire une réforme injuste et cruelle, quasi unanimement condamnée. Mais Emmanuel Macron, s’il a reconnu, dans un rare éclair de lucidité, que le passage à 64 ans « n’était pas accepté », n’en a pas pour autant tiré la seule conclusion logique qui aurait pu ramener de « l’apaisement ». Au contraire, le chef de l’État a fait le choix de foncer droit dans le mur en klaxonnant.
Dès lors, cette courte allocution n’apporte rien d’autre que du carburant supplémentaire à la colère, dont le Président fait semblant de ne pas comprendre qu’elle est dirigée contre lui. Les Français en ont assez de sa pratique autoritaire et arrogante du pouvoir, de sa brutalité, de son mépris des corps intermédiaires et de son indifférence aux souffrances de la classe ouvrière et de la classe moyenne.
Pour le reste, son programme des « cent jours » s’apparente à un catalogue de mesures disparates, pour la plupart recyclées d’interventions précédentes, et sans véritable plan d’action. Comme à son habitude, Emmanuel Macron essaie de noyer le poisson et refuse d’apporter les réponses qui s’imposent aux inquiétudes de nos concitoyens.
Déconnecté du réel, obtus, Macron est incapable de comprendre l’ampleur des crises auxquelles le pays est confronté. Il persiste dans une lecture néolibérale des enjeux économiques et sociaux. Bruno Le Maire a ainsi confirmé ce matin que son « seul but est d’accélérer le désendettement de la France », ce qui annonce un nouveau train de mesures austéritaires – en totale contradiction avec la soi-disant « volonté de justice sociale » exprimée hier par son chef.
Répondre à l’urgence sociale
Comment l’Exécutif compte-t-il résoudre la crise sociale qui nait de l’inflation galopante des produits de première nécessité, à commencer par l’alimentation et l’énergie ? Ses « chèques » et ses « boucliers » n’ont servi à presque rien, mais ont couté cher aux finances publiques.
Ce dont les gens ont besoin, c’est d’un rattrapage de leurs revenus pour pouvoir faire face. Mais Macron, Borne et Le Maire, n’en veulent pas. Ils poursuivent sciemment leur politique de « déflation compétitive » en refusant d’indexer les salaires sur les prix (hormis l’indexation du SMIC, qui leur est imposée par la loi). Ils estiment qu’en faisant baisser les salaires réels, car c’est bien de ça dont il s’agit, la France attirera les capitaux et se réindustrialisera.
Ce faisant, ils commettent une énorme erreur d’analyse, car l’inflation n’est pas nourrie par les salaires : elle est nourrie par les profits ! Tous les économistes voient ce qui est en train de se passer : il y a aujourd’hui en France une boucle « profits – prix » qui tourne à plein régime et qui frappe des millions de familles ne touchant pas davantage que le revenu médian (environ 1800€ net par personne).
Les classes populaires sont les premières victimes, mais les classes moyennes elles-mêmes, confrontées à une augmentation rapide des prix alimentaires, révisent radicalement leur manière de consommer. Pour la majorité des Français, les fins de mois sont difficiles.
Il y a pourtant des marges de manœuvre. La montée des prix engendre des recettes supplémentaires de TVA et la montée des profits accroît le rendement de l’impôt sur les sociétés (60 milliards en 2022). Il est donc possible de sauver le pouvoir d’achat des Français en indexant leur salaire sur les prix « et en même temps » de sauver les services publics, particulièrement l’hôpital, de l’effondrement. Mais le Gouvernement fait exactement le contraire, en misant tout sur « l’attractivité du capital » et en osant même s’auto-délivrer d’indécents satisfécits sur l’ouverture de quelques usines et sur la baisse – artificielle – du chômage.
Répondre à la crise démocratique
Face à un échec économique et social aussi patent et une colère populaire aussi massive, l’Exécutif s’enferme dans une spirale dont même les commentateurs les plus modérés voient qu’elle ne peut dégénérer qu’en crise de régime. À un stade si avancé de bâillonnement parlementaire, de mépris des syndicats et de brutalisation de l’État vis-à-vis de l’ultra-majorité de l’opinion, comment pourrait-il en être autrement ?
Les « 100 jours de l’apaisement » risquent bien, en effet, de finir en Waterloo politique non seulement pour Macron, mais aussi, hélas, pour la souveraineté populaire. Toute critique est au mieux esquivée au pire balayée d’un revers de main. Toute opposition est empêchée, par l’usage systématique du coup de force.
Coup de force institutionnel avec l’usage des articles 47-1 (on peut changer en quelques jours la retraite des Français avec une simple loi de finance rectificative de la Sécu), 44 (vote bloqué sur les seuls amendements acceptés par le Gouvernement) et 49-3 (adoption sans vote du projet de loi), que même le Conseil constitutionnel, dans son incompréhensible (« surprenante », disent les juristes) décision du 14 avril dernier, a qualifié « d’inhabituel ».
Coup de force répressif, avec le retour – en force – des tabassages en règle de manifestants, voire de simples passants, dont les images et le son ont fait le tour du monde, stupéfiant les opinions publiques des démocraties et suscitant des réactions indignées de la part des défenseurs des droits, jusqu’au Conseil de l’Europe. Les gens sont arrêtés « préventivement », les manifestations sont interdites par simple affichage public, sans autre forme de notification, parfois même… le lendemain de leur déroulement !
Coup de force social enfin : le refus de faire vivre un dialogue de qualité avec les représentants du monde du travail, dans un pays à ce point éprouvé, est une faute politique grave. Depuis des mois, l’unité syndicale est un bien précieux. Elle conforte la légitimité des dirigeants des grandes centrales. Le pouvoir qui les méprise ne peut qu’accroître la crise.
La 5ème République n’est pas un régime qui sied à n’importe qui. François Mitterrand avait prophétisé : « les institutions étaient dangereuses avant moi. Elles le seront après moi ». Nous y sommes. Et nous ne pouvons plus nous permettre de parier sur l’élection d’un De Gaulle, d’un Mitterrand ou même d’un Chirac, qui eux, surent apaiser les crises. Il est à l’inverse possible, sinon probable, que le pire advienne en 2027.
Il faut donc changer de République et constituer un nouveau régime politique, essentiellement parlementaire, où tous les pouvoirs ne sont pas concentrés dans une seule paire de mains.
Pour ce faire, il faut redonner la parole au peuple. D’abord en obtenant un référendum sur les retraites ; et ensuite en tournant la page du macronisme et en même temps de cette 5ème République à bout de souffle.
64 ans, c’est toujours non. La 6ème République, plus que jamais, c’est oui.
Frédéric Faravel et Laurent Miermont